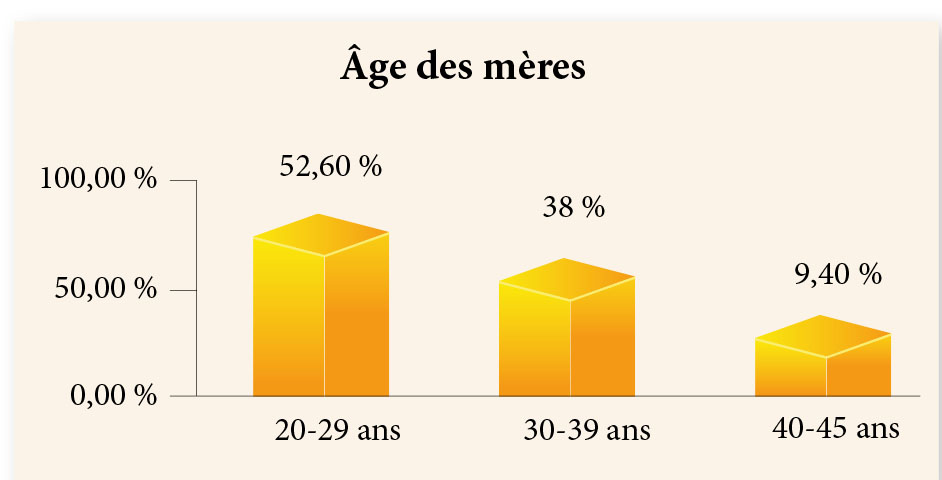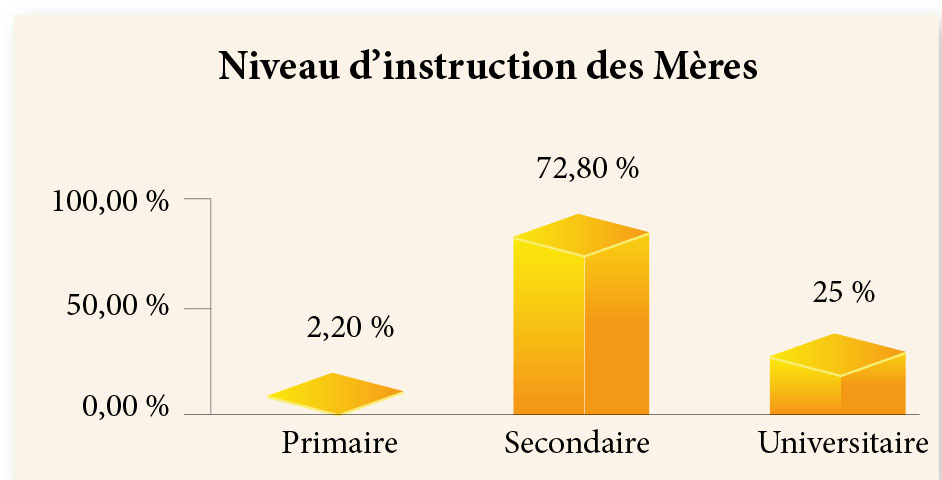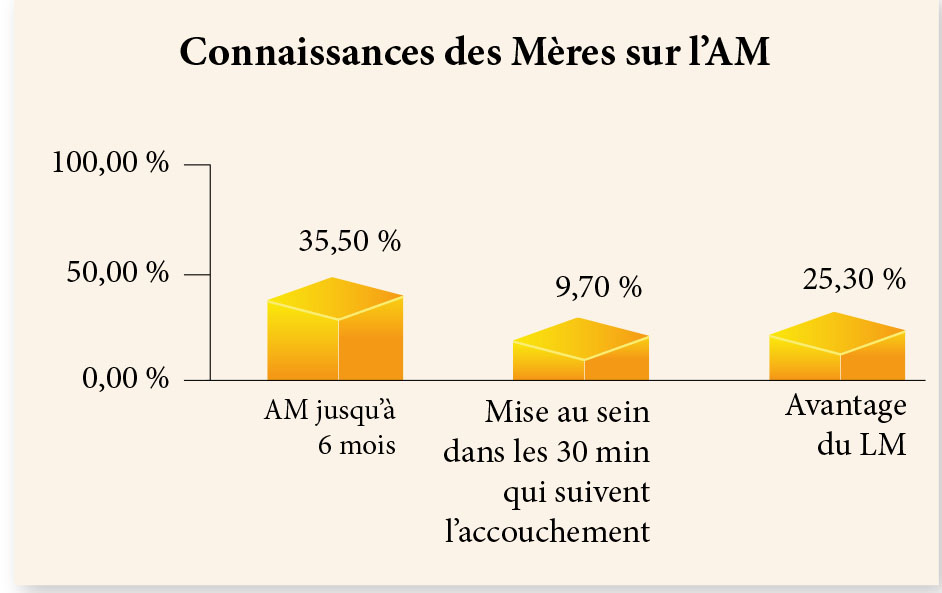Le cancer du poumon est un véritable problème de santé publique, il représente en effet la première cause de mortalité par cancer dans le monde et en Algérie. Il occupe, dans notre pays, le deuxième rang des cancers chez l’homme après les cancers colorectaux,
Interview du Pr Z.C. Amir
- Le cancer du poumon est en nette croissance, responsable du plus grand nombre de décès par cancer dans le monde. Pourriez-vous nous parler de la situation épidémiologique en Algérie ? (Incidence en constante croissance, mortalité dans les deux sexes, diagnostic tardif) …
Le cancer du poumon est un véritable problème de santé publique, il représente en effet la première cause de mortalité par cancer dans le monde et en Algérie. Il occupe, dans notre pays, le deuxième rang des cancers chez l’homme après les cancers colorectaux, avec une incidence brute de 12,5/100.000 habitants, et un âge moyen de 61 ans (Réseau des registres des tumeurs, Pr. Hamdi Cherif, 2017). Chez la femme, il viendrait au 7ème rang, avec une incidence estimée à 5,3/100.000 habitants (registre des tumeurs d’Alger, 2017).
L’incidence du cancer du poumon suit l’évolution de la consommation tabagique. En effet, le tabac demeure le principal facteur de risque de ce cancer, par conséquent nous n’insisterons jamais assez sur la lutte anti-tabagique, seul moyen de prévention qui permettra de faire baisser cette incidence.
Durant l’année 2020, année de la pandémie Covid-19, 327 cas de cancer du poumon ont été pris en charge dans notre service d’anatomie et de cytologie pathologiques du CHU Mustapha Bacha. Les carcinomes bronchiques non à petites cellules (carcinomes épidermoïdes et adénocarcinomes) sont de loin les plus fréquents et représentent 81%, avec une nette prédominance des adénocarcinomes. Une fois que le diagnostic d’adénocarcinome est établi, le pathologiste doit identifier des cancers du poumon différents sur le plan moléculaire. Dans 85% des cas, le pathologiste est confronté à des prélèvements de petite taille (biopsies bronchiques, biopsies transpariétales et cytoblocs), pour porter le diagnostic de certitude, déterminer le pronostic et évaluer les marqueurs prédictifs à la réponse thérapeutique.
La problématique réside dans le fait que plus de 85% des cancers du poumon sont diagnostiqués à un stade tardif, par conséquent ces patients ne peuvent bénéficier d’une chirurgie, leur seule alternative thérapeutique restera le traitement médical ou chimiothérapie. Malgré une amélioration de la survie globale avec un traitement à base de platine le pronostic reste sombre, avec une survie globale de 10% à 5 ans. Les progrès ont été considérables ces dernières années tant du point de vue des techniques de diagnostic, que thérapeutique (traitement médical, thérapie ciblée, immunothérapie).
Les biomarqueurs éléments clé de la médecine de précision
- À la base des avancées révolutionnaires dans le cancer du poumon, il y a la compréhension de la génétique et des voies pathologiques qui sont responsables du cancer. Pourriez-vous nous expliquer le rôle des biomarqueurs, mutations précises ou des expressions génétiques dans la prise en charge du cancer du poumon ?
Ces dernières années le développement de la biologie moléculaire a permis une meilleure compréhension de l’oncogenèse (en particulier des voies de signalisations oncogénétiques), et le développement de nouvelles thérapies ciblées (inhibiteurs des tyrosines kinases ‘TKI’) souvent associées à un type et/ou sous-type histologique spécifique. De multiples altérations génétiques ayant un impact dans la sélection thérapeutique ont été identifiées telles que la mutation EGFR, la translocation ou fusion ALK, la translocation ROS1, la mutation BRAF V600E, l’amplification MET exon 14 skipping, NTRK, RET, KRAS), qui seraient mutuellement exclusives (les chevauchements sont rares, on parle d’altérations concurrentes retrouvées dans 1 à 3% des cas).
Ces testing moléculaires sont réalisés à un stade avancé et métastatique de la maladie, sur des types histologiques spécifiques, essentiellement les adénocarcinomes, carcinomes bronchiques non à petites cellules NOS, carcinomes à grandes cellules. Pour le carcinome épidermoïde, l’indication est posée sur décision de la réunion pluridisciplinaire (si le patient est non ou peu fumeur, si la biopsie est de petite taille peu représentative, et s’il y a suspicion d’une histologie mixte).
D’autres anomalies moléculaires sont des mutations de résistance aux TKI telles que la mutation EGFR T790M, la mutation KRAS.
Plus récemment, l’immunothérapie, une autre alternative thérapeutique prometteuse, basée sur le principe de la restauration de l’immunité anti-tumorale a été approuvée par la FDA dans les cancers bronchiques non à petites cellules (adénocarcinomes et carcinomes épidermoïdes), qui ne présentent pas d’anomalie moléculaire EGFR/ALK/ROS1/BRAF/KRAS ; et qui expriment PD-L1 en immunohistochimie (Expression déterminée par le ‘tumor proportion score : TPS‘). Un entrainement approprié des pathologistes est essentiel pour une interprétation adéquate du TPS.
Tous ces progrès en oncologie imposent au pathologiste une démarche plus large, un challenge, pour une prise en charge optimale du cancer du poumon. Actuellement, la seule plateforme de biologie moléculaire fonctionnelle qui prend en charge le testing moléculaire du cancer du poumon en Algérie est celle du service d’anatomie, de cytologie pathologiques et de biopathologie du CHU Mustapha.
Des traitements de plus en plus personnalisés
- Grâce aux traitements “sur mesure”, on espère ainsi une meilleure efficacité de la prise en charge, moins d’effets indésirables et une meilleure qualité de vie. À cet effet, l’accès aux thérapies innovantes est une priorité pour le patient (quel serait votre message d’espoir) ?
Les modalités de prise en charge du patient doivent faire l’objet d’une discussion pluridisciplinaire (RCP) tenant compte de son âge, du PS, de ses comorbidités, du stade TNM, du type histologique et des caractéristiques moléculaires. Les thérapies ciblées et l’immunothérapie, ont apporté de nouveaux espoirs. Ces thérapies innovantes sont adaptées en fonction des caractéristiques morphologiques et moléculaires de la tumeur. Le tissu tumoral reste à ce jour la clé de l’analyse moléculaire et du ciblage thérapeutique, c’est un nouveau challenge pour les pathologistes qui doivent réaliser plus de tests pour peu de tissu tumoral, et en peu de temps pour les faire.
Notre message d’espoir est que ces thérapies innovantes ont véritablement révolutionné la façon dont est traité le cancer du poumon, nous devons cependant développer des moyens pour accroître d’une part l’accès au diagnostic, en assurant une équité d’accès aux tests moléculaires innovants et des tests de qualité à travers tout le territoire national et enfin et surtout, la disponibilité de ces traitements pour tous les patients.
Les décisions de ces thérapies doivent être prises en RCP dans le but de traiter uniquement les patients pour lesquels le bénéfice est très important, traduisant une bonne efficacité et d’éviter un traitement inutile, coûteux, toxique en préservant une bonne qualité de vie.
Enfin, il reste indispensable de lutter contre le tabagisme, d’encourager et d’accompagner le sevrage tabagique en prévention primaire, mais aussi après le cancer, car la poursuite du tabagisme majore notamment le risque de complications des traitements, de second cancer, et a un impact sur la survie.
Références
- Hamdi Cherif : Réseau National des registres du cancer Algérie (incidences 2015), Registre des Tumeur d’Alger
- Planchard. Et al. Lung and chest tumours metastatic non-small lung cancer. ESMO guidelines. Ann. Oncol, 2018, 29 (suppl 4)iv192-iv237
- Planchard . La Lettre du Cancérologue • Vol. XX – n° 6 – juin 2011
- Dr Tasuku Honjo won the 2018 Nobel Prize in physiology or medicine for discovering the immune T-cell protein PD-1.
- Novello S, Barlesi F, Califano R, Cufer T, Ekman S, Levra MG, et al. Metastatic non-small-cell lung cancer: ESMO Clinical Practice Guidelines for diagnosis, treatment and follow-up. Ann Oncol Off J Eur Soc Med Oncol. sept 2016;27(suppl 5):v1‑27.
- National Comprehensive Cancer Network (NCCN) Non-small cell lung cancer guidelines. version 4 – 2021
- GLOBOCAN 2018 : Estimated Cancer Incidence, Mortality and Prevalence Worldwide in 2018. IARC, World Health Organization. undefined