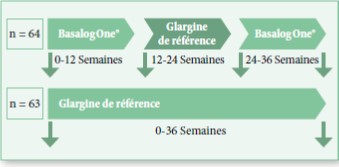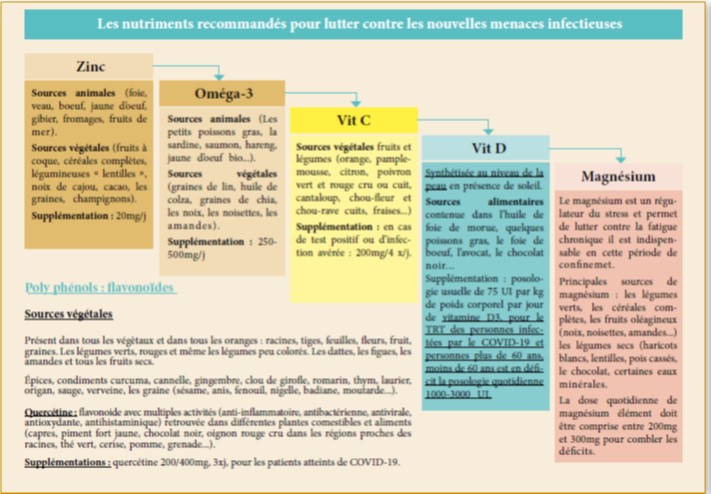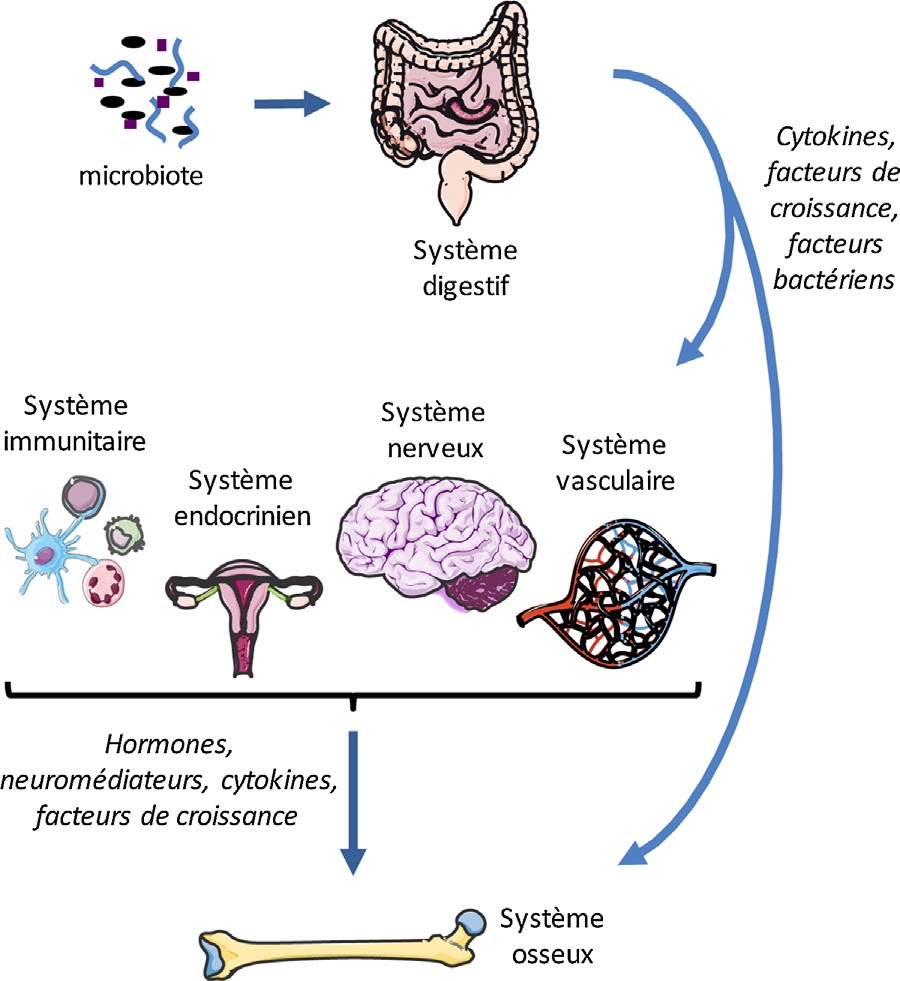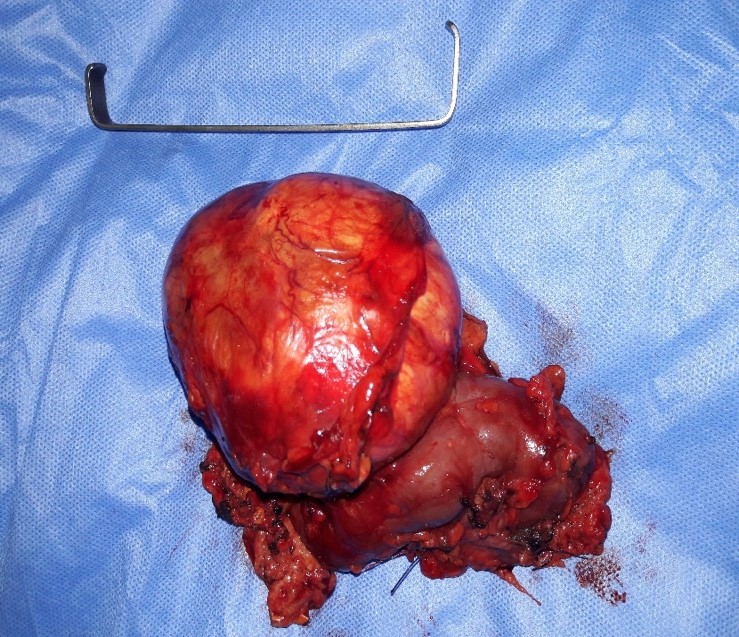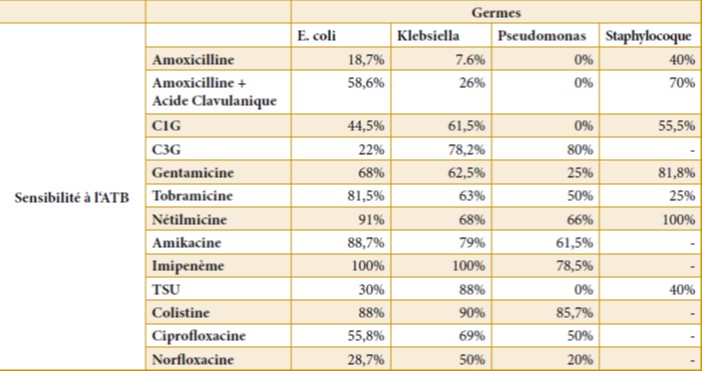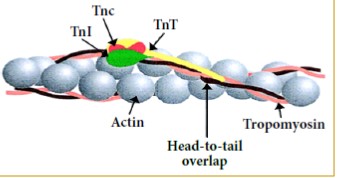Accés restreint. Connectez-vous ou Inscrivez-vous.
Catégorie : Médecine générale
ISTRIDE 3
L’étude INSTRIDE 3 avait pour objectif d’évaluer l’efficacité, la dose d’insuline, la sécurité et l’immunogenicité chez 127 patients diabétiques de type 1 commutés entre Insuline biosimilaire MYL-1501D et Insuline glargine de référence.
Efficacy and safety of MYL-1501D versus insulin glargine in people with type 1 diabetes mellitus: Results of the INSTRIDE 3 phase 3 switch study.
Efficacité et innocuité de l’insuline biosimilaire MYL-1501D versus l’insuline Glargine dans le diabète de type 1. Résultats de l’étude INSTRIDE 3 étude du switch.
Auteurs : Thomas C. Blevins, Abhijit Barve, Yaron Raiter, Patrick Aubonnet, Sandeep Athalye, Bin Sun, Rafael Muniz.
Reference : Diabetes Obes Metab. 2019 : 1-8. DOI: 10.1111/dom.13904.
Pr Malha AZZOUZ,
Professeur en Diabétologie,
CHU Mustapha Bacha, Alger
L’étude INSTRIDE 3 avait pour objectif d’évaluer l’efficacité, la dose d’insuline, la sécurité et l’immunogenicité chez 127 patients diabétiques de type 1 commutés entre Insuline biosimilaire MYL-1501D et Insuline glargine de référence.
La population étudiée était celle éligible de l’étude INSTRIDE 1 qui avait terminé 52 semaines de traitement sous insuline glargine de référence.
L’étude INSTRIDE 1 [1] avait déjà démontré l’efficacité et la tolérance de l’insuline biosimilaire MYL-1501D (Basalog One) [2].
L’étude a duré 36 semaines, la population a été randomisée en deux bras avec un ratio 1:1 ; un groupe contrôle était sous Glargine de référence et un autre sous traitement séquentiel : l’insuline biosimilaire MYL-1501D (Basalog One) pendant 12 semaines ensuite switché (interchangé) vers Glargine de référence pendant 12 semaines ; puis remis sous l’insuline biosimilaire MYL-1501D (Basalog One) pendant les 12 dernières semaines.
L’analyse statistique des objectifs à était réalisé en mITT.
Résultats :
- La baisse de l’HbA1c est identique entre les deux groupes, (-0,05) dans le groupe insuline biosimilaire MYL-1501D (Basalog One) Vs (–0,06) dans le groupe Glargine de référence.
- L’HbA1c est restée relativement stable pendant les trois phases du traitement dans le groupe de patients soumis au traitement séquentiel par l’insuline biosimilaire MYL-1501D (Basalog One) sans différence significative (p> 0.05) (figure 1A).
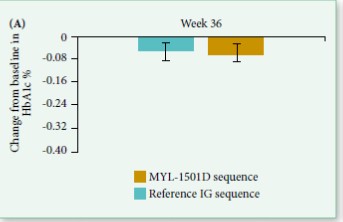
Figure 1 A : Least squares mean change in glycated haemoglobin (HbA1c; %) from baseline at week 36.
- Par ailleurs cette étude a également retrouvé une similitude entre les glycémies à jeun, les profils glycémiques et les doses d’insuline utilisées dans les deux groupes.
- Cette étude n’a pas montré de changements significatifs de ces différents paramètres lors des switchs successifs.
- La fréquence des effets secondaires apparus sous traitement étaient similaires entre le groupe insuline biosimilaire MYL-1501D (41/64, 64,1%) et le groupe sous insuline glargine de référence (42/63, 66,7%) pendant la période de traitement de 36 semaines.
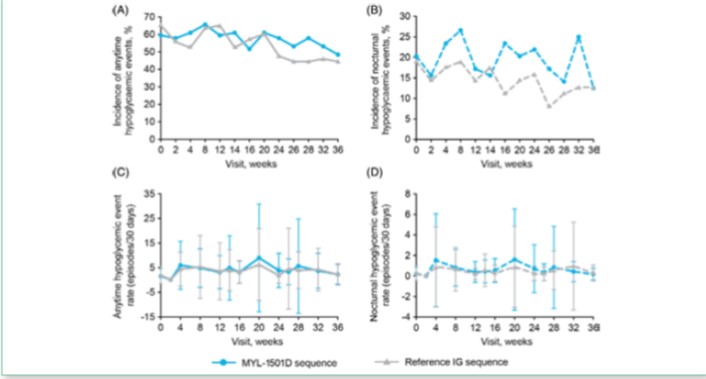
Figure 3 : Incidence (A) des événements hypoglycémiques nocturnes à tout moment et (B) des événements hypoglycémiques nocturnes et taux moyen réel (C) des
événements hypoglycémiques à tout moment et (D) des événements hypoglycémiques nocturnes (nombre d’épisodes par 30 jours) par visite et séquence de traitement.
Les barres d’erreur représentent l’écart-type. IG, insuline glargine
La fréquence des hypoglycémies était la même dans les deux groupes (Figure 3 A, B, C, D).
- L’étude INSTRIDE 3 semble atteindre son objectif principal en démontrant que les modifications de l’HbA1c étaient les mêmes dans les deux groupes.
- Les doses totales d’insuline étaient comparables dans les deux groupes. La dose était plus basse au début de l’étude dans le groupe insuline biosimilaire MYL-1501D (Basalog One) bien qu’il ait eu une augmentation de dose pendant les 4 premières semaines, considérée comme non significative. (Figure 2)
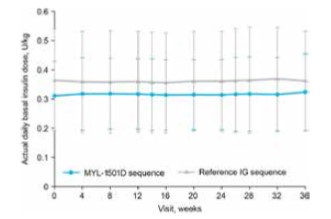
Figure 2 : Dose basale quotidienne moyenne réelle de MYL-1501D ou de référence d’insuline glargine (IG) au fil du temps. Les barres d’erreur représentent l’écart-type
- Sur le plan immunogénicité, l’insuline biosimilaire MYL-1501D (Basalog One) n’a pas entrainé plus d’anticorps que l’insuline Glargine de référence.
De façon générale, il semble que l’étude ait démontré que les profils immunologiques soient comparables entre l’insuline glargine de référence et l’insuline biosimilaire MYL-1501D (Basalog One). Le taux d’anticorps apparus sous traitement est comparable entre les deux insulines. Les différences entre les différentes séquences de traitement ne semblent pas statistiquement significatives.
De façon générale, les résultats de l’étude montrent que l’insuline biosimilaire MYL-1501D (Basalog One) est bien tolérée chez le patient diabétique de type 1 pendant les 36 semaines de l’étude avec des taux d’anticorps similaires dans les 3 séquences et dans les deux groupes.
Cette étude aurait montré une sécurité de l’insuline biosimilaire MYL-1501D (Basalog One) équivalente à celle de l’insuline glargine de reférence. Et le switch entre les deux insulines n’a pas entrainé plus d’anticorps ni d’autres évènements indésirables. Cette étude conclut à un profil immunogène et de sécurité similaire entre les deux insulines.
L’interchangeabilité avec les insulines biosimilaires requiert plusieurs conditions à savoir une similitude en termes d’équilibre glycémique, de doses d’insuline, d’incidence et de la gravite des hypoglycémies.
Enfin l’étude INSTRIDE 3 qui a été menée avec rigueur, par un panel international d’investigateurs reconnus, a atteint son critère d’évaluation principal ; avec une efficacité et une sécurité similaire entre les deux insulines biosimilaire MYL-1501D (Basalog One) et glargine de référence lors du switch entre celles-ci.
Ce travail a été présenté au 3ème congrès mondial sur les essais cliniques dans le diabète à Vienne en décembre 2018.
[1] Thomas C. & al; Efficacy and safety of MYL-1501D vs insulin glargine in patients with type 1 diabetes after 52 weeks: Results of the INSTRIDE 1 phase III study; Diabetes Obes Metab. 2018 ;1–7.
[2] L’insuline biosimilaire MYL-1501D : Basalog One® en Algérie ; Semglee® en Europe.
Recommandations nutritionnelles pour lutter contre les nouvelles menaces infectieuses
Dans le contexte de la pandémie mondiale du COVID-19 et face à cette menace, nous cherchons toutes les solutions qui nous permettraient de mieux appréhender la situation. Dans le cas de la Covid-19, l’alimentation-santé fait partie de l’arsenal des outils à notre disposition, en raison de son impact sur la santé.
F. Bouachria-Bousmaha1, S. Aouichat Bouguerra2
1 Sous-Direction des activités en milieu spécifique, MSPRH,
2 Physiopathologie Cellulaire et Moléculaire (Faculté des Sciences Biologiques, Laboratoire Biologie et Physiologie des Organismes, Université des Sciences et de la Technologie Houari Boumediene )
Date de soumission : 11 Juillet 2020.
Résumé : Dans le contexte de la pandémie mondiale du COVID-19 et face à cette menace, nous cherchons toutes les solutions qui nous permettraient de mieux appréhender la situation. Dans le cas de la Covid-19, l’alimentation-santé fait partie de l’arsenal des outils à notre disposition, en raison de son impact sur la santé. Le risque d’infection n’est pas seulement lié à la virulence d’un germe, il est aussi dépendant de nos capacités de défenses, or elles peuvent être diminuées pour de multiples raisons. D’une part, le manque de certains nutriments clés nécessaires à la production des armes antivirales et antibactériennes, comme le zinc, la vitamine D, les acides gras Omega3, la vitamine B6 ; et d’autre part, le degré d’efficacité de certains antioxydants (vitamines C, E, bêtacarotènes, polyphénols en quantité insuffisante dans notre organisme, peut impacter négativement nos défenses immunitaires.
Mots clés : Pandémie mondiale, COVID-19, alimentation-santé, risque d’infection, manque de certains nutriments clés, défenses immunitaires.
Abstract: In the context of the global COVID-19 pandemic and in front of this threat, we are looking for all the solutions that would allow us to apprehend the present situation. In the case of the Covid-19, healthy food is one of the tools that we dispose, which has a direct impact on our health. The risk of infection is not related only to the virulence of a germ, it is also dependent on our defences. However, it can be reduced by multiples ways. Such as the deficiency of certain key nutrients that are necessary to produce antiviral and antibacterial barrier (weapon), like zinc, vitamin D, Omega3 fatty acids and vitamin B6. As well, the lack of certain antioxidants (vitamins C, E, beta-carotenes, polyphenols …), if not present sufficiently will lead directly to a decrease of our immune defence.
Keys words: COVID-19 pandemic, healthy food, risk of infection, deficiency of certain key nutrients, immune defence.
Problématique
De très nombreuses études ont mis en exergue que l’alimentation est de nos jours au cœur de la régulation de l’immunité et permet la modulation de la défense de l’organisme par :
- Un microbiote intestinal de qualité pour réguler positivement l’immunité
- Un statut nutritionnel optimisé pour renforcer l’action des cellules immunitaires
- Un système immunitaire équilibré [1].
- Une faible contamination aux xénobiotiques [2].
Au-delà de la problématique infectieuse actuelle imposée par le Covid-19, l’inflammation de bas grade, en rapport avec l’émergence de nombreuses pathologies (obésité, diabète de type 2, maladies cardiovasculaires, maladies auto-immunes, cancers, maladies neurodégénératives), qui menacent de diminuer l’espérance de vie des générations futures [3], est en amont d’une alimentation inadaptée ; laquelle a des conséquences délétères sur l’immunité [4]. Aussi, contrôler l’inflammation par des solutions nutritionnelles dans un contexte d’urgence associé à la Covid-19 mérite d’occuper une place centrale [5,1].
Ces dernières années, de nombreux chercheurs se sont penchés sur la relation alimentation / régulation de l’immunité et la relation régulation de l’immunité / contrôle de l’inflammation ; cette dernière étant au cœur du sujet Covid-19. En effet, ce dernier provoque une hyperactivité du système immunitaire à l’origine d’une production massive de cytokines induisant une inflammation, menant au décès d’un nombre très important de patients [6]. Par conséquent, le cœur de l’enjeu lié à la lutte contre la Covid-19 est de contrôler la cascade inflammatoire, liée plus à la surproduction de cytokines qu’au virus lui-même.
Par ailleurs, l’état biologique dans lequel se trouvent les personnes au moment de l’infection est en rapport avec l’état de leur système immunitaire. Ainsi, les personnes les plus à risque, sont celles qui présentent des inflammations chroniques (diabète, MCV, IRC, cancer, MAI). Aussi un système immunitaire sain peut aider le corps à combattre le virus, et la nutrition peut le soutenir de différentes manières [5]. Les mêmes auteurs indiquent que les pratiques d’hygiène publiques – et lorsqu’elles sont disponibles, les vaccinations – peuvent être des mécanismes de protection efficaces contre les maladies infectieuses. Cependant les vaccins peuvent prendre des années pour être créés et ne sont pas disponibles contre tous les virus y compris le Covid-19.
Pour ce cas précis, les chiffres de morbidité et de mortalité incitent la mise en place de stratégies supplémentaires pour soutenir le système immunitaire. Par conséquent, les responsables de la santé publique devraient penser à inclure des stratégies nutritionnelles dans leurs recommandations pour améliorer la santé publique face à la Covid-19, car une multitude de données mécanistiques et cliniques montrent que les vitamines y compris la Vit A, B6 et B12, le folate mais notamment la vitamine D et C, les oligo-éléments dont le zinc, le fer, le sélénium, le magnésium et le cuivre, les acides gras oméga-3 [5], ainsi que les polyphénols, particulièrement la quercetine [1] aident à soutenir et à optimiser la fonction immunitaire.
Rôle des micronutriments et des oligoéléments dans le renforcement du système immunitaire
Les rôles mécaniques que jouent les micronutriments pour optimiser la fonction immunitaire ont été décrits récemment [7,8]. En rapport avec l’immunité innée, les vitamines et les minéraux fonctionnent collectivement dans l’entretien des barrières physiques, dans l’activité des macrophages et des neutrophiles. Ils supportent également l’immunité adaptative via la différenciation, la prolifération et le homing des lymphocytes, la production de cytokines, d’anticorps et la génération de cellules mémoires [7].
Les nutriments clés nécessaires à la production des armes antivirales et antibactériennes (Cf. Tableau récapitulatif en annexe) :
Les rôles que jouent la Vit C et la Vit D dans l’immunité sont bien élucidés.
La Vit C : contenue dans de nombreux fruits et légumes (orange, pamplemousse, poivron vert et rouge cru ou cuit, cantaloup, chou-fleur et chou-rave cuits, fraises).
Elle est impliquée dans le soutien de la fonction de la barrière épithéliale, dans la croissance et la fonction des immunités innée et adaptative, dans la migration des cellules immunitaires vers les sites d’infection et la production d’anticorps [7]. De nombreuses études ont montré que la supplémentation de Vit C réduit les risques de pneumonies ; chez les personnes âgées, la sévérité de la maladie et le risque de décès sont réduits avec la supplémentation de la Vit C [9].
La Vit D : Peut être synthétisée au niveau de la peau en présence de soleil et ses sources alimentaires sont peu nombreuses, elle est contenue dans l’huile de foie de morue, quelques poissons gras (hareng, saumon, thon), le foie de bœuf, l’avocat, les cèpes, le chocolat noir.
La présence de son récepteur sur les cellules immunitaires marque son influence dans l’immunité, elle favorise la différenciation des monocytes en macrophages, elle module la production de cytokines et soutient la présentation de l’antigène. Par ailleurs, les métabolites de la Vit D semblent réguler la production de protéines antimicrobiennes susceptibles de réduire l’infection notamment dans les poumons [10,11]. Elle jouerait également un rôle essentiel dans la prévention des infections respiratoires [12,13]. Des études observationnelles ont signalé une association entre les faibles concentrations sanguines de 25-hydroxyvitamine D3, principal métabolite de la vitamine D et la sensibilité aux infections aiguës des voies respiratoires [14,15]. Conformément à ces résultats, plusieurs méta-analyses récentes ont conclu que la supplémentation en vitamine D peut réduire le risque d’infections des voies respiratoires chez les enfants et les adultes [16-21] ; et qu’une supplémentation quotidienne ou hebdomadaire en vitamine D protégerait globalement contre les IRA, sans aucun danger. La Vit D aurait également des influences ou répercussions positives dans la réduction de certains cancers comme les myélomes multiples [22].
Les acides gras oméga-3 EPA et DHA : sont contenus dans les petits poissons gras comme la sardine, certains oléagineux notamment les noix, les noisettes et les amandes, les œufs de préférence bio.
Sur le site de l’inflammation, ils sont convertis enzymatiquement en médiateurs spécialisés en résolution : les SPM[1] comprenant les résolvines, les protectines et les marésines lesquels favorisent la résolution de l’inflammation y compris dans les voies respiratoires [23, 24]. Les carences nutritionnelles en acides gras essentiels, peuvent entraîner un retard dans la résolution de l’inflammation. Cela pourrait être exacerbé dans le contexte Covid-19 qui se manifeste par une tempête de cytokines, liée au syndrome de détresse respiratoire aiguë (SDRA) [6, 25]. Les SPM formés à partir de DHA et EPA ont protégé des modèles expérimentaux contre des lésions pulmonaires aiguës et des SDRA [26, 27]. Par ailleurs, des formules nutritionnelles contenant des antioxydants et des EPA et DHA ont été utilisées dans plusieurs essais cliniques sur des patients en SDRA ; les résultats ont indiqué une amélioration significative de l’oxygénation du sang marquée par une réduction du séjour en soins intensifs et une diminution du taux de mortalité [28]. Par ailleurs, de nombreuses études dont celles de Deepak et al. (2018) [29], ont souligné l’implication des acides gras oméga-3 dans la réduction des évènements cardiovasculaires et de décès chez des patients ayant reçu 4g d’huile de poisson/J ou une supplémentation avec l’icosapent éthyle.
Le Zinc : ses sources sont animales (fruits de mer, foie, veau et bœuf, jaune d’œuf, gibier, fromages), et végétales (fruits à coque, céréales complètes quelques légumineuses/lentilles, noix de cajou, cacao).
Une carence marginale en zinc peut également avoir un impact sur l’immunité. Le zinc est important pour l’entretien et le développement des cellules des systèmes immunitaires inné et adaptatif. Une carence en zinc entraîne une altération de la formation, de l’activation et de la maturation des lymphocytes, perturbe la communication intercellulaire via les cytokines et affaiblit la défense innée de l’hôte [30,31]. Ceux qui sont déficients en zinc, en particulier les enfants, sont sujets à une morbidité diarrhéique et respiratoire accrue [32,33].
L’apport optimal de tous ces nutriments serait idéalement obtenu grâce à la consommation d’une alimentation équilibrée et diversifiée, mais cela peut être difficile à réaliser pour la population générale, d’où les insuffisances et carences nutritionnelles répandues dans différents pays développés ou en émergence sont réellement préoccupantes [34-47]. Les marqueurs biochimiques de l’état nutritionnel sont particulièrement utiles pour évaluer l’insuffisance ou la carence et conduisent à la conclusion que les apports sont souvent insuffisants. De nombreuses méta-analyses ont soulevé le problème de carence et de déficience en Vit C [41, 46, 47, 48] ; en Vit D [41-45] ; en Zinc, Vit B6 et B9, folate et sélénium [41, 47, 49,50,51] ; et en acides gras oméga-3 [52] ; et ce, à l’échelle mondiale, y compris l’Afrique.
En raison de cela, les chercheurs demandent la supplémentation en Vit C (200 mg et plus /J), en Vit D (2.000 UI équivalents à 50 µg/J), en Zinc (8 à 11 mg/J) et en oméga-3, EPA et DHA (250 mg/J) [5].
Rôle des polyphénols dans le renforcement du système immunitaire
Les polyphénols
Les polyphénols et particulièrement une classe connue pour son effet antagoniste à l’égard de la production des radicaux libres, “les flavonoïdes”, suscitent, depuis quelques décennies, l’intérêt des nutritionnistes et des consommateurs.
Les flavonoïdes, piégeurs de radicaux libres, sont présents dans tous les végétaux et dans tous les organes : racines, tiges, feuilles, fleurs, fruits, graines. Ils se trouvent dans les légumes verts, rouges et même les légumes peu colorés comme les pommes de terre, certaines variétés de pommes (golden, Granny-Smith) [53,54], les navets, les choux-fleurs.
Nos boissons de tous les jours : thé et café sont également riches en polyphénols. Les dattes, les figues, les amandes et tous les fruits secs contiennent des quantités non négligeables de polyphénols. Les épices (curcuma, cannelle, gingembre, cumin, clou de girofle), certaines feuilles sèches (romarin, thym, laurier, origan, sauge, verveine), les graines (sésame, anis, fenouil, nigelle, badiane, moutarde), sont également des sources naturelles d’antioxydants.
Les polyphénols et particulièrement les flavonoïdes dont la quercetine ont de nombreuses activités (antioxydante, anti-inflammatoire, antibactérienne, antihistaminique, antivirale). Ils ont été découverts en 1937 avec la Vit C par Albert Szent-Györgyi de Nagyrápolt [53], ce qui lui a valu un prix Nobel de Physiologie ou Médecine. Parmi les flavonoïdes, la quercetine retrouvée dans différentes plantes comestibles et aliments (câpres, piment fort jaune, sureau noir, chocolat noir, oignon rouge cru dans les régions proches des racines, thé vert, cerise, pomme) [54]. Une alimentation saine apporte au quotidien 25 à 50 mg de quercetine [55]. Piégeur des radicaux libres, la quercetine aide à lutter contre le stress oxydant et à atténuer les inflammations [56]. A cet effet, de nombreux chercheurs ont mis en en exergue l’effet inhibiteur de la quercetine sur les cytokines notamment le TNFa dans les réactions inflammatoires systémiques [57] et allergiques [58,59]. Lors d’une inflammation, les praticiens recommandent une prise de quercetine entre 200 et 400 mg, 3x/J. L’urgence de la situation de la Covid-19 a conduit les autorités chinoises à traiter les patients atteints du virus avec la quercetine.
Les conseils complémentaires pour renforcer son immunité
Sommeil et immunité
Le sommeil et l’immunité sont intimement liés, et ce de manière bidirectionnelle [60]. En effet, l’activation du système immunitaire altère le sommeil et le sommeil affecte à son tour les capacités de défense du corps. Un véritable cercle vicieux. Une dette de sommeil favorise par exemple la sécrétion de cytokines pro-inflammatoires impliquées dans les maladies inflammatoires chroniques intestinales (TNF-alpha, IL-1 et IL-6), qui favorisent elles même l’altération de la qualité du sommeil [61, 62]. La stimulation du système immunitaire déclenche une réponse inflammatoire pouvant, en fonction de son importance et de sa durée, augmenter la durée du sommeil. Il pourrait alors s’agir d’une adaptation hormonale à l’état infectieux de créer un contexte favorable de lutte de l’immunité. En effet, un sommeil de qualité induit une meilleure homéostasie de l’inflammation en modifiant la production de cytokines [63]. Une privation ou une perturbation du sommeil augmente l’inflammation de bas-grade et des pathologies associées comme le diabète, les risques cardiovasculaires ou les maladies neurodégénératives. Une dette de sommeil accroit également les risques d’infections autant virales, que bactériennes et parasitaires. Il semblerait que les cellules immunitaires ne puissent en effet plus disposer de l’énergie nécessaire, normalement utilisée pendant le sommeil [64]. Plus la durée de sommeil est courte, plus le risque de contracter un rhume augmente. De manière générale, un sommeil altéré réduit le nombre de lymphocytes, diminue l’expression du système HLA-DR, augmente les taux de cytokines pro-inflammatoires et perturbe la différenciation des lymphocytes CD4 et CD8. La privation de sommeil altère également la sécrétion des hormones stéroïdes influençant elles-mêmes la qualité du sommeil, entretenant ainsi le cercle vicieux. En conclusion et de manière très simple, meilleur sera votre sommeil, plus forte sera votre immunité ! Il s’agit d’un des piliers de votre santé.
Activité physique et immunité
Il s’agit ici d’un sujet particulier. En effet, il est parfaitement bien établi que l’activité physique exerce des effets bénéfiques sur l’immunité et sur la santé de manière générale, y compris pour les personnes malades en capacité de maintenir une activité [65, 66]. Les personnes âgées ont également tout intérêt à maintenir une activité pour optimiser leur système immunitaire, notamment du fait de l’effet de l’âge sur la perte de masse musculaire et sur les altérations métaboliques. Elle permet également de ralentir l’atrophie thymique, d’augmenter la production de lymphocytes T, de cytokines anti-inflammatoires (IL-7). A l’inverse, la sédentarité est un facteur de risque bien établi d’altération de la santé et d’augmentation de nombreuses pathologies métaboliques [67]. De même, des activités intenses répétées ou de longue durée fragilisent l’immunité et augmentent les risques d’infections des voies respiratoires au cours des 24 à 48 h suivant la pratique [68]. Selon votre niveau physique, la réalisation de séances avec des variations d’intensité sur des périodes de 20 à 30 min sont déjà particulièrement bénéfiques, des recommandations ont également été publiées récemment dans le cadre de l’infection Covid-19 [69].
Gestion des émotions et immunité
Il est désormais bien établi (depuis plusieurs décennies) que le stress psychologique est un facteur pouvant altérer fortement le système immunitaire, notamment les risques d’infections respiratoires, mais aussi d’asthme ou de rhinite allergique [70, 71]. Selon une étude récente (Aout 2019), la mesure du niveau de stress évalué selon la variabilité cardiaque pourrait représenter un indicateur de la vulnérabilité immunitaire [72]. Une revue systématique analysant les résultats de 27 études prospectives a identifié une augmentation du risque de développer une infection respiratoire de 21% en cas de stress psychologique. L’atteinte de l’immunité présente au niveau du mucus semble une des victimes du stress chronique [73].
Les enfants sont également concernés [74]. Récemment, l’équipe de recherche de l’INSERM dirigée par le Sophie Ugolini, a mis en évidence que l’affaiblissement immunitaire serait lié à une stimulation récurrente de certains récepteurs par les hormones du stress (récepteurs β2-adrénergiques) [75]. A l’inverse, des personnes soumises à un état d’esprit positif ont vu leur résistance aux infections au rhume et à la grippe augmenter [76,77]. Une autre étude randomisée contrôlée auprès de 413 participants réalisant de la méditation a également mis en évidence une plus grande résistance aux infections respiratoires. L’association avec de l’activité physique accroît encore cette résistance [78].
Tabagisme
Il est également reconnu comme un facteur de risques d’infections virales pulmonaires. Selon une revue systématique de 9 études incluant plus de 40.000 participants, les fumeurs réguliers présentent un risque de syndrome grippal plus élevé de 34%, et de grippe presque 6 fois plus important [79]. Toutefois, au regard des données relatives aux cas chinois et publiées récemment, le fait de fumer ne semblerait pas aggraver les risques de complications [80].
Résumé
Au vu de la situation actuelle, extrêmement préoccupante, les recommandations nutritionnelles pour assurer une alimentation saine et bien équilibrée, seraient la supplémentation en micronutriments (Vit C, Vit D, Zinc), en acides gras oméga-3 et en quercetine. Cette supplémentation serait un moyen sûr, efficace et peu couteux d’aider à éliminer les lacunes nutritionnelles, de soutenir une fonction immunitaire optimale, et donc de réduire les risques et les conséquences des infections [7,8]. Cependant, il est extrêmement important de savoir :
Que sont les compléments alimentaires ? Quel est leur intérêt nutritionnel et quelles sont les limites de leur utilisation ?
Selon les chercheurs nutritionnistes, les compléments alimentaires ne sont ni des aliments, ni des médicaments ; ils pourraient pallier à des carences alimentaires réelles ou jouer un rôle de prévention ? Ce ne sont pas des médicaments, ils n’ont donc pas d’effet thérapeutique. Palliant les insuffisances de l’alimentation, ils ont un intérêt qui ne peut être que nutritionnel et à la base des données de la littérature, ils ne doivent en aucun cas être considérés comme une priorité ; aussi utiles soient-ils pour soutenir l’immunité en cette période. Par conséquent, ils doivent rester dans leur rôle, à savoir celui de compléter l’alimentation “courante”, laquelle garde la priorité absolue, et sur l’amélioration de laquelle tous les efforts doivent porter.
L’usage des compléments alimentaires doit être réglementé, en rapport avec différents critères comme :
- Le déficit : Apport nutritionnel inférieur aux apports conseillés (< 70 %) entraînant un risque de carence
- La carence : Conséquence clinique et/ou biologique d’un apport nutritionnel inférieur aux besoins propres d’un individu
- La densité nutritionnelle : Teneur en K calories d’un aliment pour 100 grammes
- La densité énergétique : Teneur en nutriment (micronutriment le plus souvent) pour 100 K calories d’un aliment
- L’Apport Nutritionnel Conseillé (ANC) : apport nutritionnel correspondant à une valeur calculée servant de repère pour une population
- L’aliment fonctionnel : Aliment dont on a bien identifié les effets et les fonctions physiologiques et qui sont mis en avant
- L’aliment santé : Aliment dont on a établi qu’il est associé à des bénéfices santé
- L’alicament : Néologisme issu de la contraction de “aliment” et “médicament”
- La NOAEL (No Observed Adverse Effect Level) : La dose la plus élevée sans effet pour l’homme
- La LOAEL (Lowest Observed Adverse Effect level) : La plus petite dose ayant entrainé des effets indésirables chez l’homme [81] .
Liens d’intérêts : Les auteurs déclarent ne pas avoir de liens d’intérêts.
Références
- Berthou A. 2020, Quelle alimentation pendant le Coronavirus (Covid-19) ?; La santé par la nutrition.
- Richter T, Munch G, Luth HJ, Arendt T, R Kientsch-Engel, Stahl P, Fengler D, Kuhla B. Réactivité Immunochimique d’anticorps Spécifiques de “Produits de Glycation Avancée” Avec Des “Produits de Lipoxydation Avancés.” 2005, Neurobiol vieillissement, 26(4):465-74.
- Bhaskaran, K.; Dos-Santos Silva, I. ; Leon, D.A. ; Douglas, I.J. ; Smeeth , L. Association of BMI with Overall and Cause-Specific Mortality: A Population-Based Cohort Study of 3·6 Million Adults in the UK. Lancet Diabetes Endocrinol 2018,6(12),944–953. undefined(18)30288-2.
- Christ, A.; Lauterbach, M.; Latz, E. Western Diet and the Immune System: An Inflammatory Connection. Immunity 2019, 51 (5), 794–811. undefined
- Philip C. Calder, Anitra C. Carr, Adrian F. Gombart and Manfred Eggersdorfer; Optimal Nutritional Status for a Well-Functioning Immune System is an Important Factor to Protect Against Viral infections. Nutrients2020, 12, 1181; doi:10.3390/nu12041181
- Mehta, P.; Mc Auley, D.F.; Brown, M.; Sanchez, E.; Tattersall, R.S.; Manson, J.J. Covid-19: Consider Cytokine Storm Syndromes and Immunosuppression. The Lancet 2020, 0(0). undefined(20)30628-0.
- Carr, A.C.; Maggini, S. Vitamin C and immune function. Nutrients 2017, 9, 1211. [CrossRef]
- Gombart, A.F.; Pierre, A.; Maggini, S. A review of micronutrients and the immune system–working inharmony to reduce the risk of infection. Nutrients 2020, 12, 236. [CrossRef]
- Hemilä, H.; Louhiala, P. Vitamin C for preventing and treating pneumonia. Cochrane Database Syst. Rev. 2013. [CrossRef] [PubMed]
- Gombart, A.F. The vitamin D–antimicrobial peptide pathway and its role in protection against infection. Future Microbiol. 2009, 4, 1151. [CrossRef]
- Greiller, C.; Martineau, A. Modulation of the immune response to respiratory viruses by vitamin D. Nutrients 2015, 7, 4240–4270. [CrossRef] [PubMed]
- Malcolm B., Lowry Chunxiao Guo, Yang Zhang, Mary L. Fantacone, Isabelle Logan, Yan Campbell, Weijian Zhang, Mai Le, Arup K. Indra, Gitali Ganguli-Indra, Jingwei Xie, Richard L. Gallo, H. Phillip Koeffler, Adrian F. Gombart. A mouse model for vitamin D-induced human cathelicidin antimicrobial peptide gene expression The Journal of Steroid Biochemistry and Molecular Biology, Vol. 198, April 2020, 105552 undefined
- Vitamin D deficiency in Ireland – implications for COVID-19. Results from The Irish Longitudinal Study on Ageing (TILDA) Eamon Laird & Rose Anne Kenny April 2020. ©The Irish Longitudinal Study on Ageing Trinity College Dublin 2020. undefined
- Cannell, J.J.; Vieth, R.; Umhau, J.C.; Holick, M.F.; Grant, W.B.; Madronich, S.; Garland, C.F.; Giovannucci, E. Epidemic influenza and vitamin D. Epidemiol. Infect. 2006, 134, 1129–1140. [CrossRef]
- Jolliffe, D.A.; Griffiths, C.J.; Martineau, A.R. Vitamin D in the prevention of acute respiratory infection: Systematic review of clinical studies. J. Steroid Biochem. Mol. Biol. 2013, 136, 321–329. [CrossRef]
- Martineau, A.R.; Jolliffe, D.A.; Hooper, R.L.; Greenberg, L.; Aloia, J.F.; Bergman, P.; Dubnov-Raz, G.; Esposito, S.; Ganmaa, D.; Ginde, A.A.; et al. Vitamin D supplementation to prevent acute respiratory tract infections: Systematic review and meta-analysis of individual participant data. BMJ 2017, 356, i6583. [CrossRef]
- Autier, P.; Mullie, P.; Macacu, A.; Dragomir, M.; Boniol,M.; Coppens,K.; Pizot,C.; Boniol,M. Effect of vitamin D supplementation on non-skeletal disorders: A systematic review of meta-analysis and randomised trials. Lancet Diabetes Endocrinol. 2017, 5, 986–1004. [CrossRef]
- Martineau, A.R.; Jolli e, D.A.; Greenberg, L.; Aloia, J.F.; Bergman, P.; Dubnov-Raz, G.; Esposito, S.; Ganmaa, D.; Ginde, A.A.; Goodall, E.C.; et al. Vitamin D supplementation to prevent acute respiratory infections: Individual participant data meta-analysis. Health Technol. Assess2019, 23, 1–44. [CrossRef]
- Rejnmark, L.; Bislev, L.S.; Cashman, K.D.; Eiríksdottir, G.; Gaksch, M.; Grübler, M.; Grimnes, G.; Gudnason, V.; Lips, P.; Pilz, S.; et al. Non-skeletal health effects of vitamin D supplementation: A systematic review on findings from meta-analyses summarizing trial data. PLoS ONE 2017, 12, e0180512. [CrossRef]
- Bergman, P.; Lindh, Å.U.; Björkhem-Bergman, L.; Lindh, J.D. Vitamin D and respiratory tract infections: A systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials. PLoS ONE 2013, 8, e65835. [CrossRef]
- Charan, J.; Goyal, J.P.; Saxena, D.; Yadav, P. Vitamin D for prevention of respiratory tract infections: A systematic review and meta-analysis. J. Pharmacol. Pharmacother. 2012, 3, 300. [CrossRef]
- Malcolm B., Lowry Chunxiao Guo, Yang Zhang, Mary L. Fantacone, Isabelle Logan, Yan Campbell, Weijian Zhang, Mai Le, Arup K. Indra, Gitali Ganguli-Indra, Jingwei Xie, Richard L. Gallo,H. Phillip Koeffler, Adrian F. Gombart. A mouse model for vitamin D-induced human cathelicidin antimicrobial peptide gene expression The Journal of Steroid Biochemistry and Molecular Biology, Vol. 198, April 2020, 105552undefined
- Calder, P.C. Omega-3 polyunsaturated fatty acids and inflammatory processes: Nutrition or pharmacology? Omega-3 fatty acids and inflammation. Br. J. Clin. Pharmacol. 2012, 75, 645–662. [CrossRef]
- Basil, M.C.; Levy, B.D. Specialized pro-resolving mediators: Endogenous regulators of infection and inflammation. Nat. Rev. Immunol. 2016, 16, 51–67. [CrossRef][PubMed]
- Pedersen, S.F.; Ho, Y.-C. SARS-CoV-2: A Storm is Raging. J. Clin. Investig. 2020.[CrossRef]
- Gao, Y.; Zhang, H.; Luo, L.; Lin, J.; Li, D.; Zheng, S.; Huang, H.; Yan, S.; Yang, J.; Hao, Y.; et al. Resolvin D1 improves the resolution of inflammation via activating NF-κB p50/p50–mediated cyclo oxygenase-2 expression in acute respiratory distress syndrome. J. Immunol. 2017, 199, 2043–2054. [CrossRef]
- Zhang, H.-W.; Wang, Q.; Mei, H.-X.; Zheng, S.-X.; Ali, A.M.; Wu, Q.-X.; Ye, Y.; Xu, H.-R. ; Xiang, S.-Y.; Jin, S.-W. RvD1amelioratesLPS-induced acute lung injury via the suppression of neutrophil infiltration by reducing CXCL2 expression and release from resident alveolar macrophages. Int. Immunopharmacol. 2019,76,105877. [CrossRef]
- Dushianthan, A.; Cusack, R.; Burgess, V.A.; Grocott, M.P.; Calder, P.C. Immunonutrition for acute respiratory distress syndrome (ARDS) in adults. Cochrane Database Syst. Rev. 2019. [CrossRef]
- Deepak L. Bhatt, M.D., M.P.H., P. Gabriel Steg, M.D., Michael Miller, M.D., Eliot A. Brinton, M.D., Terry A. Jacobson, M.D., Steven B. Ketchum, Ph.D., Ralph T. Doyle, Jr., B.A., Rebecca A. Juliano, Ph.D., LixiaJiao, Ph.D., Craig Granowitz, M.D., Ph.D., Jean-Claude Tardif, M.D., and Christie M. Ballantyne, M.D. Cardiovascular Risk Reduction with Icosapent Ethyl for Hypertriglyceridemia. The new england journal of medicine, 2019 vol. 380 no. 1, 11-22.
- Gammoh, N.Z.; Rink, L. Zinc in infection and inflammation. Nutrients 2017, 9, 624. [CrossRef]
- Maares, M.; Haase, H. Zinc and immunity: An essential interrelation. Arch. Biochem. Biophys. 2016, 611, 58–65. [CrossRef]
- Aggarwal, R.; Sentz, J.; Miller, M.A. Role of zinc administration in prevention of childhood diarrhea and respiratory illnesses: A meta-analysis. Pediatrics 2007, 119, 1120–1130. [CrossRef]
- Roth, D.E.; Richard, S.A.; Black, R.E. Zinc supplementation for the prevention of acute lower respiratory infection in children in developing countries: Meta-analysis and meta-regression of randomized trials. Int. J. Epidemiol. 2010, 39, 795–808. [CrossRef]
- Food and Agriculture Organization of the United Nations. Europe and Central Asia Regional Overview of Food Insecurity 2016: The Food Insecurity Transition; FAO: Budapest, Hungary, 2017; pp. 1–44.
- Maggini, S.; Pierre, A.; Calder, P. Immune function and micronutrient requirements change over the life course. Nutrients2018, 10, 1531. [CrossRef]
- Bailey, R.L.; West, K.P., Jr.; Black, R.E. The epidemiology of global micronutrient deficiencies. Ann. Nutr. Metab.2015, 66, 22–33. [CrossRef] [PubMed]
- World Health Organization; U.S. Centers for Disease Control and Prevention. Worldwide Prevalence of Anaemia1993–2005: WHO Global Database of Anaemia; WHO: Geneva, Switzerland, 2008; pp. 1–41.
- World Health Organization. The World Health Report 2002: Reducing Risks, Promoting Healthy Life; WHO: Geneva, Switzerland, 2002; pp. 1–248.
- Hilger, J.; Friedel, A.; Herr, R.; Rausch, T.; Roos, F.; Wahl, D.A.; Pierroz, D.D.; Weber, P.; Homann, K.A systematic review of vitamin D status in populations worldwide. Br. J. Nutr. 2014, 111, 23–45. [CrossRef][PubMed]
- S. Institute of Medicine. Dietary Reference Intakes for Calcium and Vitamin D; National Academies Press: Washington, DC, USA, 2011.
- US Centers for Disease Control and Prevention. Second National Report on Biochemical Indicators of Diet and Nutrition in the U.S. Population; CDC: Atlanta, GA, USA, 2012; pp. 1–484.
- Cashman, K.D.; Dowling, K.G.; Skrabakova, Z.; Gonzalez-Gross, M.; Valtuena, J.; De Henauw, S.; Moreno, L.; Damsgaard, C.T.; Michaelsen, K.F.; Molgaard, C.; et al. Vitamin D deficiency in Europe: Pandemic? Am. J.Clin. Nutr. 2016, 103, 1033–1044. [CrossRef] [PubMed]
- Hu, Y.; Chen, J.; Wang, R.; Li, M.; Yun, C.; Li,W.; Yang, Y.; Piao, J.; Yang, X.; Yang, L. Vitamin D nutritional status and its related factors for Chinese children and adolescents in 2010–2012. Nutrients2017, 9, 1024. [CrossRef] [PubMed]
- Yun, C.; Chen, J.; He, Y.; Mao, D.; Wang, R.; Zhang, Y.; Yang, C.; Piao, J.; Yang, X. Vitamin D deficiency prevalence and risk factors among pregnant Chinese women. Public HealthNutr. 2017, 20, 1746–1754. [CrossRef]
- Peter, S.; Friedel, A.; Roos, F.F.; Wyss, A.; Eggersdorfer, M.; Ho_mann, K.; Weber, P. A systematic review of global alpha-tocopherol status as assessed by nutritional intake levels and blood serum concentrations. Int. J. Vitam. Nutr. Res. 2016, 14, 261–281. [CrossRef]
- Lykkesfeldt, J.; Poulsen, H.E. Is vitamin C supplementation beneficial? Lessons learned from randomized controlled trials. Br. J. Nutr. 2010, 103, 1251–1259. [CrossRef]
- García, O.; Ronquillo, D.; del Caamaño, M.; Camacho, M.; Long, K.; Rosado, J.L. Zinc, vitamin A, and vitamin C status are associated with leptin concentrations and obesity in Mexican women: Results from across-sectional study. Nutr. Metab. 2012, 9, 59. [CrossRef]
- Pearson, J.; Pullar, J.; Wilson, R.; Spittlehouse, J.; Vissers, M.; Skidmore, P.; Willis, J.; Cameron, V.; Carr, A. Vitamin C status correlates with markers of metabolic and cognitive health in 50-year-olds: Findings of the CHALICE cohort study. Nutrients 2017, 9, 831. [CrossRef]
- Villalpando, S.; Montalvo-Velarde, I.; Zambrano, N.; Carcia-Guerra, A.; Ramirez-Silva,C.I.; Shamah-Levy, T.; Rivera, J.A. Vitamin A, and C and folate status in Mexican children under 12 years and women 12–49 years: A probabilistic national survey. Salud Publica Mex. 2003, 45, S508–S519. [CrossRef]
- Bird, J.; Murphy, R.; Ciappio, E.; McBurney, M. Risk of deficiency in multiple concurrent micronutrients in children and adults in the United States. Nutrients 2017, 9, 655. [CrossRef]
- Stoffaneller, R.; Morse, N. Are view of dietary selenium intake and selenium status in Europe and the Middle East. Nutrients 2015, 7, 1494–1537. [CrossRef]
- Stark, K. D.; Van Elswyk, M.E.; Higgins, M.R.; Weatherford, C.A.; Salem, N. Global survey of the omega-3 fatty acids, docosahexaenoic acid and icosapent aenoic acid in the blood stream of healthy adults. Prog. Lipid Res. 2016, 63, 132–152. [CrossRef][PubMed]
- « for his discoveries in connection with the biological combustion processes, with special reference to vitamin C and the catalysis of fumaric acid » Personnel de rédaction, « The Nobel Prize in Physiology or Medicine 1937 », Fondation Nobel, 2010.
- Données établies par le Département de l’Agriculture des États-Unis, « USDA Data base for the Flavonoïd Content of Selected Foods ».
- Formica JV, Regelson W (1995). « Review of the biology of Quercetin and related bioflavonoids ». Food and Chemical Toxicology, 33(12): 1061-1080.
- Wiliams RJ, Spencer JP, Rice-Evans C (Apr 2004). « Flavonoids: antioxidants or signaling molecules? ». (Review). Free Radical Biology & Medicine. 36(7): 838-849.
- Russo GL, Russo M, Spagnuolo C, Tedesco I, Bilotto S, Iannitti R, Palumbo R (2014), « Quercetin: a pleiotropic kinase inhibitor against cancer ». Cancer Treatment and Research, 159: 185-205.
- Yoshimoto T, Furukawa M, et al. Flavonoids: potent inhibitors of arachidonate 5-lipoxygenase. Biochem Biophys Res Commun 1983 Oct. 31 ;116(2) :612-618.
- Thorhill SM, Kelly AM. Natural treatment of perennial allergic rhinitis. Altern Med Rev. 2000 oct ;5(5) :448-54. Review.
- Besedovsky, L.; Lange, T.; Haack, M. The Sleep-Immune Crosstalk in Health and Disease. Physiol. Rev. 2019, 99 (3), 1325–1380. undefined
- Ali, T.; Choe, J.; Awab, A.; Wagener, T. L.; Orr, W. C. Sleep, Immunity and Inflammation in Gastrointestinal. Disorders. World J. Gastroenterol. 2013,19(48),9231–39. undefined
- Qazi, T.; Farraye, F. A. Sleep and Inflammatory Bowel Disease: An Important Bi-Directional Relationship. Inflamm. Bowel Dis. 2019, 25 (5), 843–852. undefined
- Lange, T.; Dimitrov, S.; Born, J. Effects of Sleep and Circadian Rhythm on the Human Immune System. Ann. N.Y. Acad. Sci. 2010, 1193, 48–59. undefined
- Schmidt, M. H. The Energy Allocation Function of Sleep: A Unifying Theory of Sleep, Torpor, and Continuous Wakefulness. Neurosci Biobehav Rev 2014, 47, 122–153. undefined
- Piercy, K. L.; Troiano, R. P.; Ballard, R. M.; Carlson, S. A.; Fulton, J. E.; Galuska, D. A.; George, S. M.; Olson, R. D. The Physical Activity Guidelines for Americans. JAMA 2018, 320 (19), 2020–2028. undefined
- Luan, X.; Tian, X.; Zhang, H.; Huang, R.; Li, N.; Chen, P.; Wang, R. Exercise as a Prescription for Patients with Various Diseases. J Sport Health Sci2019, 8 (5), 422–441. undefined
- Weyh, C.; Krüger, K.; Strasser, B. Physical Activity and Diet Shape the Immune System during Aging. Nutrients2020, 12 (3). undefined
- L’impact du sport sur le système immunitaire.
- Chen, P.; Mao, L.; Nassis, G. P.; Harmer, P.; Ainsworth, B. E.; Li, F. Wuhan Coronavirus (2019-NCoV): The Need to Maintain Regular Physical Activity While Taking Precautions. J Sport Health Sci2020, 9 (2), 103–104.undefined
- Asthma and Atopic Diseases. Clin. Exp. Allergy 2002, 32 (2), 256–263.
- Heffner, K. L.; Kiecolt-Glaser, J. K.; Glaser, R.; Malarkey, W. B.; Marshall, G. D. Stress and Anxiety Effects on Positive Skin Test Responses in Young Adults with Allergic Rhinitis. Ann. Allergy Asthma Immunol. 2014, 113 (1), 13–18. undefined
- Luo, H.; Wei, J.; Yasin, Y.; Wu, S. J.; Barszczyk, A.; Feng, Z.-P.; Lee, K. Stress Determined through Heart Rate Variability Predicts Immune Function. Neuroimmunomodulation2019, 26 (4), 167–173. undefined
- Stover, C. M. Mechanisms of Stress-Mediated Modulation of Upper and Lower Respiratory Tract Infections. Adv. Exp. Med. Biol. 2016, 874, 215–223. undefined
- Turner-Cobb, J. M.; Rixon, L.; Jessop, D. S. Hypothalamic-Pituitary-Adrenal Axis Activity and Upper Respiratory Tract Infection in Young Children Transitioning to Primary School. Psychopharmacology (Berl.) 2011, 214 (1), 309–317. undefined
- Turner-Cobb, J. M.; Rixon, L.; Jessop, D. S. Hypothalamic-Pituitary-Adrenal Axis Activity and Upper Respiratory Tract Infection in Young Children Transitioning to Primary School. Psychopharmacology (Berl.) 2011, 214 (1), 309–317.undefined
- Wieduwild, E.; Girard-Madoux, M. J.; Quatrini, L.; Laprie, C.; Chasson, L.; Rossignol, R.; Bernat, C.; Guia, S.; Ugolini, S. Β2-Adrenergic Signals Downregulate the Innate Immune Response and Reduce Host Resistance to Viral Infection. J. Exp. Med. 2020, 217 (4). undefined
- Cohen, S.; Alper, C. M.; Doyle, W. J.; Treanor, J. J.; Turner, R. B. Positive Emotional Style Predicts Resistance toIllness after Experimental Exposure to Rhinovirus or Influenza a Virus. Psychosom Med 2006, 68 (6), 809–815 undefined
- Zgierska, A.; Obasi, C. N.; Brown, R.; Ewers, T.; Muller, D.; Gassman, M.; Barlow, S.; Barrett, B. Randomized Controlled Trial of Mindfulness Meditation and Exercise for the Prevention of Acute Respiratory Infection: Possible Mechanisms of Action. Evid Based Complement Alternat Med 2013, 952716.undefined
- Lippi, G.; Henry, B. M. Active Smoking Is Not Associated with Severity of Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) Eur. J. Intern. Med. 2020.undefined
- Leclerf JM. Objectifs Nutrition. Les compléments alimentaires : intérêts nutritionnels et limites d’utilisation2006, N°81, 3-9. La lettre de l’Institut Danone.
1Médiateurs Spécialisés de la résolution (ou SPM en anglais pour Specialized Pro-resolving mediators) NDLR
Reconstruction de l’ulna sur maladie exostosante par hémi-fibula non vascularisée
Les auteurs rapportent un cas de fracture de l’ulna sur maladie exostosante survenue chez une patiente de 14 ans. Le traitement a consisté, une année après le traumatisme, en une mise en place en deuxième intention d’une greffe par hémi-fibula libre, non vascularisée, après échec d’une tentative de traitement orthopédique, et d’une mise en place d’un fixateur externe.
M. Yakoubi, Service de Chirurgie Orthopédique et Traumatologique. Faculté de médecine d’Alger. EHS Abdelkader Boukhroufa, Ben Aknoun. Alger.
Date de soumission : 06 Juin 2020.
Résumé : Les auteurs rapportent un cas de fracture de l’ulna sur maladie exostosante survenue chez une patiente de 14 ans. Le traitement a consisté, une année après le traumatisme, en une mise en place en deuxième intention d’une greffe par hémi-fibula libre, non vascularisée, après échec d’une tentative de traitement orthopédique, et d’une mise en place d’un fixateur externe. L’évolution a été marquée par une consolidation au 4ème mois post-opératoire, du greffon avec une bonne intégration et une récupération fonctionnelle satisfaisante. La rareté de cette affection génétique ainsi que le choix de la méthode thérapeutique ont conduit les auteurs à publier ce cas clinique.
Mots clés : fracture de l’ulna, maladie exostosante, hémi-fibula libre non vascularisée.
Abstract: The authors report a case of ulnar fracture due to exostating disease, which occurred in a 14-year-old patient. Treatment consisted a year after the trauma of a second-line setting up of a free not vascularized half of the fibula graft after an attempt at orthopaedic treatment and an external fixator failed. The evolution was marked by a consolidation in the 4th post-operative month of the graft with good integration and satisfactory functional recovery. The rarity of this genetic condition as well as the choice of therapeutic method led the authors to publish this clinical case.
Key words: ulna fracture, exostosing disease, free not vascularized half of the fibula graft.
Introduction
L’OMS a classé la maladie exostosante dans les tumeurs bénignes à double contingent osseux et cartilagineux. Plusieurs synonymes lui ont été attribués : exostose héréditaire ou maladie de Bessel-Hagen pour les formes multiples. C’est une maladie à transmission autosomique dominante caractérisée par la survenue de tumeurs osseuses métaphysaires recouvertes de cartilage. Ces tumeurs siègent le plus souvent au niveau des membres. La complication majeure est leur possible dégénérescence, notamment en ostéochondrosarcome.
Nous rapportons un cas clinique de fracture de l’ulna déformée, et de constitution “fine” chez une patiente de 14 ans porteuse d’une maladie exostosante. Le traitement a consisté en première intention en une immobilisation plâtrée pendant 6 mois, devant ce premier échec, un fixateur externe a été mis pour une durée de 6 mois, n’ayant pas abouti à la consolidation, une reconstruction par greffe de fibula libre non vascularisée a été préconisée aboutissant à la consolidation au bout du 4ème mois post-opératoire et une récupération fonctionnelle satisfaisante.
Observation
Patiente âgée de 14 ans, atteinte d’une maladie exostosante, a consulté pour prise en charge d’un ancien traumatisme de l’avant-bras gauche. Ses antécédents se résumaient sur le plan familial, le grand-père, le père et une sœur étaient également atteints. Les anomalies morphologiques osseuses multiples de notre patiente étaient apparues vers l’âge de 6 ans et s’étaient stabilisées vers l’âge de 12 ans. A cet âge, d’après les parents, elle a bénéficié d’une intervention chirurgicale à type d’allongement progressif de l’ulna gauche par mise en place d’un fixateur externe. Ce traitement a duré 6 mois. Ce qui explique, en plus de son incurvation, l’aspect effilé de l’ulna.
Suite à une chute de sa hauteur il y a une année, après avoir glissé dans la piscine, elle fait un traumatisme de l’avant-bras gauche ayant engendré une fracture isolée de l’ulna peu déplacée sur un os grêle et incurvé. Elle fut traitée par une simple attelle plâtrée ; 6 mois après, elle n’a toujours pas consolidé. Puis un fixateur externe a été mis pour 6 mois encore sans résultats.
A l’examen clinique, on note un léger gonflement au niveau de la partie moyenne de l’avant-bras avec une légère douleur à la palpation de cette région. La mobilité du coude était normale (0-0-140), le poignet était mobile avec 50° de flexion et 40° d’extension et une pro-supination à 60/0/40 mais qui reste douloureuse aux positions extrêmes. Par ailleurs, il n’y a aucun signe clinique ni biologique d’infection.
La radiographie de l’avant-bras gauche a montré un avant-bras déformé avec une ulna raccourcie, incurvée et grêle à sa partie centrale, et en son sein il existe une fracture non consolidée. Cette partie effilée de l’ulna correspond au cal osseux obtenu dans l’intervention d’allongement réalisée à l’âge de 12 ans (Figure 1).
En raison des dimensions importantes de la perte de substance osseuse par cet aspect effilé de la quasi-totalité de la diaphyse ulnaire, qui même consolidée reste menacée de fracture, nous avons réalisé une reconstruction par hémi-fibula libre, le prélèvement a été réalisé en intrapériosté et la synthèse a fait appel à une fixation du greffon par deux vis de part et d’autre (Figure 2). La consolidation des deux foyers a été obtenue au 4ème mois post-opératoire, avec une bonne incorporation du greffon, avec une récupération d’une bonne fonction, avec une nette amélioration de la pro-supination 70-0-90 (Figure 3).
Figure 1 : Radiographie de l’avant-bras gauche montrant la fracture du radius sur une ulna effilée et déformée.
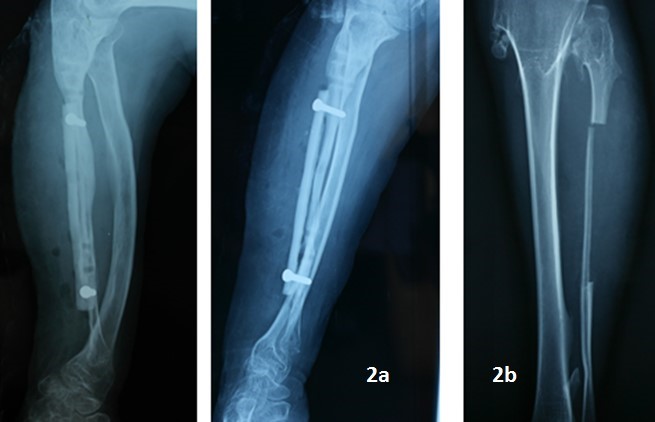
Figure 2 : 2a/ Radiographie de l’avant-bras après reconstruction par hémi-fibula non vascularisée. 2b/ Site du prélèvement de l’hémi-fibula.

Figure 3 : Aspects radio-cliniques au 4e mois post-opératoire. Montrant une bonne intégration du greffon et une pro-supination satisfaisante.
Discussion
Les premières descriptions cliniques de la maladie exostosante ont été proposées par John Hunter en 1786 [1], puis par Boyer en 1814 [2].
Cette affection héréditaire est rare, secondaire à trois mutations chromosomiques dont la transmission est autosomique dominante [3]. Un antécédent familial est retrouvé dans deux tiers des cas. Elle se rencontre deux fois plus souvent chez l’homme que chez la femme. Elle peut concerner tout le squelette. Les sièges les plus habituellement atteints avec retentissement sur la croissance sont surtout les articulations du poignet, du genou et de la cheville [4]. L’abstention thérapeutique et la surveillance stricte sont de rigueur.
La résection chirurgicale de ces tumeurs s’imposer lorsque celles-ci sont volumineuses, inesthétiques, augmentent de taille faisant redouter une dégénérescence ou lorsqu’elles sont à l’origine de complications comme la compression des axes vasculo-nerveux par effet de masse [5].
Il faut savoir que le risque de dégénérescence maligne chez l’adulte, exceptionnelle avant l’âge de 20 ans est nettement plus élevé, en particulier dans les formes sévères et aux ceintures. Cette transformation maligne est évaluée à 2 à 5 % des patients, mais la plus redoutable [6, 7], et il s’agit le plus souvent d’ostéochondrosarcome de bas grade. Les progrès de la génétique vont permettre dans le futur l’identification précoce des formes graves au plan fonctionnel et à risque carcinologique.
La déformation de l’avant-bras, comme c’est le cas de notre patiente, est l’un des aspects cliniques les plus fréquents [8, 9]. La brièveté de l’ulna s’explique par le fait que sa croissance est essentiellement sous la dépendance du cartilage distal qui est le plus souvent atteint.
Chez notre patiente, une intervention chirurgicale a été réalisée à l’âge de 12 ans pour allonger l’ulna. En effet, une cal a été formé, mais hélas très fin ce qui a été à l’origine de la fracture. Vu que la fracture n’a pas consolidée après une année d’évolution et vu également l’état de la diaphyse ulnaire dont l’os est grêle, une reconstruction par un segment osseux s’impose. Les méthodes conventionnelles de greffes osseuses (crête iliaque) n’ont aucune place dans la restitution de la longueur et la forme diaphysaire de l’os et peuvent même compromettre d’avantage sa solidité. Dans le cas des deux os de l’avant-bras, le but de la reconstruction n’est pas seulement de combler la perte de substance, mais, il est également plus que nécessaire de reproduire la forme ainsi que la longueur de l’axe antébrachial afin de lui redonner sa fonction qui est la pro-supination indispensable dans la fonction de préhension de la main. La diaphyse fibulaire trouve une place raisonnable dans la reconstruction des pertes de substance osseuses des deux os de l’avant-bras notamment de l’ulna [10, 11]. Elle constitue un moyen biologique, fiable et accessible [12]. Cette greffe autologue doit être à la fois ostéogénique, ostéo-conductrice et ostéo-inductrice. Elle a aussi l’avantage de reproduire l’anatomie de l’ulna par sa nette ressemblance morphologique. La morbidité au niveau du site donneur reste minime. Bien que cette hémi-diaphyse n’était pas vascularisée (fibula tuteur), elle a permis quand même une consolidation des deux foyers en un temps record (4 mois), par le phénomène de « creeping substitution » et restituant ainsi une pro-supination satisfaisante dans un secteur utile. Cela peut s’expliquer par l’abord sous périosté de l’ulna conservant ainsi le fourreau périosté utile à la consolidation et au remodelage, et l’âge jeune de la patiente avec un fort potentiel de formation de cal en plus du bon état vasculaire et trophique du site receveur.
Conclusion
La maladie exostosante est une pathologie héréditaire rare et dont le diagnostic doit être précoce. Elle est à l’origine des déformations osseuses qui peuvent être le siège de traumatisme, donc de fractures. La survenue d’une fracture sur un os déformé et fragile comme dans le cas de cette jeune patiente complique le traitement et par voie de conséquence entrave la fonction du membre traumatisé. La reconstruction par hémi-fibula non vascularisée d’une diaphyse ulnaire fracturée sur un os déformé et fragile trouve sa place dans l’arsenal thérapeutique permettant de redonner une anatomie acceptable et une fonction satisfaisante.
Références
- Hunter J. The works of John Hunter London: F.R.S (1835).
- Boyer A. Traité de maladies chirurgicales. Ve Migneret. Paris 1814.
- Vanhoenacker F.M., Van Hul W., Wuyts W., Willems P.J., De Schepper A.M. Hereditary multiple exostoses: from genetics to clinical syndrome and complications Eur J Radiol. 2001; 40: 208-217.
- Schmale G.A., Conrad E.U., Raskind W.H. The natural history of hereditary multiple exostoses J Bone Joint Surg Am 1994; 76: 986-992.
- Ostrowski M, McEnery K.—Cartilaginous lesions of the skeleton. Am J Clin Pathol., 2002, 117, S3-S25
- Kivioja A., Ervasti H., Kinnunen J., Kaitila I., Wolf M., Böhling T. Chondrosarcoma in a family with multiple hereditary exostoses J Bone Joint Surg Br 2000; 82-B: 261-266.
- Schaison F., Anract P., Coste F., De Pinieux G., Forest M., Toméno B. Chondrosarcomes secondaires à des maladies cartilagineuses multiples Rev Chir Orthop 1999 ; 85 : 834-845.
- Burgess RC &Cates H – Deformities of the forearm in patients who have multiple cartilaginous exostosis. J Bone Joint Surg Am, 1993, 75, 13-18.
- Peterson HA – Deformities and problems of the forearm in children with multiple hereditary osteochondroma. J Pediat Orthop, 1994, 14, 92-100.
- Mathoulin Ch, Gilbert A, Judet H, Judet Th, Siguier M, Brumpt P. Transfert libre de péroné vascularisé dans les pseudarthroses et pertes de substance fémorale. RevChirOrthop1993 ;79 :492-9.
- Roussignol X, Polle G, Rigal F, Tripon Ph, Lecestre P, Dreano T et al. Pertes de substance osseuse traumatiques des diaphyses. Ann orthop ouest 2005 ; 37 :153-78.
- Allieu Y, Teissier J, Bonnel F. Étude expérimentale du comportement biologique d’une greffe osseuse corticale vascularisée et problèmes mécaniques. RevChirOrthop1983; Suppl 2, 69.
Iconographie : Collection personnelle de l’auteur
Liens d’intérêts : Les auteurs déclarent ne pas avoir de liens d’intérêts.
Rôle du microbiote sur le tissu osseux
Il est aujourd’hui admis que le microbiote interagit de manière réciproque avec les systèmes digestifs, immunitaire, endocrinien et nerveux. Et est ainsi impliqué dans de nombreux processus physiopathologiques souvent liés à une réponse inflammatoire.
S. Abdellaoui, A. Boukabous, B. Bengana, S. Lefkir-Tafiani, Service de Rhumatologie, CHU Issaad Hassani, Beni Messous, Alger.
Date de soumission : 15 Mai 2020.
Résumé : Il est aujourd’hui admis que le microbiote interagit de manière réciproque avec les systèmes digestifs, immunitaire, endocrinien et nerveux. Et est ainsi impliqué dans de nombreux processus physiopathologiques souvent liés à une réponse inflammatoire. Ces dernières années ont été marquées par la mise en évidence de l’effet osseux du microbiote sur la régulation et le développement de pathologies osseuses comme l’ostéoporose et les rhumatismes inflammatoires chroniques avec diminution de la densité osseuse. L’influence du microbiote sur l’os implique des mécanismes complexes tels que la modulation de l’activation des lymphocytes T CD4+, le contrôle de la production de cytokines ostéoclastogéniques ainsi que des changements hormonaux. Complexité qui s’entrevoit au travers de résultats d’études, discordants en fonction de l’âge, du sexe, de l’environnement génétique et de la durée des traitements. Une meilleure compréhension du microbiote et de ses mécanismes est donc nécessaire, eu égard les perspectives actuelles très prometteuses sur la manipulation du microbiote pour les pathologies osseuses.
Mots clés : microbiote, tissu osseux, différenciation des ostéoclastes, cellules Th17 activées.
Abstract: It is now recognized that the microbiota interacts with the digestive, immune, endocrine and nervous systems. And is thus involved in many pathophysiological processes often linked to an inflammatory response. The last few years have been marked by the demonstration of the bone effect of the microbiota on the regulation and development of bone pathologies such as osteoporosis and chronic inflammatory rheumatism with decrease in bone density. The influence of the microbiota on bone involves complex mechanisms such as modulating the activation of CD4 + T cells, controlling the production of osteoclastogenic cytokines as well as hormonal changes. Complexity that can be seen through discordant study results depending on age, sex, genetic environment and duration of treatment. A better understanding of the microbiota and its mechanisms is therefore necessary, given the very promising current perspectives on the manipulation of the microbiota for bone pathologies.
Key words: microbiota, bone tissue, osteoclast differentiation, Th17 activated cells.
Introduction
Le microbiote et ses 100.000 milliards de micro-organismes, est considéré de nos jours comme un organe à part entière, participant à la régulation des fonctions digestives. Il entretient un dialogue dynamique et permanent avec les cellules de l’hôte [1]. Il transforme des composants alimentaires complexes comme les fibres en métabolites assimilables tels que les acides gras à chaînes courtes [2]. La fonction du système immunitaire de la muqueuse intestinale est de maintenir une homéostasie entre antigènes alimentaires et microbiote commensal tout en protégeant des micro-organismes pathogènes. Ainsi, le microbiote régule le développement des cellules lymphoïdes, la polarisation des lymphocytes T en particulier les Th17 dans l’intestin, et la production de cytokines [3]. Le microbiote change de composition et de diversité microbienne au cours de la vie, il varie en fonction de l’âge, de facteurs génétiques, du régime alimentaire, de la prise médicamenteuse ou du statut immunitaire de l’hôte. On appelle dysbiose, toute altération des interactions hôte/microbiote. Ce dernier ne joue alors plus son rôle de barrière intestinale et ne contrôle plus efficacement la dissémination des composants du microbiote dans les tissus. Ce qui aura pour conséquence une stimulation du système immunitaire pouvant conduire à de nombreuses maladies. La maladie de Crohn, le syndrome du côlon irritable, la maladie cœliaque, mais également à des pathologies systémiques telles que les maladies métaboliques, cardiovasculaires, neurodégénératives et les rhumatismes inflammatoires chroniques sont des exemples de dysbiose [4–6]. Grâce à ses effets sur le système immunitaire, le microbiote joue également un rôle majeur dans la régulation la densité osseuse.
Microbiote et interactions entre os/système immunitaire
En condition pathologique, le système immunitaire joue un rôle essentiel dans le contrôle de la densité osseuse. La principale cytokine intervenant dans la différenciation des ostéoclastes (OSC) est le Receptor activator of nuclear factor kappa-B ligand (RANKL). En conditions normales, elle est produite par les cellules mésenchymateuses, les ostéoblastes (OSB) et les ostéocytes, et en conditions inflammatoires, elle est également produite par les lymphocytes T CD4+ activés [7]. Les CD4+ produisent également d’autres cytokines comme l’interleukine IL17 et le tumor necrosis factor (TNF) qui stimulent aussi l’ostéoclastogénèse [8]. Dans la maladie de Crohn, l’interaction entre cellules Th17 et OSC a été mise en évidence. En effet, au cours des maladies inflammatoires intestinales, les cellules Th17 activées vont produire des quantités importantes de facteurs ostéoclastogéniques : RANKL, IL17 et TNF, entrainant ainsi une différenciation accrue des OSC [9]. Les cellules Th17 activées et leurs propriétés ostéoclastogéniques sont aussi présentes dans le sang de patients atteints de maladie de Crohn, ce qui pourrait expliquer la nette diminution de la densité osseuse très souvent retrouvée dans cette pathologie [9].
Effet anabolique du microbiote sur l’os
Les études sur les souris dépourvues de microbiote (souris axéniques) ont mis en évidence de nombreux changements métaboliques tels qu’une réduction de l’apport énergétique par la baisse de l’absorption de certains nutriments et vitamines, une diminution de la taille et du poids de nombreux organes [10]. Elle entraîne une immaturité des systèmes intestinal, immunitaire, endocrinien, nerveux et vasculaire interférant ainsi dans la régulation de la masse osseuse Figure 1 [11].
Figure 1 : Relation entre microbiote et tissu osseux
Une étude menée chez des souris axéniques mâles a montré une diminution des paramètres de croissance de l’os avec des fémurs plus courts que les contrôles [12]. Cela démontre l’effet anabolique du microbiote sur l’os [13]. Le contrôle de la production de l’insulin growth factor IGF1 par le microbiote est un des mécanismes pouvant expliquer cet effet anabolique [14]. Un autre facteur intéressant est la différence liée au sexe. Ce qui est en faveur de l’existence d’une interaction entre microbiote et hormones sexuelles, qui influenceraient et la composition du microbiote et la réponse de l’hôte au niveau osseux [15].
Microbiote et ostéoporose/rhumatismes inflammatoires chroniques
Le rôle du microbiote au cours l’ostéoporose par déficience en estrogènes a été analysé. À la ménopause, la baisse de la production d’estrogènes a pour conséquence une baisse densitométrique due à une diminution de la formation osseuse et à une augmentation de sa dégradation, et ceci d’une façon concomitante. Les patientes ménopausées avec ostéoporose ont une production plus élevée de RANKL et TNF par les lymphocytes T CD4+ circulants par rapport aux femmes en pré ou post-ménopause sans ostéoporose Figure 2[16].
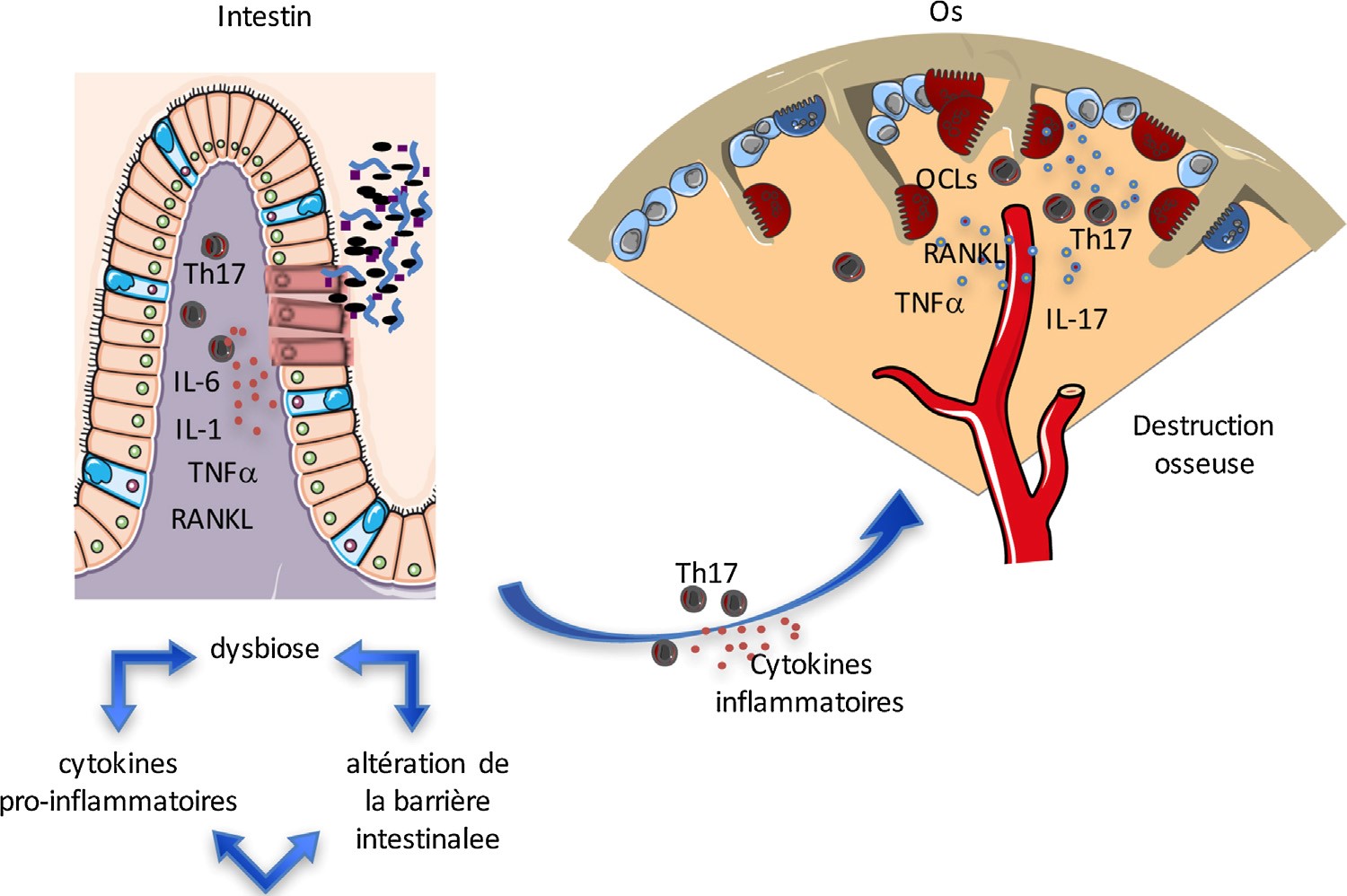
Figure 2 : Dysbiose et différenciation des ostéoclastes
Tout ceci pourrait suggérer un lien entre dysbiose et ostéoporose. En effet, une étude a révélé des modifications du microbiote entre témoins sains, patients ostéopéniques et patients ostéoporotiques [17], même si cette étude mériterait d’être confirmée par un plus grand nombre de patients. Le microbiote a aussi un rôle majeur dans les rhumatismes inflammatoires chroniques avec destruction osseuse. En effet, de nombreux travaux ont mis en évidence la présence d’une dysbiose intestinale chez les patients atteints de polyarthrite rhumatoïde ou de spondyloarthrite [18]. In vitro, l’administration de probiotiques chez les souris arthritiques protège de l’inflammation et la perte osseuse [19]. Lors de l’altération de la barrière intestinale indispensable aux interactions hôte/microbiote ou dysbiose, la dissémination des bactéries et des facteurs qu’elles produisent est facilitée [20]. L’altération est similaire dans les rhumatismes inflammatoires chroniques ou dans les déficiences en estrogènes [22]. Ce qui suggèrerait qu’ostéoporose et rhumatismes inflammatoires partageraient une composante immunitaire commune. Dans les deux situations, cette altération est associée à une activation des lymphocytes T CD4+ et à l’augmentation de production des cytokines ostéoclastogéniques IL-17, TNF, IL1, RANKL. Dans la maladie de Crohn, les lymphocytes Th17 sont capables de migrer vers la moelle osseuse et d’induire le recrutement de pré-OSC conduisant à une augmentation très marquée de l’ostéoclastogénèse [9].
Perspectives
La restauration d’un microbiote équilibré est une approche envisageable pour certaines pathologies. Le microbiote peut être modifié par un simple régime alimentaire ou par la supplémentation en prébiotiques. En stimulant les réponses anti-inflammatoires, ce “microbiote modifié” pourrait favoriser l’absorption intestinale du calcium, ce qui aura pour conséquence une augmentation densitométrique. Au delà de la modification du microbiote, il a été observé chez la souris que différentes souches de probiotiques tels que Lactobacillus et Bifidobacterium ont un effet anti-inflammatoire en stimulant l’absorption de la vitamine D et en diminuant la différenciation des OSC [23]. L’évaluation de l’effet des probiotiques chez l’homme est en cours dans de nombreux essais cliniques. Une autre approche est la transplantation de microbiote. Technique déjà utilisée dans les colites bactériennes à Clostidium résistantes aux antibiotiques [24] et dans le traitement des allogreffes dans les leucémies aiguës [25], quelques études cliniques sont en cours pour évaluer son efficacité dans les maladies rhumatismales.
Conclusion
Le microbiote intestinal joue un rôle primordial dans la régulation de la masse osseuse pendant la croissance physiologique et en conditions pathologiques. Ce microbiote peut agir en association avec d’autres facteurs tels que régime alimentaire, mode de vie, prédisposition génétique, traitement médicamenteux. Il peut aussi agir sur certaines réponses par la dissémination des bactéries, aboutissant à une activation des réactions inflammatoires dans les tissus et même jusque dans la moelle osseuse. Cependant, les mécanismes physiopathologiques sont complexes nécessitant pour être élucidés davantage de données. La manipulation du microbiote dans un but thérapeutique connaît un intérêt grandissant, et au vu des effets bénéfiques dans des modèles précliniques, cette approche ouvre des perspectives prometteuses pour le traitement des pathologies osseuses.
Liens d’intérêts : Les auteurs déclarent ne pas avoir de liens d’intérêts.
Références
- Marchesi J, Shanahan F. The normal intestinal microbiota. CurrOpin Infect Dis 2007;20:508–13.
- Topping DL, Clifton PM. Short-chain fatty acids and human colonic function: roles of resistant starch and non-starch polysaccharides. Physiol Rev 2001;81:1031–64.
- Gaboriau-Routhiau V, Rakotobe S, Lécuyer E, et al. The key role of segmented filamentous bacteria in the coordinated maturation of gut helper T cell responses. Immunity 2009;31:677–89.
- Hand TW, Vujkovic-Cvijin I, Ridaura VK, Belkaid Y. Linking the microbiota, chronic disease and the immune system. Trends Endocrinol Metab TEM 2016;27:831–43.
- Van de Wiele T, Van Praet JT, Marzorati M, Drennan MB, Elewaut D. How the microbiota shapes rheumatic diseases. Nat Rev Rheumatol 2016;12:398–411.
- Ni J, Wu GD, Albenberg L, Tomov VT. Gut microbiota and IBD: causation or correlation? Nat Rev Gastroenterol Hepatol 2017:14 [nrgastro.2017.88].
- Nakashima T, Hayashi M, Fukunaga T, et al. Evidence for osteocyte regulation of bone homeostasis through RANKL expression. Nat Med 2011;17:1231–4.
- Kotake S, Udagawa N, Takahashi N, et al. IL-17 in synovial fluids from patients with rheumatoid arthritis is a potent stimulator of osteoclastogenesis. J Clin Invest 1999;103:1345–52.
- Ciucci T, Ibánez L, Boucoiran A, et al. Bone marrow Th17 TNF cells induce osteoclast differentiation and link bone destruction to IBD. Gut 2015;64:1072–81.
- Wallace JG, Gohir W, Sloboda DM. The impact of early life gut colonization on metabolic and obesogenic outcomes: what have animal models shown us? J Dev Orig Health Dis 2016;7:15–24.
- Kennedy PJ, Cryan JF, Dinan TG, Clarke G. Kynurenine pathway metabolism and the microbiota gut brain axis. Neuropharmacology 2017;112:399–412.
- Schwarzer M, Makki K, Storelli G, et al. Lactobacillus plantarum strain maintains growth of infant mice during chronic undernutrition. Science 2016;351:854–7.
- Yan J, Herzog JW, Tsang K, et al. Gut microbiota induce IGF-1 and promote bone formation and growth. Proc Natl Acad Sci U S A 2016;113:E7554–63.
- Yakar S, Courtland H-W, Clemmons D. IGF-1 and bone: new discoveries from mouse models. J Bone Miner Res 2010;25:2543–52.
- Baker JM, Al-Nakkash L, Herbst-Kralovetz MM. Estrogen-gut microbiome axis: physiological and clinical implications. Maturitas 2017;103:45–53.
- D’Amelio P, Grimaldi A, Di Bella S, et al. Estrogen deficiency increases osteoclastogenes is up-regulating T cells activity: a key mechanism in osteoporosis. Bone 2008;43:92–100.
- Wang J, Wang Y, Gao W, et al. Diversity analysis of gut microbiota in osteoporosis and osteopenia patients. Peer J 2017;5:e3450.
- Breban M, Tap J, Leboime A, et al. Faecal microbiota study reveals specific dysbiosis in spondyloarthritis. Ann Rheum Dis 2017;76:1614–22.
- Amdekar S, Singh V, Singh R, Sharma P, Keshav P, Kumar A. Lactobacillus casei reduces the inflammatory joint damage associated with collagen-induced arthritis (CIA) by reducing the pro-inflammatory cytokines: Lactobacillus casei:COX-2 inhibitor. J Clin Immunol 2011;31:147–54.
- Burcelin R, Serino M, Chabo C, et al. Metagenome and metabolism: the tissue microbiota hypothesis. Diabetes Obes Metab 2013;15:61–70.
- Kerr SW, Wolyniec WW, Filipovic Z, et al. Repeated measurement of intestinal permeability as an assessment of colitis severity in HLA-B27 transgenic rats. J Pharmacol Exp Ther 1999;291:903–10.
- Ohlsson C, Engdahl C, Fåk F, et al. Probiotics protect mice from ovariectomy induced cortical bone loss. PloS One 2014;9:e92368.
- Parvaneh K, Ebrahimi M, Sabran MR, et al. Probiotics (Bifidobacterium longum) increase bone mass density and up regulate Sparc and Bmp-2 genes in rats with bone loss resulting from ovariectomy. Bio Med Res Int 2015;2015:1–10.
- Camarota G, Ianiro G, Gasbarrini A. Fecal microbiota transplantation for the treatment of Clostridium difficile infection: a systematic review. J Clin Gastroenterol 2014;48:693–702.
- Dougé A, Bay JO, Ravinet A, Scanzi J Intestinal microbiota and allograft of hematopoitic stem cells bulletin du cancer volume 107 issue 1 Jan 2020 pages 72 -83
Carcinome trichoblastique : à propos d’un cas
Le carcinome trichoblastique est une tumeur maligne d’origine pilaire rare, aussi appelée trichoblastome malin, présente une forte agressivité locale et un potentiel métastatique à distance, d’où la nécessité de faire un examen clinique soigneux à la recherche d’adénopathies locorégionales.
H. Aburabie1, S. Dikhaye1,2, N. Zizi1,2, G. Cherkaoui Belmaati3, A. Oufkir3, N. Karich4, A. Bennani4,
1 Service de dermatologie, CHU Mohamed VI d’Oujda, Faculté de Médecine et de Pharmacie d’Oujda, Université Mohammed Premier, Maroc.
2 Laboratoire d’épidémiologie de recherche clinique et de santé publique.
3 Service de chirurgie plastique et réparatrice, CHU Mohamed VI d’Oujda, Faculté de Médecine et de Pharmacie d’Oujda, Université Mohammed Premier, Maroc.
4 Service d’anatomopathologie, CHU Mohamed VI d’Oujda, Faculté de Médecine et de Pharmacie d’Oujda, Université Mohammed Premier, Maroc.
Date de soumission : 13 Mai 2020.
Résumé : Le carcinome trichoblastique est une tumeur maligne d’origine pilaire rare, aussi appelée trichoblastome malin, présente une forte agressivité locale et un potentiel métastatique à distance, d’où la nécessité de faire un examen clinique soigneux à la recherche d’adénopathies locorégionales et de réaliser un bilan d’extension paraclinique comprenant un scanner cervico-thoraco-abdomino-pelvien au moment du diagnostic. Le diagnostic est difficile, repose essentiellement sur l’histologie, le principal diagnostic différentiel se pose avec le carcinome basocellulaire. La prise en charge thérapeutique non consensuelle, repose essentiellement sur la chirurgie avec des marges suffisantes, et en cas de métastase d’autres alternatives thérapeutiques seront aussi utilisables comme la radiothérapie.
Mots clés : Carcinome annexiel, anatomopathologie, traitement.
Summary: Trichoblastic carcinoma is a rare malignant adnexal tumour, also called malignant trichoblastoma, has a strong local aggressiveness and a distant metastatic potential, therefore, careful clinical examination for locoregional lymphadenopathy is required and a paraclinical extension assessment including a cervico-thoraco-abdomino-pelvic CT-scan at the time of diagnosis. Its presentation is non-specific and the diagnosis is always histological, the main differential diagnosis is basal cell carcinoma. Therapeutic management is non-consensual, based primarily on surgery, for metastatic forms other therapeutic alternatives will also be used such as radiotherapy.
Keywords: Carcinoma, skin appendage, pathology, therapeutics.
Introduction
Le carcinome trichoblastique (CT) est une tumeur annexielle maligne rarement rapporté dans la littérature. Sa présentation n’est pas spécifique et le diagnostic est toujours histologique, il présente une forte agressivité locale et un potentiel métastatique à distance. Sa prise en charge n’est pas codifiée (1).
Nous rapportons le cas d’un carcinome trichoblastique chez une femme marocaine de 56 ans sans antécédent pathologiques particuliers.
Observation
C’est une femme âgée de 56 ans, sans antécédents pathologiques particuliers, qui consulte pour une masse nodulaire évoluant depuis 12 ans, augmentant progressivement de taille, devenant rouge, douloureuse, s’ulcérant par endroit, au niveau de la nuque en regard du muscle trapèze droit, faisant 2*2 cm (figure 1). Une exérèse cutanée a été réalisée objectivant un CT avec des marges tumorales (figure 2, figure 3).
Un bilan d’extension locorégionale et générale a été réalisé, ne montrant pas d’anomalies, la patiente a ensuite bénéficié d’une reprise chirurgicale avec des marges de 2 cm dont l’étude anatomopathologique n’a pas objectivé de tissu tumoral.
Figure 1 : Image clinique de la masse.
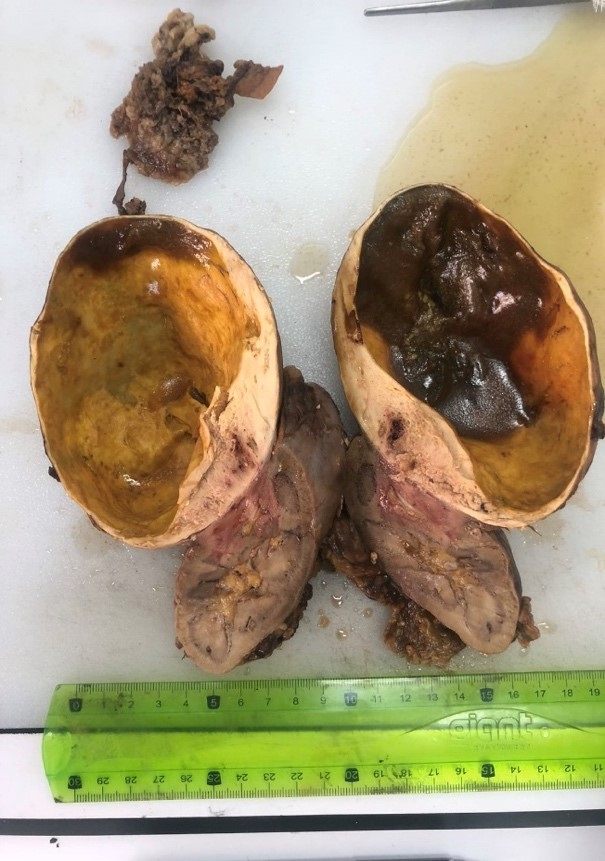
Figure 2 : Microphotographie montrant que la prolifération se dispose en travée fines, anastomosées avec formation de cavités
kystiques contenant un liquide séreux, sans avoir vu de fente de rétraction.
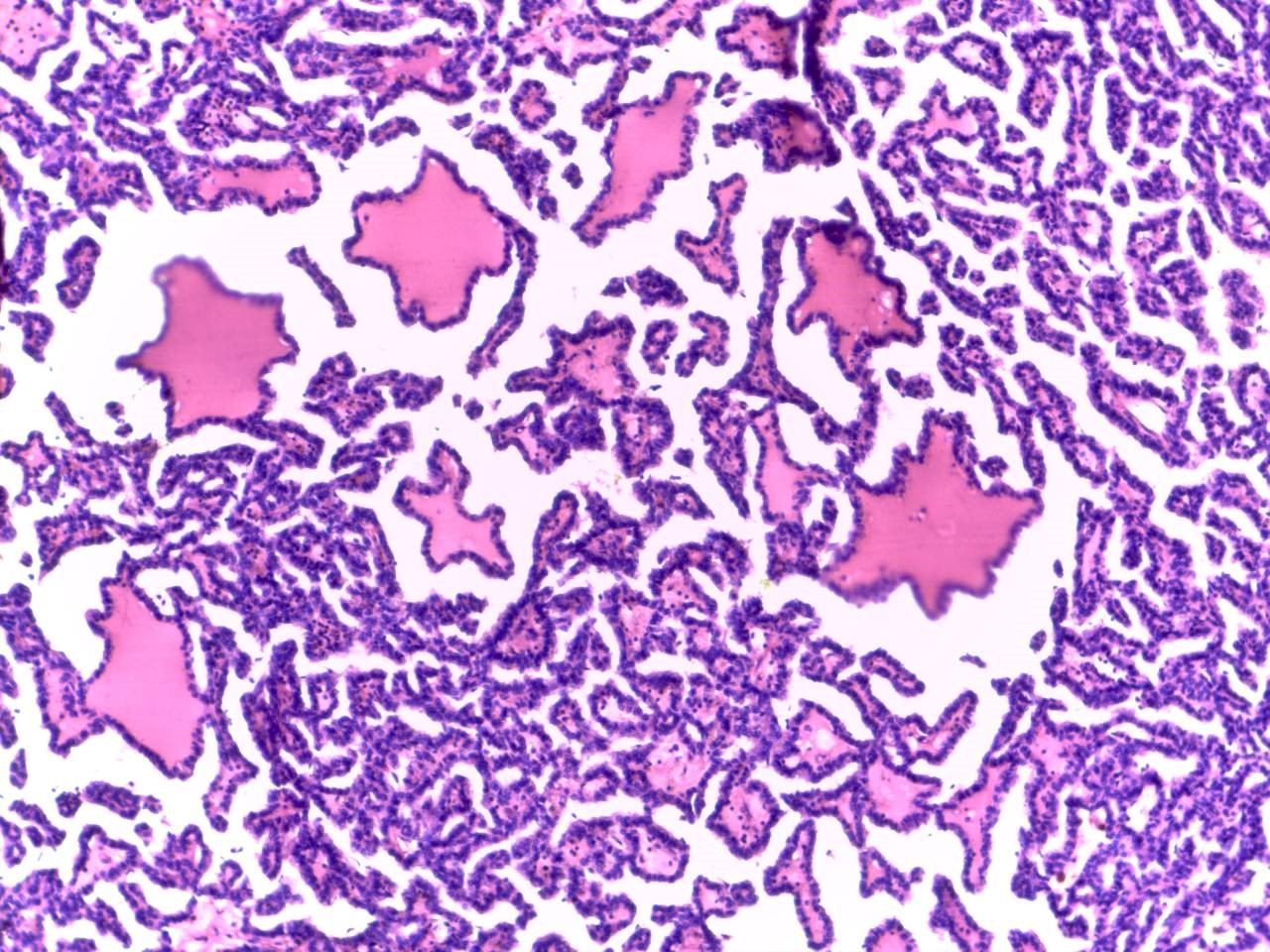
Figure 3 : Microphotographie montrant des cellules tumorales atypiques avec une activité mitotique importante (3 mitoses sont visibles sur ce champs).
Discussion
Le carcinome trichoblastique est une entité de découverte récente et rare puisqu’actuellement seulement 30 cas ont été décrits dans la littérature. Il survient principalement chez les personnes âgées, de prédominance masculine, atteignant préférentiellement la face, le cuir chevelu, le torse, le dos, les épaules et les extrémités (2). Le CT a des similitudes clinico-histologiques avec le carcinome basocellulaire infiltrant et le diagnostic différentiel entre les deux est souvent difficile (3).
Le traitement de choix est la chirurgie avec des marges suffisantes allant de 0,5 à 3 cm selon les auteurs. En cas de métastases, les chimiothérapies conventionnelles n’ont pas montré un effet bénéfique. Cependant une étude proposant un traitement par Sunitinib (inhibiteur de la tyrosine kinase), a permis une réponse partielle avec décroissance de la taille de la tumeur (4). Le vismodegib constitue également une alternative thérapeutique surtout dans les formes métastatiques en inhibant la voie patched sonic hedgehog. Sur le plan évolutif, le carcinome trichoblastique est une tumeur agressive et récidivante, avec un risque de métastases à distance essentiellement pulmonaire d’où la nécessité d’une surveillance clinique rapprochée des patients tous les trois mois (5).
Conclusion
Il n’existe pas de consensus pour la prise en charge du carcinome trichoblastique, l’exérèse chirurgicale reste le meilleur traitement et doit être complète avec des marges suffisantes suivie d’une surveillance clinique rapprochée des patients.
Liens d’intérêts : Les auteurs déclarent ne pas avoir de liens d’intérêts.
Références :
- F, Keiji.T, Asako.T, Arisa.T, Rino.K, Junichi.Set al: Highgrade trichoblastic carcinoma arising through malignant transformation of trichoblastoma: Immuno-histo-chemical analysis and the expression of p53 and phosphorylated AKT, the journal of dermatology,2018,46, 57-60.
- Thomas, C. Bruant-Rodier, F. Bodin, B. Cribier, M. Huther, C. Dissaux, De l’intérêt de différencier les carcinomes trichoblastiques (CT) des carcinomes basocellulaires (CBC). À propos de 21 cas, annales de chirurgie plastique esthétique (2017) 62, 212—218.
- Cribier : Les difficultés du diagnostic : du carcinome basocellulaire aux tumeurs trichoblastiques, les annales de dermatologie et de vénéréologie (2018) 145, VS3-VS11.
- A. Oufkira, K. Znatib, D. Kamala, M.N. El Alamia, Un carcinome trichoblastique, Rev Stomatol Chir Maxillo-fac Chir Oral 2013, 114, 102-105.
- Romeu, J.M. Foletti, C. Chossegros, J.P. Dales, P. Berbis, B. Cribier et al., : Les tumeurs cutanées malignes à différentiation pilaire de la face et du cuir chevelu : mise au point diagnostique et thérapeutique, J Stomatol Oral Maxillo-fac Surg 118, 2017, 95–102.
Infection du site opératoire en urologie
But : étudier l’aspect épidémiologique des ISO chez les patients opérés par chirurgie ouverte et de déterminer les germes en causes ainsi que leurs sensibilités aux ATB. Patients et méthode : Il s’agissait d’une étude rétrospective, descriptive et mono-centrique sur une période de 2 ans portant sur 21 patients ayant une ISO confirmée à l’examen bactériologique du pus dans notre service.
M. Ndiaye, A. Sarr, A. Thiam, E.H.M. Diaw, B. Sine, S.E. Haiba, O. Sow, A. Ndiath, A. Traoré, C.Z Ondo, O. Gaye, N.M. Thiam, O. Dabo, N.S. Ndour, B. Fall, A.K. Ndoye. CHU Aristide Le Dantec de Dakar, Sénégal.
Date de soumission : 25 Avril 2020.
Résumé : But : étudier l’aspect épidémiologique des ISO chez les patients opérés par chirurgie ouverte et de déterminer les germes en causes ainsi que leurs sensibilités aux ATB. Patients et méthode : Il s’agissait d’une étude rétrospective, descriptive et mono-centrique sur une période de 2 ans portant sur 21 patients ayant une ISO confirmée à l’examen bactériologique du pus dans notre service. Les paramètres étudiés étaient : épidémiologiques, cliniques, bactériologiques et thérapeutiques. La collecte des données et la confection des figures et tableaux étaient faites avec le logiciel Excel 2013. Résultats : L‘incidence était de 5%. L’âge moyen de 60 ± 15,3 ans. L’HBP était le diagnostic pré-opératoire le plus observé. Quatre-vingt-dix pour cent des patients étaient hospitalisés le jour de l’intervention et 90% avaient un ECBU négatif. L’adénomectomie prostatique (33%) était le geste chirurgical prédominant. Le délai moyen de survenue de l’ISO était de 4,6 ± 3,3 jours. Quarante-huit pour cent des patients avaient une ISO superficielle. E. coli (29%) était le germe le plus retrouvé. L‘imipenème était efficace sur toutes les souches de BGN. Les Pseudomonas résistaient à l’imipenème. Le délai moyen du séjour hospitalier était de 18 ± 7 jours et 90% des patients avaient une évolution favorable après 3 mois. Conclusion : l’incidence des ISO dans notre service était dans les limites des données de la littérature. Bien que l’évolution soit souvent favorable, le surcoût engendré par ces infections reste énorme, vu le niveau socio-économique de nos patients.
Mots-clés : Infections, bloc, site opératoire, chirurgie, urologie.
Abstract: Objective: to study the epidemiological aspect of ISO in patients operated by open surgery and to determine the germs in question as well as their sensitivities to ATB. Patients and method: This was a retrospective, descriptive and mono-centric study over a period of 2 years on 21 patients who had a confirmed ISO on bacteriological examination of pus in our department. The parameters studied were: epidemiological, clinical, bacteriological and therapeutical. Data collection and figures and tables were made with Excel 2013 software. Results: The incidence was 5%. The average age of 60 ± 15.3 years. The HBP was the most widely observed preoperative diagnosis. Ninety percent of the patients were hospitalized on the day of their intervention and 90% had a sterile ECBU. Prostatic adenomectomy was the most performed surgical procedure, with a rate of 33%. The mean ISO onset time was 4.6 ± 3.3 days. Fourty eight percent of the patients had superficial ISO. E. coli was the germ most found during ISO (29%). Imipenem was effective on all strains of BGN. Resistance to this antibiotic only concerned pseudomonas. The average length of hospital stay was 18 ± 7 days and 90% of patients had a favourable development within 3 months. Conclusion: the incidence of ISO in our service was within the limits of the data in the literature. Although progress is often favourable, the additional cost generated by these infections remains enormous, given the socio-economic level of our patients.
Keywords: Infections, block, operating site, surgery, urology.
Introduction
L’infection est dite post-opératoire lorsqu’elle survient dans les suites immédiates ou lointaines d’une intervention chirurgicale et qu’elle est directement en rapport avec celle-ci. L’infection post-opératoire est actuellement la première cause de morbidité et de mortalité en chirurgie malgré l’essor des antibiotiques, l’amélioration des techniques d’anesthésie et le progrès des mesures préventives et hygiéniques [1]. Elle augmente la durée d’hospitalisation, et le coût de la prise en charge [2]. Les infections post-opératoires typiquement hospitalières occupent la troisième place soit 20% des infections nosocomiales [3]. Les statistiques portant sur la fréquence des infections post-opératoires classent celles du site opératoire en second rang après les infections urinaires [4]. La prévention de ces infections doit être la préoccupation de toute l’équipe chirurgicale et passe par le respect de l’hygiène. Une mise à jour des données bactériologiques de ces infections doit être faite le plus fréquemment possible. À (Lieu d’exercice) aucune étude n’a été publiée sur les infections du site opératoire (ISO) en urologie. Le but de cette étude était d’étudier l’aspect épidémiologique des infections du site opératoires dans le service d’urologie de notre centre, de déterminer les facteurs favorisants, puis d’identifier les germes responsables et enfin d’étudier leur sensibilité aux antibiotiques.
Patients et méthode
Il s’agissait d’une étude rétrospective, descriptive et mono-centrique allant du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018, portant sur les patients adultes ayant eu une infection du site opératoire dans notre centre. Les patients opérés en chirurgie ouverte, qui avaient une ISO confirmée à l’étude bactériologique du pus prélevé sur la plaie opératoire ont été inclus. Les patients dont les dossiers étaient inexploitables car ne contenant aucune donnée bactériologique confirmant la présence d’un germe et ceux perdus, n’étaient pas inclus dans notre étude. Les paramètres suivants étaient étudiés : l’âge, le sexe, l’origine géographique, les antécédents médicaux et chirurgicaux, l’état général, la classification ASA, le diagnostic pré-opératoire, la classification d’Altemeier, le type de chirurgie, le type de suppuration, la température, le délai d‘apparition de l‘infection, l‘évolution sur 3 mois, les résultats de l’ECBU en pré-opératoire, le germe retrouvé dans le prélèvement du pus, la sensibilité des germes aux antibiotiques, le délai moyen d’hospitalisation pré- et post-opératoire, le nombre de personnes au bloc opératoire, le rang au programme opératoire, les précautions d’asepsie, l’antibioprophylaxie, le type d’anesthésie et le traitement de l‘infection du site opératoire. L’ISO était définie par l’isolement d’un germe à l’examen cytobactériologique du pus, associé à un de ces trois types d’ISO selon la profondeur de l’atteinte
- Infection superficielle de l’incision qui se limite à la peau et au tissu sous-cutané.
- Infection profonde de l’incision qui touche des tissus tels que la musculature de la paroi abdominale.
- Infection d’organe ou d’espace qui se manifeste au niveau des viscères et des cavités
L‘indice de performance de l’OMS était utilisé pour apprécier l’état général des patients.
La classification d’Altemeier nous avait permis de repartir les interventions chirurgicales en fonction du risque de contamination et d’infection post-opératoire. La collecte des données et la confection des figures et tableaux étaient faites avec le logiciel Excel 2013.
Résultats
Trois cent quatre-vingt-douze dossiers de patients, ayant eu une chirurgie ouverte, durant la période d’étude ont été étudiés. Parmi eux, 21 patients répondaient aux critères d’inclusion, soit un taux d‘incidence de 5%. Tous les patients étaient de sexe masculin. L’âge moyen était de 60 ± 15,3 ans (extrêmes 30 et 90 ans).
Neuf patients soit 43% ne présentaient aucun antécédent médical. Les antécédents les plus observés étaient l’hypertension artérielle et le diabète, objectivés respectivement chez 19% (4) et 14% (3) des patients [figure 1].
L’hypertrophie bénigne de la prostate était le diagnostic pré-opératoire le plus fréquent, objectivée chez 33% (7) des patients, suivie de la sténose de l’urètre chez 14% (3) des patients [figure 2].
En fonction de l‘indice de performance de l’OMS, 48% (10) des patients avaient un stade 1 ; 33% (7) un stade 2 ; et 19% (4) un stade 3. Le score d’ASA était à I, II, III respectivement chez 52% (11), 38% (8), et 10% (2) des patients. Dix-neuf patients soit 90%, étaient hospitalisés le jour de leur intervention. Deux patients avaient une hospitalisation pré-opératoire respective de 3 et 15 jours. L’ECBU pré-opératoire était négatif chez 90% (19) des patients. Deux patients avaient une infection urinaire. Il s’agissait de l’E. coli et du Staphylococcus aureus, observés respectivement chez 5% (1) des patients. La classification d’Altemeier avait mise en évidence les classes I, II et III respectivement chez 4,8% (1), 14,3 (3) et 80,9% (17) des patients. Une antibioprophylaxie par le Cefuroxime était faite chez 85,6% (18) des patients. Les 2 patients hospitalisés avaient une antibiothérapie adaptée à l’antibiogramme en pré-opératoire. Un seul patient n’avait pas reçu d’antibiotique en pré- ou péri-opératoire. En fonction de la position au programme opératoire, les rangs 1er, 2ème, 3ème et 4ème observés respectivement chez 23,8% (5) ; 33,4% (7) ; 23,8% (5) et 19% (4) des patients. La moyenne des personnes présentes dans la salle opératoire était de 5,6 ± 0,97 (extrême 4 et 7). L’acte chirurgical le plus effectué était l’adénomectomie prostatique, faite chez 33% (7) des patients [figure 3].
Le délai moyen de survenue de l’ISO était de 4,6 ± 3,3 jours (2 et 18 jours). Sept patients soit 33% (7) avaient une fièvre au moment du diagnostic. Les ISO étaient superficielles, profondes et d’organes respectivement chez 48% (10) ; 38% (8) et 14% (3) des patients. Cinq bactéries étaient isolées à l’examen bactériologique du prélèvement. Il s’agissait de l’E. coli, du Staphylococcus, de l’E. coli, associée à un Staphylococcus, d’un Pseudomonas aeruginosa, d’un Pseudomonas associé à un Klebsiella et d’un Klebsiella, observés respectivement chez 28,6% (6) ; 23,8% (5) ; 4,8% (1) ; 19% (4) ; 4,8% (1) et 19% (4). L‘Imipenème était efficace sur toutes les souches de Bacille gram négatif. La résistance à cet antibiotique ne concernait que les Pseudomonas [Tableau I].
Les patients étaient traités par des pansements quotidiens pour les suppurations superficielles ; et biquotidiens, associés une antibiothérapie adaptée à l’antibiogramme pour les suppurations profondes. L’évolution était favorable chez 90% (19) des patients. Cependant, deux patients étaient décédés de leur pathologie.
Tableau 01 : Sensibilité des germes isolés aux antibiotiques
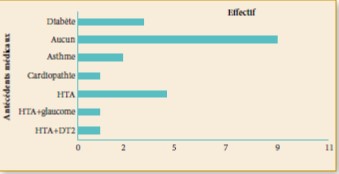
Figure 1 : Répartition des patients en fonction de leurs antécédents médicaux
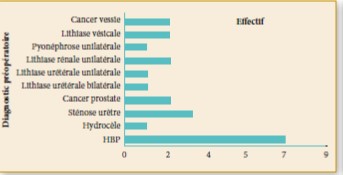
Figure 2 : Répartition des patients en fonction de leur diagnostic préopératoire
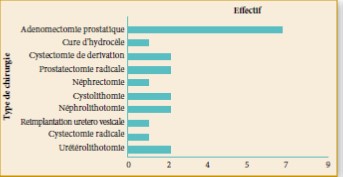
Figure 3 : Répartition des patients en fonction du type de chirurgie
Discussion
L’incidence des ISO dans cette étude était de 5%. Cette incidence peut être une sous-estimation de la réalité car certains patients déjà sortis de l’hôpital peuvent faire une ISO en ambulatoire et les données ne sont pas mentionnées dans leurs dossiers. Ainsi la fréquence observée dans notre étude ne reflétait que ce qui s’est passé en cours de l’hospitalisation. La majeure partie des patients était âgée de plus de 61 ans. Cette prévalence élevée chez les patients âgés peut être expliquée par de nombreux facteurs plus ou moins intriqués, anatomiques, fonctionnels ou immunologiques [5]. Chez le sujet âgé la diminution du débit urinaire du fait d’une baisse des apports hydriques, la réduction du tonus musculaire des parois des voies urinaires, notamment celles de la vessie, entraînent après chaque miction une stase vésicale responsable de la prolifération microbiennes. En plus, il existe chez la personne âgée une diminution des défenses immunitaires de l’appareil urinaire. Ceci s’explique surtout :
- Par la réduction fréquente des moyens de défense naturelle et la diminution des défenses immunitaires humorales et cellulaires,
- Et par l’augmentation des pathologies favorisant la stase urinaire, du sondage vésical et de l’incontinence urinaire et fécale [6,7].
En plus, une diminution de l’activité bactéricide du fluide prostatique chez le sujet âgé est également notée [8]. Dans notre étude, tous les patients étaient de sexe masculin. Cette prédominance du sexe masculin serait liée au fait que l’urologie s’occupe plus des affections urinaires et génitales masculines que féminines. Dix-neuf pour-cent des patients ayant une ISO étaient diabétiques. Le diabète est un facteur de risque d’ISO rapporté dans de nombreuses études [9,10].
K. Filali et al., [11] et Nicolle et al., [12] ont montré dans leur série que l’infection nosocomiale était plus fréquente chez les diabétiques. Cette fréquence augmente parallèlement avec l’âge. Elle touche les patients âgés de plus de 50 ans dans plus de la moitié de leurs patients. L’ancienneté du diabète et la neuropathie vésicale constituent des facteurs de risque. En effet le diabète expose à la survenue d’infections par le biais d’un dysfonctionnement vésical secondaire à une neuropathie périphérique. En outre, la glycosurie favorise la prolifération microbienne et altère l’activité des polynucléaires et la phagocytose [12].
La classification ASA I était plus fréquente dans notre étude. Nous n’avions pas étudié la proportion d’ISO dans chaque groupe d’ASA mais il est rapporté dans la littérature que la suppuration augmente si d’autres pathologies sont associées [13]. Dans notre étude les ISO étaient plus fréquentes chez les patients ASA I. Ces résultats sont conformes à ceux de Krieger J. N et al [14]. Ils peuvent être expliqués par le fait qu’il y avait plus de patients ASA I chez les patients aptes à subir une intervention chirurgicale, comparés aux patients ASA III. Certains facteurs liés aux patients sont probablement associés à une baisse des défenses anti-infectieuses de l’organisme, ce qui pourrait favoriser la survenue d’infections nosocomiales [15].
Un certain nombre de ces facteurs ont été documentés comme significativement associés à une augmentation du risque d’ISO pour des chirurgies très variées. Le score ASA essaie de prendre en compte un certain nombre de ces facteurs liés au patient mais sans doute de façon incomplète. La présence d’autres infections non traitées avant la réalisation de l’acte opératoire est également impliquée dans la survenue d’une ISO [16]. Il est donc important de bien prendre en charge le malade avant l’acte chirurgicale en soignant ou équilibrant au maximum tous les facteurs pouvant favoriser la survenue d’infections post-opératoires.
Le taux d’ISO en classe ASA I peut être considéré comme un marqueur de la qualité de la prise en charge chirurgicale. La stérilité des urines est difficile à obtenir chez les patients ayant une hypertrophie bénigne de la prostate ou une sténose de l’urètre compliquées de rétention complète d’urine du fait du portage chronique de la sonde urinaire. Ceci fait que les complications infectieuses comme la suppuration et les lâchages de suture surviennent souvent en post-opératoire.
La majorité des patients étaient hospitalisés le jour même de leur intervention ce qui correspond aux habitudes de notre service dans le but de réduire le délai du séjour hospitalier. Cependant l‘interprétation de l‘association séjour pré-opératoire et survenue d‘ISO est très complexe. En effet la durée du séjour précédant l’intervention est vraisemblablement associée à des facteurs de risque propres au sujet et à des facteurs environnementaux. Un séjour préopératoire prolongé favoriserait la prolifération d’une flore exogène qui pourrait donc contaminer plus aisément le site opératoire [17].
Dans cette étude, nous avions constaté que les patients occupant le 2ème rang présentaient plus d’ISO. La position du patient dans le programme opératoire est peu constitutive pour la survenue de l’ISO si les règles d’asepsie au bloc opératoire sont respectées. Les suppurations superficielles étaient plus fréquentes dans notre étude. Cette plus grande fréquence des infections pariétales pourrait s’expliquer par l’aspect creux de la voie excrétrice urinaire, qui lorsqu’elle est ouverte lors d’une chirurgie, a tendance à créer des fistules pariétales en cas d’infection.
L’E. Coli était plus fréquemment retrouvée à la culture. Les micro-organismes, le plus souvent responsables des ISO, sont des commensaux habituels de l’homme : le Staphylococcus aureus, l’Escherichia coli et le Pseudomonas aeruginosa [18]. Ils varient selon le réservoir et le degré de contamination du site opératoire. Ainsi, les bactéries de la flore cutanée et muqueuse (le staphylocoque aureus et le streptocoque) sont les espèces bactériennes le plus souvent retrouvées en chirurgie propre. L’antibioprophylaxie en fonction du type de chirurgie et la préparation cutanéomuqueuse de l’opéré prennent en compte ces bactéries. La présence d’une infection à distance du site opératoire est un facteur de risque d’ISO. Il est donc recommandé, en présence d’une infection sans rapport avec l’indication opératoire, de différer celle-ci sauf en urgence. Si l’intervention contribue partiellement ou totalement au traitement de cette infection, elle doit être précédée par la mise en œuvre d’une antibiothérapie sauf si cette intervention a également pour but un diagnostic bactériologique.
L’E. coli demeure le germe le plus sensible aux antibiotiques ; sa proportion est deux fois plus fréquente en pratique ambulatoire qu’en milieu hospitalier [19]. De nombreuses souches produisent une pénicillinase et par conséquence deviennent résistante aux amino-, carboxy- et uréido-pénicillines. Si ce dernier est résistant aux inhibiteurs de béta-lactamases, il serait résistant même à l’association Amoxicilline-Acide Clavulanique.
A partir d’une étude multicentrique de Bouza U et al., [20], la résistance de l’E. coli était de 50% vis-à-vis de la Pénicilline A mais cette résistance était plus élevée dans notre étude. Par contre, nous avions noté une sensibilité de 100% à l’imipenème, et ces données sont superposables à celles de la littérature. La majorité des Klebsiella était résistante à la Pénicilline A, ce qui était comparable aux résultats de Scheftel et al., [21] et Pinction et al., [22] ; qui avaient trouvé respectivement une résistance à 89% et 91%. L’association de l’amoxicilline avec l’acide clavulanique avait permis d‘accroitre la sensibilité avec un taux à 26%, alors que Pincton et al., [22], avaient rapporté que cette association ne permettait de couvrir que 9% des souches isolées. Pincton et al [22], qui avait trouvé les souches les plus sensibles, n’ont rapporté aucune résistance vis-à-vis des fluoroquinolones tandis que Solet et al., [23], avaient rapporté 40% de résistances. Aussi bien dans notre étude que dans celles de Zouhdi et al., [24] à Rabat, et celle de Scheftel et al., [21] en France, 100% des souches de Pseudomonas étaient résistantes à l’Amoxicilline + Acide Clavulanique.
En ce qui concerne les autres antibiotiques, nos résultats étaient plus encourageants que ceux de la littérature [21,23,24]. Les infections étaient traitées par une antibiothérapie adaptée à l’antibiogramme et des soins locaux. Le traitement des ISO doit toujours respecter les règles chirurgicales de base. Il est impératif de procéder préalablement au débridement des tissus nécrotiques, à une désinfection locale, à la réparation des brèches mais surtout au drainage d’une collection purulente que ce soit par simple lâchage de quelques points de suture (ou tous les points) ou une ré-intervention chirurgicale. Il ne faut pas oublier que les antibiotiques seuls ne peuvent pas guérir une infection collectée telle qu’un abcès ou un empyème. Dans cette situation, leur rôle consiste à préserver les tissus viables et à prévenir une dissémination systémique [25]. La culture bactériologique d’un écoulement ou d’une collection est très importante chaque fois qu’elle est possible avant la prescription d’un antibiotique. En effet, la liste des bactéries causant potentiellement une ISO est longue et même les germes les plus communément impliqués, tels que le Staphylocoque aureus, posent de plus en plus de problèmes de résistance qui compromettent la réussite du traitement. L’allongement de la durée d’hospitalisation post-opératoire accroît le risque d’apparition d’une ISO [26]. L’hospitalisation entraîne une modification de la flore cutanée du patient [27]. L’allongement du séjour hospitalier majore les complications de décubitus et s’associe souvent à des explorations invasives pour lesquelles les complications septiques sont réelles.
Conclusion
L’incidence des infections du site opératoire dans notre service était dans les limites des données de la littérature. Bien que l’évolution soit souvent favorable, le surcoût engendré par ces infections reste énorme, vu le niveau socio-économique des patients et le maigre budget de la santé dans notre pays. l’E. coli était le germe le plus fréquent et l’imipenème était efficace sur toutes les souches de Bacille gram négatif. Pour prévenir ces ISO, une surveillance continue des ISO doit être faite au service d’urologie en collaboration avec les services de microbiologie et d’épidémiologie afin de réduire au minimum le risque de faire une infection nosocomiale.
Remerciements : Nous remercions tout le personnel du service d’urologie du CHU (Lieu d’exercice).
Liens d’intérêts : Les auteurs déclarent ne pas avoir de liens d’intérêts.
Références bibliographiques
- Garner JS, Jarvis WR, Emori TG. CDC définitions for nosocomial infections Am. J infect. Control, 1988, 16 : 128-140.
- Cruse PJE. A Five-Year Prospective Study of 23,649 Surgical Wounds. Archives of Surgery. Août 1973 ; 107(2) : 206.
- CCLIN PARIS-NORD. Le réseau INCISO trois mois de surveillance des infections du site opératoire dans 120 services de chirurgie de l’inter-région. Paris-Nord.BEA1999 ; 25 :106-108.
- Brun-Buisson C, Girou E Les infections nosocomiales : Bilan et Perspectives. Med/Sciences 2000 ; 16 : 89-102.
- Lobel B, Patard JJ, Guille F. Infection nosocomiale en urologie. Urol2003; 37: 339-344.
- Lechavallier- Michel N, Gautier-Bertrand M, Alperovitch A. Frequency and risk factors of potentially inappropriate medication use in a community-dwelling elderly population : results from the 3C study. Eur J Clin Pharmacol. 2005 ; 60 : 813-819
- Nicolle L, Bjornson J, Harding K, Mac Donell J. Bacteriuria in elderly institutionalized men. N Engl J Med 1993 ; 309 :1420-1425
- Faucher N, Billebaud T, Roger M. Les infections urinaires du sujet âgé. Gériatr2000; 25(7): 507-514
- Geerlings SE. Urinary tract infections in patients with diabetes mellitus epidemiology, pathogenesis and treatment. Int J AntimicrobAgents2008 ; 31(1) : 54-57.
- Hoelpelman AIM, Meiland R, Geerlings SE. Pathogenesis and management of bacterial urinary tract infections in adult patients with diabetes mellitus. Int J Antimicrob Agents 2003; 2: 35-43.
- Bertal Filali K, Fouad Z, Diouri A. Infections urinaires et Diabète. Diabetes Metab 2008; 34:80-81.
- Nicolle L, Bjornson J, Harding K,MacDonell J. The association of bacteriuria with resident characteristics and survival in elderly institutionalized men. Ann Intern Med 1997 ; 106(5) : 682-686.
- Daabis M. American Society of Anaesthesiologists physical status classification; Indian Journal of Anaesthesia 2011; 55 (2) 111-115.
- Krieger JN ; Kaiser DL, Wendel RP. Urinary tract etiology of bloodstream infection in hospitalized patients. J Infect Dis 1983 ;148(1) :57-62.
- Mangram AJ, Horan TC, Pearson ML, Silver LC, Jarvis WR. Guideline for Prevention of Surgical Site Infection, 1999. Centers for Disease Control and Prevention (CDC) Hospital Infection Control Practices Advisory Committee. Am J Infect Control. 1999 ; 27(2) :97-132.
- Sherertz RJ, Garibaldi RA, Marosok RD, Mayhall CG. Consensus paper on the surveillance of surgical wound infections. Infect Control Hosp Epidemiol 1992 ; 20 :263-270.
- Delgado-Rodriguez M., Medina-Cuadros M., Martinez-Gallego G., Sillero-Arenas M. Nosocomial infections in surgical patients: comparison of two measures of intrinsic patient risk Infect Control Hosp Epidemiol 1997; 18(1): 19-23.
- Troillet N, Zanetti G. L’infection du site opératoire : une complication hospitalière qui concerne le médecin de premier recours. Rev Med Suisse 2002 ; 2 (22087)
- Roussel-Delvallez M, Caillaux M, Cattöen C, Decoster A, Descamps D, Graveline N. Prévalence de la résistance d’Escherichia coli isolés de prélèvements d’origine urinaire ou gastro-intestinale vis-à-vis de l’association amoxicilline-acide clavulanique et de divers antibiotiques. Antibiotiques 2007, 9(1) : 65-69.
- Bouza E, San Juan R., Munoz P, Voss A, Kluytmans J A european perspective on nosocomial urinary tract infection I. Clin Microbiol Infect. 2001 ; 7(10) : 523-531.
- Scheftel JM, Weber M. Résistance à 16 antibiotiques de 3876 bacilles à Gram négatif aérobies isolés dans 39 centres de soins intensifs en France. Méd Mal Infect 1994 ; 24 : 255-262.
- Pincton TM, Enrique P, Demange C. Consommation d’antibiotiques et profil de sensibilité des micro-organismes dans un centre hospitalier général. Méd Mal Infect 1993 ; 23(5) : 360-366.
- Solet JP, Joly Guillo ML, Varache C. Infections nosocomiales dues à Acinétobacter baumannii. Méd Mal Infect 1993 ; 23 (8) : 67-72
- Zouhdi M, Aghrouch M, Seffar M, El harti J. Prévalence des souches d’Acinetobacter baumannii et de Pseudomonas aeruginosa résistantes à l’imipenème par production de métallo-β-lactamases. Med Mal Infect 2006 ; 36 (7) : 386-389
- Astagneau P, Rioux C, Golliot F, Brücker G. Morbidity and mortality associated with surgical site infections. J. Hosp. Infect 2001; 48: 267–274.
- Ngaroua, Ngah JE, Bénet T, Djibrilla Y. Incidence des infections du site opératoire en Afrique sub-saharienne : revue systématique et méta-analyse. PAMJ 2016 ; 24(171) : 1-10
- Debra Malone L, Genuit T, Tracy K, Gannon C, Napolitano M. Surgical Site Infections: Reanalysis of Risk Factors. J Surg Res 2002. 103(1): 89-95.
Résultats de réduction orthopédique des luxations coxofémorales chez l’adulte
La luxation traumatique de la hanche est une urgence fonctionnelle dont la réduction orthopédique en première intention est formelle, et ceci dans les meilleurs délais. Une insuffisance du diagnostic engage le pronostic fonctionnel de la hanche par la survenue d’une éventuelle nécrose céphalique.
Hermann Victoire Feigoudozoui, Service d’Orthopédie Traumatologie, CHU Abidjan, Côte D’Ivoire.
Date de soumission : 25 Avril 2020.
Résumé : Introduction : La luxation traumatique de la hanche est une urgence fonctionnelle dont la réduction orthopédique en première intention est formelle, et ceci dans les meilleurs délais. Une insuffisance du diagnostic engage le pronostic fonctionnel de la hanche par la survenue d’une éventuelle nécrose céphalique. Objectif : Contribuer à l’amélioration de la prise en charge. Matériels et méthode : Il s’agissait d’une étude rétrospective sur 5 ans (Janvier 2015 à Décembre 2019) portant sur les luxations récentes de la hanche chez les patients de plus 18 ans. Les luxations anciennes et les perdus de vue après prise en charge étaient exclus. La classification de Bigelow avait permis de classer les luxations à l’entrée dans l’étude. L’évaluation des malades au recul minimum de 3 mois utilisait le score de Postel et Merle d’Aubigné. Les données étaient analysées avec le Logiciel Epi Info. Les tests statistiques retenaient un seuil de significativité à 0,05. Résultats : 28 patients dont 17 hommes et 11 femmes, âgés en moyenne de 35,5 ans (extrêmes : 17 et 53) étaient retenus. Les luxations étaient classées selon Bigelow en luxation postérieure haute, postérieure basse, antérieure haute et antérieure basse. Au recul minimum de 3 mois, nos résultats moyens selon le score de PMA étaient satisfaisants. Conclusion : La luxation traumatique de la hanche doit être réduite en urgence afin d’éviter les complications.
Mots clés : Hanche, luxation, résultats, orthopédique, traitement.
Abstract: Introduction: Traumatic dislocation of the hip is a functional emergency whose orthopedic reduction in first intention is formal and this as soon as possible. An insufficiency of the diagnosis engages the functional prognosis of the hip by the occurrence of a possible cephalic necrosis. Objective: Contribute to the improvement of care. Materials and method: This was a 5-year retrospective study (January 2015 to December 2019) on recent hip dislocations in patients over 18 years of age. Old dislocations and lost to follow-up after care were excluded. Bigelow’s classification was used to classify dislocations at the start of the study. The assessment of patients at minimum follow-up of 3 months used the Postel and Merle d’Aubigné score. The data was analyzed with Epi Info Software. The statistical tests retained a significance threshold of 0.05. Results: 28 patients, including 17 men and 11 women aged 35.5 years on average (range: 17 and 53) were retained. Dislocations were classified according to Bigelow as high posterior, low posterior, high anterior and low anterior dislocation. At the minimum follow-up of 3 months, our average results according to the PMA score were satisfactory. Conclusion: Traumatic hip dislocation must be reduced urgently to avoid complications.
Keywords: Hips, luxation, results, orthopaedic, treatment.
Introduction
La luxation traumatique de la hanche se définit comme le déplacement permanent de la tête du fémur en dehors de la cavité acétabulaire suite à un traumatisme violent survenant sur une hanche en attitude propice [1,2]. Les luxations de hanche représentent 5 % de l’ensemble des luxations [3]. La variété postérieure est la plus fréquente et varie entre 85 à 90% de toutes les luxations de hanche [4, 5]. L’étiologie est dominée par les accidents de la voie publique [6]. Le diagnostic est parfois difficile surtout dans le cadre du polytraumatisme [7]. Le traitement de choix, pour les formes récentes, reste toujours la réduction orthopédique sauf s’il y a une indication chirurgicale nécessitant une réduction sanglante [8, 9]. Pour les luxations négligées, l’arthroplastie de hanche reste le meilleur choix thérapeutique [10]. Le pronostic dépend de plusieurs facteurs dont le délai de réduction semble le plus admis [11]. L’objectif de l’étude était de contribuer à l’amélioration de la prise en charge.
Matériel et méthode
L’étude était rétrospective, analytique et monocentrique. Elle avait duré 5 ans (Janvier 2015 à Décembre 2019). Vingt-huit dossiers de patients avec 28 luxations coxo-fémorales dont 17 hommes et 11 femmes étaient retenus. Toutes les variétés étaient incluses. Les luxations négligées et les perdus de vue n’étaient pas retenus. L’âge moyen était de 35,5 ans (extrêmes : 17 et 53). Le secteur informel était la profession la plus représentée. Les patients provenaient majoritairement de la capitale. La principale circonstance de survenue était l’accident de la voie publique. La plupart des patients étaient vus par un étudiant. La variété iliaque prédominait. La hanche gauche était la plus luxé. Les fractures associées étaient toutes homolatérales et concernaient la diaphyse et le col fémoraux ainsi que le cotyle. Le traitement consistait en une réduction manuelle pour les luxations récentes et une réduction chirurgicale pour les luxations irréductible et instable. Le recul minimum était de 3 mois. Les patients étaient évalués selon le score de Postel et Merle d’Aubigné [12]. Le logiciel Epi Info avait servi à l’analyse des données. Le seuil de significativité était à 0,05 pour les tests statistiques.
Résultats
Les résultats descriptifs et analytiques sont présentés sous forme de tableaux. Confère aussi les Figures 1 et 2 à titre d’illustration.
Figure 1 : Luxation traumatique récente de la hanche droite, variété ischiatique.

Figure 2 : Luxation négligée de la hanche gauche variété iliaque + fracture du col fémoral
Tableau I : La série.
|
Caractéristiques |
Fréquence |
Pourcentage |
|
Sexe |
||
|
Masculin |
17 |
61% |
|
Féminin |
11 |
39% |
|
Age (ans) |
||
|
17– 45 |
19 |
68% |
|
˃ 45 |
9 |
32% |
|
Provenance |
||
|
Capitale |
23 |
82% |
|
Autre ville (Référés) |
5 |
18% |
|
Circonstance de survenue |
||
|
AVP |
22 |
78% |
|
Chute |
5 |
18% |
|
Accident de travail |
1 |
3% |
|
Examinateur initial |
||
|
Paramédical |
1 |
3% |
|
Étudiant en médecine |
20 |
71% |
|
Médecin sénior |
7 |
25% |
|
Côté lésé |
||
|
Droit |
7 |
25% |
|
Gauche |
21 |
75% |
|
Type de luxation |
||
|
Postérieur |
||
|
Iliaque |
22 |
78% |
|
Ischiatique |
1 |
3% |
|
Antérieur |
||
|
Obturatrice |
3 |
11% |
|
Pubienne |
1 |
3% |
|
Centrale |
1 |
3% |
|
Fracture homolatérale associée |
||
|
Cotyle |
5 |
|
|
Col fémoral |
2 |
|
|
Diaphyse fémorale |
1 |
|
|
Compression du nerf sciatique |
||
|
Oui |
1 |
3% |
|
Non |
27 |
96% |
Tableau II : Aspects thérapeutiques.
|
Caractéristiques |
Fréquence |
Pourcentage |
|
Traitement initial |
||
|
Réduction orthopédique urgente |
28 |
100% |
|
Échec de réduction orthopédique |
||
|
Oui |
2 |
7% |
|
Non |
26 |
93% |
|
Cause de l’échec |
||
|
Irréductibilité |
1 |
|
|
Instabilité |
1 |
Tableau III : Résultats d’évaluation selon le score de PMA.
|
Résultats d’évaluation selon PMA |
Fréquence |
Pourcentage |
|
Excellent |
17 |
60% |
|
Très bon |
9 |
32% |
|
Médiocre |
1 |
3% |
|
Mauvais |
1 |
3% |
Tableau IV : Répartition des causes d’échec de la réduction en fonction de la provenance.
|
Cause d’échec |
Provenance |
Total |
|
|
Capitale |
Référé |
||
|
Irréductibilité |
0 |
1 |
1 |
|
Instabilité |
1 |
0 |
1 |
|
Aucune |
22 |
4 |
26 |
|
Total |
23 |
5 |
28 |
Chi square=0,17 p=0,6
Tableau V : Répartition des résultats insatisfaisants en fonction de l’échec de la réduction.
|
Résultats insatisfaisants |
Réduction |
Total |
|
|
Irréductible |
Instable |
||
|
Médiocre |
1 |
0 |
1 |
|
Mauvais |
0 |
1 |
1 |
|
Total |
1 |
1 |
28 |
Chi square=0,50 p=0,47
Discussion
L’âge moyen des patients était de 35,5 ans (extrêmes : 17 et 53). La tranche d’âge la plus touchée était jeune (17 – 45 ans) avec un pourcentage cumulé de 68%. Le sexe masculin prédominait légèrement avec un sex-ratio à 1,54. Nombreux d’autres avaient également retrouvé des résultats similaires [13-15]. Le cadre de l’étude comportait une population jeune et mobile s’exposant ainsi quotidiennement aux accidents de la voie publique. Les patients victimes de luxations traumatiques de hanche étaient jeunes et masculines.
Les patients provenant de la capitale représentaient 82 % de la série. Ce fait s’expliquerait par une plus dense circulation automobile au niveau de la capitale.
Les étiologies prédominantes dans cette étude étaient représentées par les accidents de la voie publique (78%) suivies des chutes (18%). Certains auteurs avaient également retrouvé des résultats comparables [7,14-16].
La description faite par Bigelow se confirmait dans cette étude avec la prédominance des luxations iliaques (78%) [17]. Ce chiffre était superposable à ceux de la littérature [14-16, 18]. En effet au niveau de la hanche, la masse musculaire est importante et la structure ligamentaire faible.
Soixante-onze pour cent des patients étaient initialement examinés et pris en charge par des étudiants en médecine parce que les services d’urgence et les gardes étaient assurés par eux.
Les traumatismes étaient violents justifiant ainsi la survenue des fractures associées. D’autres avaient noté un fait pareil mais dans des circonstances différentes [14, 19].
Toutes les luxations étaient réduites en urgence au bloc opératoire, par manœuvre externe sous anesthésie générale de courte durée. La réduction orthopédique est un geste qui exige une maitrise parfaite de la technique. La technique de réduction selon Boehler était employée pour les luxations postérieures : Le patient est en décubitus dorsal sur un plan dur, avec un contre-appui sur les épines iliaques antéro-supérieures. La traction se fait dans l’axe du fémur, hanche et genou en flexion à 90° [20] (Figure 3). Les autres types de luxation étaient réduits par d’autres méthodes. Le patient qui présentait la luxation irréductible avait consulté quatre semaines après son traumatisme. Celui qui avait une luxation instable avait des antécédents de luxation de sa hanche. A défaut de moyens financiers afin d’honorer une arthroplastie, ces deux patients avaient bénéficié d’une réduction chirurgicale [21]. La réduction chirurgicale permet de protéger la tête fémorale d’une ostéonécrose en cas de luxation négligée. Cependant, le traitement adéquat en cas de luxation négligée est l’arthroplastie [7, 8, 10].

Figure 3 [20] : Manoeuvre de Boehler.
Conclusion
Réduite en urgence ou dans les meilleurs délais, la luxation de hanche présente des résultats satisfaisants. Au-delà de trois semaines d’évolution, elle est considérée comme négligée. La luxation négligée peut évoluer vers une nécrose de la tête fémorale en absence de traitement. Le traitement des formes négligées est l’arthroplastie de la hanche. Mais en situation précaire, une réduction chirurgicale peut provisoirement permettre d’éviter l’évolution vers la nécrose de la tête fémorale.
Tableau : Score de Postel et Merle d’Aubigné[12].
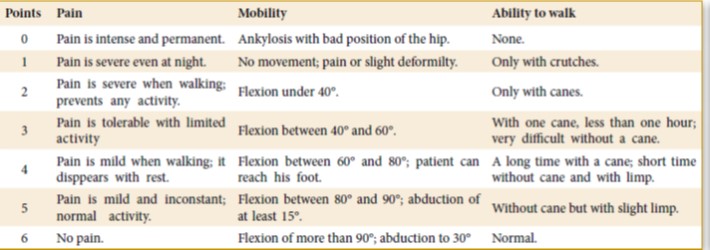
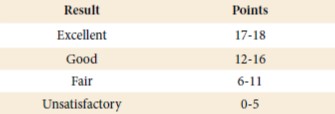
Remerciements : Nos sincères remerciements au Dr Dao Amara pour sa disponibilité à la lecture critique et la correction du draft. Nous remercions également tous les autres Maîtres dont les noms figurent dans le travail.
Liens d’intérêts : Les auteurs déclarent ne pas avoir de liens d’intérêts.
Références
- Meyer A, Biette G, Catonne Y. Luxation de hanche sans fracture du cotyle associée : méta-analyses et série de cas rapportés. Maitrise orthopédique. N°176, Août 2008.
- Yaovi YD, Anani A, Kosivi F, Messanvi YA, Kolima A, Yaovi EJ, Walla A, Batarabadja B, Assang D. Luxation obturatrice de la hanche: Pan Afr Med J. 2015;22:195.
- Traoré A, Soumaro KD, Mobiot-Aka C, Alban SM, Boka ER, Mamadou D, Sy K, Sié-Essoh JB, Bamba I, Lambin Y. Obturator dislocation of the hip at Yopougon. Open J Orthop, 2015;5:319-25.
- Patrascanu C. and Cibu D.Anterior hip fracture dislocation with intrapelvic retention of the femoral head ureter fistula. J Orthop Case Rep.2014;4(3):40-2.
- Walla A, Abalo A, Dellanh Y, Ayouba G, Dossim A. Open anterior dislocation of the Hip in Togo. Clinics in Orthopedic Surgery. 2016;8:214-7.
- Redouane H, Mohamed K, Mohamed SB. Traumatic obturator dislocation of the hip: a case report. Pan Afr Med J. 2015;21:55.
- Ameziane L, Hermas M, EL Yacoubi M, Ouazzani N, El Manouar M. Les luxations et luxations-fractures négligées de la hanche : Médecine du Maghreb 1999;76 :9-10.
- Abdelillah R, Najib A, Daoudi A, Yacoubi H. Luxation traumatique invétérée de la hanche. Pan Afr Med J. 2015; 22: 100.
- Tekin AÇ, Haluk Ç, Cem DB, Süleyman SD, Yunus İ, Hakan G. Inferior hip dislocation after falling from height: A case report. Int J Surg Case Rep. 2016; 22: 62–5.
- Soufiane B, Naserddine H, Atif M, Abdelhamim el I, Mohemmed S, Abdelmjide E. Luxation traumatique négligée de la hanche traitée par arthroplastie totale de la hanche. Pan Afr Med J. 2015; 20: 313.
- Pai VS, Kumar B. Management of unreduced traumatic posterior dislocation of the hip: heavy traction and abduction method. Injury. 1990;21(4):225-7.
- Merle d’Aubigné R. Cotation chiffrée de la fonction de la hanche. RevChirOrthop.1990;76:371-4.
- Chigblo P, Tidjani IF, Lawson E, Hans-Moevi A. Traumatic hip dislocation in Cotonou. J Orthop. 2016; 13(4):268-71.
- Lima LC, Alves do Nascimento R, Tenório de Almeida VM, Façanha FAM, Filho. Epidemiology of traumatic hip dislocation in patients treated in Ceará, Brazil. Acta Ortop Bras. 2014; 22(3): 151–4.
- Onyemaechi NO, Eyichukwu GO. Traumatic hip dislocation at a regional trauma centre in Nigeria. Niger J Med. 2011; 20(1):124-30.
- Sahin V, Karakas ES, Aksu S, Atlihan D, Turk CY, Halici M. Traumatic dislocation and fracture-dislocation of the hip: a long term follow up study. J Trauma. 2003;54(3):520-9.
- Tékpa BJD, Lamah L, Handy Eone D, Mapouka PAI, Loko II TT, Yafondo T, Gaudeuille A. Luxation iliaque négligée traitée par arthroplastie totale de hanche : à propos d’un cas à Bangui. Rev Chir Afr Cent. 2017; 2(13): 109-11.
- Durakbasa O, Okan N, Canbora K, Gorgec M. Factors affecting the results of treatment in traumatic dislocation of the hip. Acta Orthop Traumatol Turc. 2005;39(2):133–41.
- Onche II, Obiano KC, Udoh KM. Traumatic posterior dislocation of the hip: distribution and severity of associated injuries. Niger J Med. 2008;17(3):346-9.
- Burdin G, Hulet C, Slimani S, Coudane H, Vielpeau C. Luxations traumatiques de hanche : luxations pures et fractures de tête fémorale. EMC-Rhum Orthop. 2004 ;1:508-20.
- Garret JC, Epstein HC, Harris WH, Harvey JP Jr, Niclel VL. Treatment of unreduced traumatic posterior dislocations of the hip. J Bone Joint Surg Am. 1979; 61(1): 2-6.
Figures 1 : Luxation traumatique récente de la hanche droite, variété ischiatique.
Figures 2 : Luxation négligée de la hanche gauche variété iliaque + fracture du col fémoral
Figure 3 [20] : Manœuvre de Boehler.
Tableau : Score de Postel et Merle d’Aubigné [12].
Quoi de neuf sur les troponines hyper/ultra sensibles ?
Depuis 10 ans seulement, les cliniciens ont vu les biomarqueurs cardiaques s’imposer comme le gold standard des marqueurs de l’ischémie myocardique, occuper une place centrale dans le diagnostic d’infarctus du myocarde et être recommandées par toutes les sociétés savantes. Les anciens marqueurs dits enzymes cardiaques sont aujourd’hui obsolètes et tombés en désuétude.
N. Raaf Beramtane, Faculté de Médecine d’Alger, Laboratoire de Biologie Médicale, Établissement Public Hospitalier d’El Biar, Alger.
Date de soumission : 13 Avril 2020.
Résumé : Depuis 10 ans seulement, les cliniciens ont vu les biomarqueurs cardiaques s’imposer comme le gold standard des marqueurs de l’ischémie myocardique, occuper une place centrale dans le diagnostic d’infarctus du myocarde et être recommandées par toutes les sociétés savantes. Les anciens marqueurs dits enzymes cardiaques sont aujourd’hui obsolètes et tombés en désuétude. Son utilisation a considérablement modifié la réflexion diagnostique et plus globalement la prise en charge des cardiopathies d’urgence. La plupart des sociétés savantes ont, à ce jour, intégré l’utilisation de ces outils dans les recommandations de bonne pratique clinique. Ils contribuent à la décision d’orientation aux urgences. Depuis 2015, il existe un nouvel algorithme décisionnel intégrant le dosage de troponines hyper/ultra sensibles pour le diagnostic à 1 h de l’infarctus du myocarde chez les patients se présentant aux urgences pour douleurs thoraciques, basé sur les recommandations de l’European Society of Cardiology. Le nombre de publications consacrées à ce biomarqueur a crû de façon exponentielle, et il est difficile pour un non-initié de ne pas être perdu. Les quelques lignes qui suivent permettront de faire le point de cette thématique.
Mots clefs : Biomarqueurs cardiaques, troponines hyper/ultra sensibles, cardiopathies d’urgence.
Abstract: For only 10 years, clinicians have seen cardiac biomarkers establish themselves as the gold standard for markers of myocardial ischemia, occupy a central place in the diagnosis of myocardial infarction and be recommended by all scientific societies. The old markers known as cardiac enzymes are now obsolete. The use of troponin has significantly changed diagnostic thinking and more generally the management of emergency heart disease. Most of medical associations have so far incorporated the use of these tools into recommendations for good clinical practice. They contribute to the emergency referral decision. Since 2015 there is a new decision algorithm integrating the troponin assay for the 1-hour diagnosis of myocardial infarction in patients presenting to the emergency for chest pain based on the recommendations of the European Society of Cardiology. The number of publications devoted to this biomarker has grown exponentially, and it is difficult for the uninitiated not to be lost. The few lines that follow will take stock of this thematic.
Keywords: Cardiac biomarkers, troponins high/ultra-sensitive, emergency of heart disease.
- Introduction
Grâce au développement technologique, ces dernières années, de nombreux biomarqueurs cardiaques ont été développés pour servir la cardiologie dans le cadre des syndromes coronaires aigus (SCA), infarctus du myocarde (IDM), ou de l’insuffisance cardiaque. Il convient de connaître les limites d’utilisation et d’interprétation des dosages. En effet, ils sont pour la plupart non standardisés : il n’existe ni étalon, ni technique de référence. Les résultats obtenus avec les différentes méthodes ne sont donc pas comparables.
L’histoire des marqueurs cardiaques débute dans les années 50. À cette époque on parlait d’enzymes cardiaques totalement non spécifiques telles que l’aspartate aminotransférase 1954.
Les premières trousses de dosages de troponine cardiaque I (cTnI) ou T (cTnT) apparaissent en 1990. Elles évolueront de génération en génération vers des méthodes de plus en plus sensibles [1].
En 2007, un consensus international donne une nouvelle définition de l’infarctus du myocarde, associant des signes cliniques, électriques et biologiques [2]. Cette définition est assortie d’un critère analytique, précisant que l’imprécision (ou coefficient de variation) de la mesure de la troponinémie au 99e percentile ne doit pas dépasser 10%. Or, cette même année, aucun dosage disponible en routine ne peut atteindre un tel degré de précision pour ce seuil. Depuis 2008, avec les troponines dites « hypersensible Hs » (ou « ultrasensible Us »), la sensibilité des dosages peut atteindre l’ordre du nanogramme par litre [3], et le coefficient de variation est inférieur à 10%, pour le seuil considéré comme anormal [4,5] et leur utilisation en médecine a fait l’objet de recommandations par l’European Society of Cardiology (ESC) en 2010 [6] et par l’American College of Cardiology en 2012 [7].
Ainsi, les dosages de troponines Us/Hs cumulent à la fois une grande spécificité cardiaque et une grande sensibilité pour le diagnostic de SCA, fait rare en matière de biomarqueurs.
- Biochimie des troponines
- Structure et fonction
Les troponines cardiaques représentent un ensemble de protéines contractiles, qui appartiennent au complexe troponine-tropomyosine (figure 1). Ce complexe qui régule la contraction musculaire est commun à tous les muscles striés et absent des muscles lisses [8]. Il est localisé au niveau du sarcoplasme du myocyte. Les troponines comprennent trois protéines non enzymatiques : la troponine C (TnC), la troponine I (TnI) et la troponine T (TnT) (tableau I). L’ensemble du complexe composé de la TnC et de la partie globulaire de la TnI et la queue formée de la région N terminale de TnT. La TnT possède une fonction structurale. Elle lie la tropomyosine et la TnC. Lors de la dépolarisation du sarcoplasme, il y a une augmentation de la concentration en calcium ionisé cytoplasmique, qui se lie à la TnC et provoque une modification de conformation du complexe, augmentant l’affinité entre la TnC et la TnI. La TnI quitte alors le complexe actine-tropomyosine, ce qui entraîne une diminution de l’inhibition de l’ATPase liée à l’actomyosine. Il en résulte une hydrolyse de l’ATP et une contraction du complexe. Un complexe troponine-tropomyosine inhibe 7 monomères d’actine. Lorsque le Ca2+ retourne au sarcoplasme, le complexe actine tropomyosine retrouve sa configuration initiale et inhibe à nouveau l’ATPase, entraînant la relaxation musculaire (figure 1).
Figure 1 : Structure du complexe troponine-tropomyosine
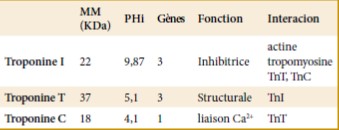
Tableau 01 : Structure des troponines
- Distribution intracardiaque des troponines
La composition et la distribution intracardiaque des différents marqueurs de nécrose sont indiquées dans le tableau II. Il existerait deux pools, l’un cytoplasmique l’autre sarcoplasmique. La libération des troponines résulte pour une large part de la protéolyse puis du passage transmembranaire. Cependant, on ignore précisément si les troponines cytosoliques sont libérées dès l’ischémie plutôt que pendant la nécrose [9].
La répartition intracardiaque des troponines a été étudiée au cours de différents travaux qui différaient en termes d’origine de l’organe, du traitement post-mortem des échantillons, de la partie du tissu cardiaque étudiée. La lyse des protéines contractiles est un phénomène rapide, débutant dès l’ischémie, et pourrait produire une augmentation artéfactuelle du pool cytosolique [10].
- Formes circulantes des troponines
Les isoformes cardiaques cTnI et cTnT ne sont synthétisées que dans les myocytes cardiaques.
Plusieurs formes circulantes de la TnT sont retrouvées après nécrose : TnT libre et complexée (complexe ternaire T-I-C), et fragments protéolysés de TnT. Immédiatement après nécrose, la forme prédominante de la TnT est la forme libre puis les formes complexées apparaissent.
La forme majoritaire circulante de la TnI est le complexe binaire (IC). Immédiatement après nécrose, la forme libre de la TnI est prédominante avec un rapport TnI libre/TnI complexée voisin de 12, puis les formes complexées apparaissent (figure 2). Les formes complexées (IC) et (TIC) sont alors majoritaires. La plus grande partie de la TnI complexée circulante serait sous forme du complexe IC, le complexe TIC se dégradant en TnT libre et IC [11].

Figure 2 : Passage transcellulaire et formes circulantes des troponines
- Concentrations plasmatiques
Depuis l’avènement des méthodes de dosage US/HS (grâce aux progrès technologiques), les concentrations circulantes de cTn chez les sujets sains sont détectables. Ainsi, les valeurs usuelles sont plus basses et la proportion de prélèvements mesurables a augmenté. Contrairement aux méthodes de dosages de génération précédente, les méthodes Us/Hs permettent de déterminer avec précision (Coefficient de Variation (CV) < 10%) la valeur du 99e percentile de cTn circulante dans une population de référence [12]. Il est important de rappeler, qu’a été décrite une différence de valeurs selon le sexe, et une influence significative (et positive) de l’âge et de la fonction rénale sur les valeurs de cTn Us/Hs, chez des sujets sains. D’où l’importance d’établir ou de vérifier la valeur seuil de la méthode utilisée dans la population de référence la plus adaptée.
- Indications
La principale indication clinique dans le contexte des urgences est évidemment la douleur thoracique et la suspicion de maladie coronarienne sous toutes ses formes : angor stable, l’angor spastique (angor de Prinzmetal), et les SCA avérés (infarctus du myocarde avec ou sans onde Q, syndrome de menace, angor de novo, angor instable). Les indications ne diffèrent pas de celles de la cTn conventionnelle.
L’interprétation des dosages Us/Hs repose pleinement sur la notion d’élévation ou de variation entre deux prélèvements espacés de quelques heures. Le profil de variation aiguë entre deux prélèvements est à différencier de celui observé en cas de pathologie chronique dans laquelle la cTn est supérieure au 99e percentile mais sans évolution cinétique.
- Syndrome coronarien aigu
Le syndrome coronarien aigu est une entité continue, regroupant plusieurs diagnostics avec des prises en charges différentes : l’angor instable (AI), l’infarctus du myocarde sans élévation du segment ST (NSTEMI) et l’infarctus du myocarde avec élévation persistante du segment ST (STEMI).
En 2007, une Task Force internationale a proposé une deuxième définition de l’IDM qui en distinguait 5 types différents, en fonction de leurs mécanismes physiopathologiques et des attitudes thérapeutiques qui en découlent [13].
Par la suite, l’augmentation de la sensibilité des biomarqueurs myocardiques a permis de détecter de minimes atteintes myocardiques dans des situations cliniques qui n’entraient pas dans cette définition et qui ont conduit à un nouveau consensus international publié en 2012. Le dosage des marqueurs myocardiques, et en particulier de la troponine, constitue non seulement un élément important de ces diverses définitions, mais l’optimisation de sa sensibilité a imposé une révision de la classification. On remarquera toutefois que malgré ces efforts de classification et d’actualisation des recommandations pour la prise en charge du SCA ST-, les urgentistes ne disposent toujours pas d’un score consensuel permettant d’établir, sur des arguments cliniques et électriques, une évaluation du risque d’IDM, aussi appelée probabilité pré-test, avant la réalisation des examens biologiques chez un patient présentant un tableau évocateur, mais non concluant.
De multiples mécanismes physiopathologiques peuvent être la cause d’une élévation de la TnT et à plus forte raison avec une méthode de dosage hypersensible (TnT Hs) s’il s’agit de valeurs faibles.
Dans ce contexte, quand demander et comment interpréter les dosages de TnT Hs en urgence ? La nécessité de préciser les stratégies thérapeutiques face à ces situations où clinique et dosage de troponines doivent être conjointement pris en compte a participé à la croissance exponentielle du nombre de publications consacrées aux marqueurs cardiaques. L’augmentation de la sensibilité des dosages de troponines a, par ailleurs, mis en lumière toute une série d’affections non coronariennes pour lesquelles les biomarqueurs vont prendre une importance croissante dans les prochaines années en permettant de reconnaître les sujets à haut risque qui requièrent une surveillance rapprochée et une adaptation des traitements.
- Algorithmes actuels et interprétations
Les troponines sont au centre des arbres décisionnels issus des recommandations de la Société Européenne de Cardiologie (ESC 2015), notamment concernant la prise en charge des syndromes coronariens aigus sans modification du segment ST. Après l’évaluation clinique et l’ECG, le taux de troponines est une variable essentielle de la stratification du risque des patients.
Il existe plusieurs algorithmes d’interprétation qui ont tous été validés dans des études indépendantes.
Pour le protocole H0-H3 (ESC 2012) (figure 3) la concentration de TnT Hs ne doit plus être interprétée de façon binaire, positive ou négative. Il faut désormais considérer des “concentrations détectables” mais < 14 ng/L (< 99e percentile), des “élévations modérées” (entre 14 et 50 ng/L) ou des “élévations importantes” (> 50 ng/L). Fait nouveau, on ne parle plus non plus d’augmentation relative (pourcentage d’élévation par rapport à la concentration initiale), mais de variation absolue.
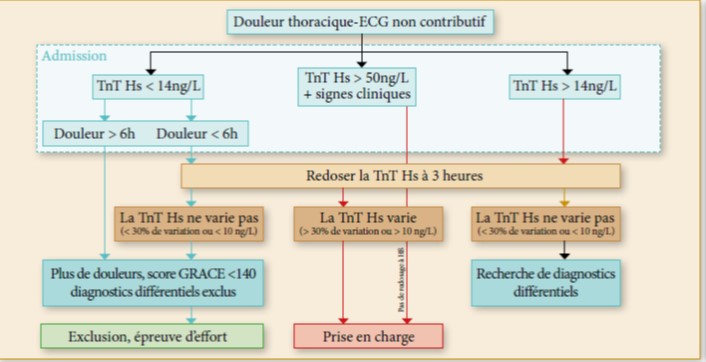
Figure 3 : Algorithme diagnostique du Syndrome coronaire aigu Non ST+ d’après les recommandations ESC
La plupart des études prennent en compte l’évolution des taux de TnT Hs à 3 heures d’intervalle, entre H0 et H3. Ainsi, pour un taux de TnT Hs > 14 ng/L à l’arrivée aux urgences et une augmentation de plus de 100% à la 3ème heure, Giannitsis et son équipe [14] considèrent que le diagnostic d’IDM peut être retenu. D’autres algorithmes d’inclusion ont été évalués. Si le dosage à l’arrivée est ≤ 14 ng/L, mais que celui réalisé 3 heures plus tard met en évidence une élévation des taux de plus de 50% de la valeur initiale, alors une stratégie thérapeutique invasive doit être mise en œuvre. Si le taux initial de TnT Hs est > 14 ng/L, il suffit d’une augmentation de 20% à la 3ème heure pour pouvoir porter le diagnostic [14].
L’un des critères clés pour porter le diagnostic d’IDM en cas de douleur thoracique sans sus-décalage de ST, est donc l’ampleur de la variation des taux de TnT Hs entre l’arrivée aux urgences et le nouveau dosage 1 à 3 heures plus tard. Les premières études qui ont exploré cette question conseillaient de prendre en compte des variations relatives exprimées en pourcentages du taux initial de TnT Hs.
Actuellement les protocoles les plus récents proposent de raccourcir le délai entre 2 mesures à 1 heure.
Le protocole H0-H1 (ESC 2015) (figures 4) n’est valable que pour certaines trousses de troponine HS et ne fait pas consensus notamment pour les douleurs très récentes.
Un second dosage des troponines (1 heure après), est recommandé pour exclure ou affirmer avec certitude un IDM non ST+ chez un patient consultant dans les premières heures après le début des symptômes [15, 16].
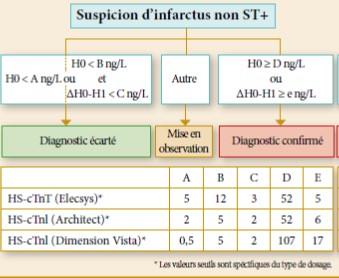
Figure 4 : Algorithme diagnostique du Syndrome coronaire aigu Non ST+ d’après les recommandations ESC 2015 incluant troponines hyper/ultra sensibles T et I
- Demi-vie et cinétique des troponines
Après un infarctus du myocarde, les concentrations sanguines de cTnT et cTnI mesurées par des méthodes US/HS s’élèvent après 2-3 heures (versus 4-6 heures avec des méthodes conventionnelles). Le délai d’apparition du pic plasmatique (aux alentours de 18-24 heures), et la cinétique de décroissance sont identiques à ceux observés avec les dosages conventionnels. Les concentrations circulantes de cTn restent élevées pendant 75 à 140 heures pour la cTnI et plus de 10 jours pour la cTnT (figure 5).
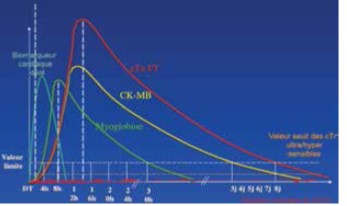
Figure 5 : Cinétique des biomarqueurs cardiaques
- Aspects Analytiques
Une méthode est considérée comme hypersensible si son “imprécision” (le coefficient de variation pour les biologistes) est < 10% au 99ème percentile d’une population de référence.
Le dosage des marqueurs cardiaques fait appel à diverses techniques qui nécessitent l’emploi d’anticorps monoclonaux. L’évaluation des concentrations de la TnTc, qui peut être réalisée sur sérum ou sur plasma, est obtenue par électro-chimiluminescence (ECL), une technique qui repose sur la quantification de la lumière émise par la liaison du TnTc et de l’anticorps.
Cet immuno-dosage automatisé permet d’obtenir des résultats parfaitement corrélés, avec un temps de rendu (temps analytique de 9 ou 18 minutes seulement) au praticien qui ne doit pas excéder 1 heure. Ces dosages hautement spécifiques exprimés en ng/L utilisent une technologie spécifique basée sur la pentamérisation des anticorps de capture ramenant la limite de détection à 5 ng/L (0,005 μg/L). Ces nouvelles techniques se sont concrétisées par la mise au point d’une trousse de dosage de “nouvelle génération” qui évalue la même forme moléculaire que les dosages précédents, mais de façon plus sensible et plus précise dans les valeurs basses, de 3 à 50 ng/L.
Les méthodes de dosage des cTn sont des immunodosages faisant appel à la reconnaissance d’un antigène (cTnI ou cTnT) par des anticorps réactionnels spécifiques. Ils peuvent être réalisés par des automates dédiés à l’immunoanalyse ou des automates mixtes biochimie/immunoanalyse, mais aussi disponibles sur des dispositifs destinés à la biologie délocalisée.
Le dosage de cTn se fait sur plasma ou sérum après centrifugation de l’échantillon de sang recueilli. Il convient, pour chaque méthode, de vérifier quel type de prélèvement est le plus adapté. Le temps d’analyse est d’environ 20 minutes. Certaines méthodes sont sensibles à l’hémolyse (interférence négative). En conséquence, il est souhaitable de mesurer l’indice d’hémolyse simultanément au dosage de cTn, afin d’adapter l’interprétation du résultat.
Il existe aussi des interférences analytiques : telle la présence de Biotine (vitamine B8).
Des faux positifs analytiques ont été décrits avec les dosages conventionnels : ils associent une dissociation clinico-biologique et une normalité des autres marqueurs cardiaques. Ils sont le plus souvent liés à une interférence immunologique (facteurs rhumatoïdes, anticorps hétérophiles). Bien que des solutions technologiques aient été adoptées pour diminuer la susceptibilité des dosages aux anticorps hétérophiles, les méthodes Us/Hs ne sont pas complètement affranchies de ces écueils analytiques qu’il convient de ne pas sous-estimer [17-21].
- En dehors du Syndrome Coronarien Aigu
Elles sont nombreuses : myocardite/péricardite, insuffisance cardiaque, embolie pulmonaire, hypertension artérielle, arythmies, chirurgie cardiaque, hypothyroïdie, états critiques, toxicité cardiaque liée à une thérapie anticancéreuse, chirurgie non cardiaque (en postopératoire), insuffisance rénale chronique, amyloïdose, sepsis. Dans certaines situations, le dosage de la cTn permet d’établir un pronostic (insuffisance cardiaque, embolie pulmonaire), ou d’apprécier l’atteinte myocardique (en cas d’intoxication au monoxyde de carbone, de contusion myocardique) [22].
L’utilisation d’une cTn US/HS augmente la proportion de cTn positives, trouvée dans un contexte de douleur thoracique en dehors d’une thrombose coronaire (Figure 6).
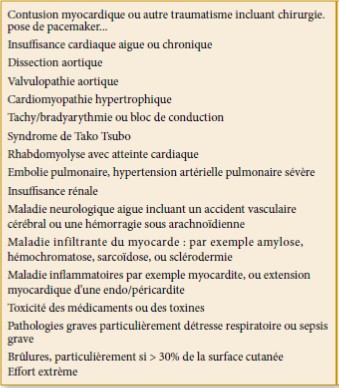
Figure 6 : Causes d’élévation des troponines en dehors du syndrome coronaire aigu
- Cas de l’insuffisance rénale
Dans la population générale ainsi que chez les patients coronariens, des taux élevés de troponines sont associés à un pronostic cardiovasculaire défavorable. Par ailleurs, les taux de troponines sont fréquemment élevés chez les patients qui ont une insuffisance rénale chronique même en l’absence de syndrome coronaire aigu ; on attribue alors cette élévation à une diminution de la clairance rénale et on ne lui accorde généralement pas de signification clinique particulière.
Plusieurs études ont montré qu’un taux élevé de TnT chez les patients insuffisants rénaux, dialysés ou non, est associé à une mortalité plus élevée. Une méta-analyse (17 études ayant regroupé 2.557 patients insuffisants rénaux) a conclu qu’une TnT > 100 ng/L est associée à un risque relatif de mortalité de 2,64 [23].
Une élévation de la TnT traduit donc une souffrance myocardique et n’est pas un faux positif. Il en est de même pour la TnT Hs comme cela a été montré par l’étude de McGill (conduite chez des patients en dialyse chronique) [24].
Plusieurs marqueurs ont été comparés : albumine, CRP, BNP, NT-pro BNP, TnI et TnT Hs.
Avec un recul de 5 ans, le biomarqueur le plus sensible pour l’évaluation du risque de décès toutes causes confondues, était la TnT Hs. Celle-ci a été dosable chez l’ensemble des patients suivis, avec un seuil signant le risque de décès à 24,15 ng/L. En dessous de cette concentration, la valeur prédictive négative pour le risque de décès à 5 ans était de 100%.
La cohorte « Chronic Renal Insufficiency Cohort Study » (CRIC) a inclus des patients insuffisants rénaux chroniques, sans insuffisance cardiaque, ni maladie coronarienne connue, qui ont tous eu une échographie cardiaque à l’inclusion ainsi qu’un dosage de TnT Hs qui était > 3 ng/L chez 84% d’entre eux avec une moyenne à 13 ng/L [25]. Le quartile de ceux ayant les concentrations les plus hautes (> 23 ng/L) avait un risque deux fois plus élevé, d’hypertrophie ventriculaire gauche.
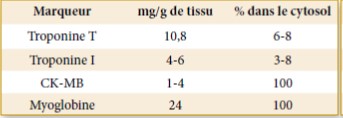
Tableau 02 : Distribution intracardiaque des marqueurs de nécrose
- Conclusion
Les troponines hyper/ultra sensibles sont essentielles dans la prise en charge des cardiopathies d’urgence. Leurs bénéfices : facilité d’accès mais aussi et surtout apport quotidien au diagnostic (diagnostic positif de la pathologie ou son exclusion) ainsi qu’à l’orientation des patients.
Fruit des progrès technologiques, leur dosage présente une grande précision analytique associée à une cardio-spécificité conservée, et une très grande sensibilité, ils restent les marqueurs de choix pour le diagnostic d’IDM sans modification du segment ST, et leur utilisation obéit à des recommandations. En effet, ces nouvelles méthodes nécessitent de connaître les valeurs de référence et les seuils d’interprétation propres à chaque méthode, ainsi que les situations (cliniques ou analytiques) susceptibles de modifier l’interprétation du résultat.
Liens d’intérêts : Les auteurs déclarent ne pas avoir de liens d’intérêts.
Références
- Dolci A, Panteghini M The exciting story of cardiac biomarkers: from retrospective detection to gold diagnostic standard for acute myocardial infarction and more. Clin Chim Acta. 2006 Jul 23; 369(2):179-87.
- K Thygesen, JS Alpert, HD White, HA Katus et al., « Universal definition of myocardial infarction », Circulation, vol. 116, no 22, 24 novembre 2007, p. 2634-2653.
- JA Lemos, MH Drazner, T Omland et al., « Association of troponin T detected with a highly sensitive assay and cardiac structure and mortality risk in the general population », JAMA, vol. 304, no 22, 8 décembre 2010, p. 2503-2512 (DOI 10.1001/jama.2010.1768.
- Thygesen K, Mair J, Giannitsis E et al. « How to use high-sensitivity cardiac troponins in acute cardiac care » Eur Heart J. 2012; 33:2252-7.
- Giannitsis E, Kurz K, Hallermayer K, Jarausch J, Jaffe AS, Katus HA, « Analytical validation of a high-sensitivity cardiac troponin T assay » Clinical Chem. 2010;56:254–261.
- Thygesen K, Mair J, Katus H et al. « Recommendations for the use of cardiac troponin measurement in acute cardiac care » Eur Heart J. 2010;31:2197-204.
- Newby LK, Jesse RL, Babb JD et al. « ACCF 2012 Expert consensus document on practical clinical considerations in the interpretation of troponin elevations: A report of the American College of Cardiology Foundation task force on clinical expert consensus documents » J Am Coll Cardiol. 2012; 60:2427-63.
- Dean KJ. Biochemistry and molecular biology of troponins I and T. In: Wu AHB, ed. Cardiac Markers. Totowa, NJ: Humana Press; 1998; 193–204. 2.
- Collinson PO, Boa G, Gaze C. Measurement of cardiac troponins. Ann Clin Biochem 2001; 38: 423-49
- Katus HA, Remppis A, Scheffold T, Diederich KW, Kuebler W. Intracellular compartmentation of cardiac troponin T and its release … Am J Cardiol 1991; pp. 1360–1367
- Wu A.H., 1999 A comparison of cardiac troponin T and cardiac troponin I in patients with acute coronary syndromes. Coronary Artery Disease, 01 Jan 1999, 10(2):69-74
- [Wu AH., Feng Y J, 1998 Biochemical differences between cTnT and cTnI and their significance for diagnosis of acute coronary syndromes. European Heart Journal, 01 Nov 1998, 19 Suppl N: N25-9
- Thygesen K et al., Task Force for the redefinition of myocardial infarction Eur Heart J 2007; 28: 2525-38.
- Giannitsis E, Thygesen K, Mair J, et al. Study Group on Biomarkers in Cardiology of ESC Working Group on Acute Cardiac Care. How to use high-sensitivity cardiac troponins in acute cardiac care. Eur Heart J 2012; 33:2252-7.
- Reichlin T et al. (2016) early diagnosis of myocardial infarction with sensitive cardiac troponin assays. N Engl J Med 361: 858-67
- Roffi M, Patrono C, Collet JP, Mueller C, Valgimigli M, Andreotti F, et al. 2015 ESC Guidelines for the management of acute coronary syndromes in patients presenting without persistent ST-segment elevation, European Heart Journal, Volume 37, Issue 3, 14 January 2016, Pages 267–315
- Apple FS, Collinson PO; Task Force on Clinical Application of Cardiac Biomarkers. Analytical characteristics of high sensitivity cardiac troponin assays. Clin Chem 2012; 58: 54-61.
- Chenevier-Gobeaux C, Bonnefoy-Cudraz É, Charpentier S, et al. SFBC, SFC, SFMU ‘Troponins’ workgroup. High sensitivity cardiac troponin assays: answers to frequently asked questions. Arch Cardiovasc Dis 2015; 108:132-49.
- Capolaghi B et al. (2005) Recommandations sur la prescription, le dosage et l’interprétation des troponines cardiaques. Ann Biol Clin 63: 245-61
- Christ M et al. (2010) Implementation of high sensitivity cardiac troponin T measurement in the emergency department. Am J Med 123: 1134-42
- Florkowski C et al. (2010) the effect of hemolysis on current troponin assays – a confounding preanalytical variable? Clin Chem 56: 1195-7
- Thygesen K, Mair J, Katus H, et al Causes of elevation of troponin which are not secondary to a myocardial infarction Eur Heart J 2007; 28 : 2525-38. 21.
- Khan L et al. Prognostic value of troponin T and I among asymptomatic patients with end-stage renal disease: a meta-analysis. Circulation 2005; 112: 3088-96.
- McGill D, Talaulikar G, Potter JM, Koerbin G, Hickman PE. Over time, high-sensitivity TnT replaces NT-proBNP as the most powerful predictor of death in patients with dialysis-dependent chronic renal failure. Clin Chim Acta 2010; 411(13–14):936–9.
- Mishra RK et al. Cardiac Troponin I in Non- Acute Coronary Syndrome Patients with Chronic Kidney Disease Am J Kidney Dis Off J Natl Kidney Found. 2013; 61: 701-9.
Les effets extra squelettiques de la vitamine D : Info ou intox ?
L’étude de la répartition ubiquitaire des récepteurs à la vitamine D ainsi que de l’enzyme 1-alpha-hydroxylase dans l’organisme (tissu osseux, intestin, rein, cartilage, thyroïde, parathyroïde, hypophyse, surrénales, testicule, ovaire, pancréas, cellules immunitaires (lymphocytes, macrophages et cellules dendritiques),
O. Drali, Service Pédiatrie B. CHU Nefissa Hammoud, Hussein Dey, Alger.
Date de soumission : 12 Juin 2020.
Résumé : L’étude de la répartition ubiquitaire des récepteurs à la vitamine D ainsi que de l’enzyme 1-alpha-hydroxylase dans l’organisme (tissu osseux, intestin, rein, cartilage, thyroïde, parathyroïde, hypophyse, surrénales, testicule, ovaire, pancréas, cellules immunitaires (lymphocytes, macrophages et cellules dendritiques), muscle, tissu cardiaque, glande mammaire, tractus digestif, appareil urinaire, cerveau), et la capacité de synthèse de 1-25(OH)2D par de nombreux tissus de l’organisme a permis de démontrer que la vitamine D exerce également un grand nombre d’effets pluritissulaires à haut potentiel thérapeutique. Les publications récentes montrent que la vitamine D joue un rôle dans de nombreuses pathologies, dépassant le cadre du métabolisme phosphocalcique. L’objectif de notre travail est de faire une mise au point sur les nouveaux effets attribués à cette vitamine D par une revue de la littérature scientifique.
Mots clés : Vitamine D, enfant, effets extra-squelettiques.
Abstract: The study of the ubiquitous distribution of vitamin D receptors as well as of the enzyme 1-alpha-hydroxylase in the body (bone tissue, intestine, kidney, cartilage, thyroid, parathyroid, pituitary, adrenal, testis, ovary, pancreas, immune cells (lymphocytes, macrophages and dendritic cells), muscle, heart tissue, mammary gland, digestive tract, urinary tract, brain), and the ability to synthesize 1-25(OH)2D by many tissues in the body has demonstrated that vitamin D also exerts a large number of multi-tissue effects with high therapeutic potential. Recent publications shows that vitamin D plays a role in many pathologies, going beyond the framework of phosphocalcic metabolism. The objective of our work is to bring to light the new effects attributed to this vitamin D by a review of the scientific literature.
Key words: Vitamin D, child, extra–skeletal effects.
L’étude de la répartition ubiquitaire des récepteurs à la vitamine D ainsi que de l’enzyme 1-alpha-hydroxylase dans l’organisme (tissu osseux, intestin, rein, cartilage, thyroïde, parathyroïde, hypophyse, surrénales, testicule, ovaire, pancréas, cellules immunitaires (lymphocytes, macrophages et cellules dendritiques), muscle, tissu cardiaque, glande mammaire, tractus digestif, appareil urinaire, cerveau), et la capacité de synthèse de 1-25(OH)2D par de nombreux tissus de l’organisme a permis de démontrer que la vitamine D exerce également un grand nombre d’effets pluritissulaires à haut potentiel thérapeutique. Ces effets dépassent largement le bénéfice sur le métabolisme osseux et des rôles potentiels sur les maladies musculaires, les cancers, les maladies cardiovasculaires, les maladies inflammatoires ou auto-immunes, la dépression, ont été rapportés dans de nombreuses études au cours de cette dernière décennie, et mettent en évidence l’immense champ d’action de cette vitamine, et son rôle potentiel dans la physiopathologie de différentes affections. La vitamine D agit en tant que qu’hormone et régulateur de l’expression de 229 gènes, par l’intermédiaire de son récepteur VDR (1).
Vitamine D et grossesse
Une étude de l’Université de Pittsburgh a analysé des extraits sanguins de 1.198 futures mères avant 22 semaines de grossesse et à la fin de la grossesse ainsi que le sang du cordon ombilical pour connaître le taux fœtal en vitamine D à la naissance. Les résultats indiquent que le déficit en vitamine D en début de grossesse est un facteur de risque de pré-éclampsie. De plus, la croissance du risque est quasi-linéaire et les chercheurs ont pu montrer qu’un taux de 25(OH) D en dessous de 50 nmol/l doublait le risque de pré-éclampsie.
Une autre étude a montré que les femmes nullipares qui développent une pré-éclampsie avaient de faibles concentrations de 25(OH)D. L’objectif de cette étude était d’estimer l’association entre l’apport de vitamine D pendant la grossesse et le risque de pré-éclampsie chez les nullipares : 23.423 femmes enceintes ont pris part à cette cohorte norvégienne dirigée par Haugen en 2009. Ces femmes ont répondu à des questionnaires à la 15ème semaine, à la 22ème semaine et à la 30ème semaine (questionnaire de fréquence alimentaire), les chercheurs ont trouvé une réduction de 27% du risque de pré-éclampsie pour les femmes qui prennent 10 à 15 μg/j de vitamine D.
Une étude canadienne descriptive a mis en évidence l’existence d’une corrélation entre l’hypovitaminose D maternelle et l’hypovitaminose D fœtale et ses conséquences néonatales : hypocalcémie, rachitisme, retard de croissance ainsi qu’une durée du travail allongée. D’autres études tendent à montrer une relation entre hypovitaminose D et diabète gestationnel, HTA gravidique, et petit poids de naissance. Ces études permettent d’insister sur l’importance de veiller à une supplémentation à titre préventif chez toutes les femmes en âge de procréer à fortiori celles qui appartiennent à un groupe à risque de carence (1-9).
Vitamine D, système immunitaire et infections
Les effets de la vitamine D sur les maladies inflammatoires ou immunitaires s’expliquent en partie par la présence du récepteur à la vitamine D (VDR) dans les cellules immunitaires (lymphocytes, macrophages et cellules dendritiques), ainsi que d’une 1-alpha-hydroxylase dans ces mêmes cellules, ce qui leur permet une production locale de la forme active de la vitamine D.
La vitamine D possède des propriétés immunosuppressives ou immunomodulatrices qui entrainent une baisse de la prolifération lymphocytaire et de la production de cytokines ainsi qu’une activation des systèmes non spécifiques et spécifiques de défense immunitaire. Le calcitriol inhibe l’expression d’IL2 et d’interféron-g par les cellules T et atténue la prolifération des lymphocytes T CD4 et CD8, ainsi que la cytotoxicité de ces cellules. Il inhibe également la différenciation plasmocytaire, la prolifération des lymphocytes B, la production d’immunoglobulines, ainsi que la différenciation, la maturation et les capacités de stimulation immunitaire des cellules dendritiques. De plus, il diminue la synthèse d’IL12 et stimule en parallèle la synthèse d’IL10. Tous ces effets induisent une diminution de la réponse cellulaire Th1 et orientent la réponse lymphocytaire vers la voie Th2 (10-22).
Un essai randomisé en 2007 a examiné l’association entre les niveaux de 25(OH) D et des infections récentes des voies respiratoires supérieures chez 18.883 sujets participant à la troisième étude nationale américaine d’examen de la nutrition et de la santé (Third National Health and Nutrition Examination Survey) : les sujets étaient âgés d’au moins 12 ans. Les résultats ont indiqué que par rapport aux sujets ayant des niveaux de 25(OH)D supérieurs à 30 ng/ml, ceux dont les niveaux étaient inférieurs à 10 ng/ml avaient un risque 36% plus élevé d’infection récente des voies respiratoires supérieures et entre 10 et 30 ng/ml, le risque de développer une infection était 24% plus important qu’avec les niveaux les plus élevés (74.75).
Par ailleurs, lors de la récente épidémie de grippe A H1N1, il a été constaté au Canada et aux USA que les personnes ayant un bon statut vitaminique D résistaient mieux à l’infection grippale. Les auteurs concluent que la vitamine D pourrait être un traitement préventif de choix des infections respiratoires virales hivernales. Les autorités sanitaires ont ainsi recommandé, depuis que ces observations ont été réalisées, que l’on donne de la vitamine D lors des périodes d’épidémies grippales (76.77.78).
Mitsuyoshi et al., de Tokyo, ont mené une étude de décembre 2008 à mars 2009 sur 334 enfants. Ces enfants ont été répartis au hasard en 2 groupes, l’un recevant un supplément de 1.200 UI de vitamine D3 et l’autre, un placebo. Les résultats ont montré que les enfants recevant un complément de vitamine D avaient un risque diminué de 42% d’attraper l’influenza A (ce qui se compare bien à l’efficacité du vaccin contre la grippe saisonnière estimée entre 25 et 60%) (79).
De même qu’au Bengladesh, les enfants de 18 mois ou moins, hospitalisés pour une infection broncho-pulmonaire présentaient des taux de vitamine D inférieurs à ceux des enfants qui étaient indemnes (De Roth et al., 2010) (80).
Enfin, au Canada, une équipe a observé que les enfants admis en unité de soins intensifs pour une bronchiolite ou une pneumonie, sont aussi ceux dont les taux de vitamine D sont les plus bas (81).
In vitro, les études expérimentales ont montré les monocytes et les macrophages exposés à Mycobacterium tuberculosis augmentent leur transcription des gènes codant pour le VDR et la 1-alpha-hydroxylase (82.83). Ainsi la production de 1,25(OH)2D augmente, et cela engendre la production de cathélicidine, peptide capable de stimuler l’immunité et de détruire Mycobacterium tuberculosis et d’autres agents infectieux. Ces peptides sont présents dans le tractus pulmonaire et jouent un rôle primordial dans la défense contre les infections respiratoires. Les monocytes ne déclenchent plus cette réaction quand la valeur de 25(OH)D descend en dessous de 20 ng/ml, (73.85).
Dans une étude observationnelle réalisée auprès de sujets originaires d’Afrique sub-saharienne et résidant en Australie, le taux sérique moyen de 25(OH)D des patients ayant une maladie tuberculeuse latente ou un antécédent de tuberculose était significativement plus faible que chez ceux indemnes d’infection tuberculeuse (82.86). Des données similaires ont été observées dans d’autres études menées au Pakistan ou en Afrique du Sud (87.88). Il n’y a pas, à ce jour, d’essais interventionnels de supplémentation en vitamine D ayant pour objectif de prévenir le développement d’une maladie tuberculeuse.
Vitamine D et asthme
Les données indiquent que l’incidence de la maladie est accrue dans les populations où l’apport en vitamine D est déficient ou insuffisant. Les enfants nés de mères ayant présenté une carence en vitamine D pendant la grossesse sont à risque accru de développer une maladie des bronches de type bronchiolite ou asthme du nourrisson et un apport élevé en vitamine D durant la grossesse permet de réduire de 40% le risque d’asthme chez les enfants de 3 à 5 ans.
Chez les enfants asthmatiques, la 25(OH)D sérique est négativement corrélée à la concentration sérique en IgE et au nombre d’aéroallergènes positifs (déterminés par le prick-test). De plus chez ces enfants il existe une association entre 25(OH)D basse, et besoins plus élevés en corticoïdes inhalés. Certaines études ont montré que la carence en vitamine D est beaucoup plus présente chez les enfants asthmatiques en comparaison avec la population générale. De plus, la carence en vitamine D est associé à une forte probabilité de décompensation sévère chez l’enfant avec un asthme modéré à persistant. En effet, un déficit en vitamine D 25(OH)D < 30 ng/ml) est un facteur associé à une augmentation de la fréquence des exacerbations (23-29).
Vitamine D et obésité
Plusieurs mécanismes ont été évoqués pour expliquer la relation entre le statut vitaminique D et l’obésité. Chez l’obèse, la biodisponibilité de la vitamine D3 synthétisée en sous-cutanée ou provenant de l’alimentation, est diminuée en raison de son accumulation dans le tissu adipeux. Après absorption, la vitamine D est séquestrée et stockée dans le tissu adipeux mais aussi dans le tissu musculaire, puis libérée lentement dans la circulation. De plus, l’inactivité physique, plus fréquemment observée chez l’obèse, associée à une diminution de l’exposition solaire, aggrave le déficit en vitamine D. Une méta-analyse de 21 études génétiques portant sur le lien entre les niveaux de vitamine D et l’IMC, a validé les associations entre vitamine D, variations génétiques et IMC, identifiées chez plus de 120.000 personnes participant à une grande étude génétique GIANT (Genetic Investigation of ANthropometric Traits). Les chercheurs ont constaté que chaque augmentation d’une unité d’IMC (soit d’1 kg/m2) est associée à une réduction de 1,15% du niveau de vitamine D dans le sang et que chaque augmentation de 10% de l’IMC est associée à une réduction de 4,2% des niveaux de vitamine D.
En 2008, une étude réalisée sur 2.187 sujets réaffirme que l’IMC est inversement lié à la 25(OH)D sérique. Cette étude montre également, comme l’étude américaine citée plus haut, que les valeurs de 1,25 (OH)D diminuent au fur et à mesure que l’IMC croît. Une étude réalisée par Peterson, qui a donné à un groupe d’adolescents en surpoids des compléments de vitamine D3 (de 1.000 à 4.000 UI/jour pendant six mois), et à un autre groupe, un placebo. Ils sont parvenus à la conclusion que les jeunes obèses ont besoin d’apports bien plus importants en vitamine D que leurs pairs plus minces pour maintenir un taux de vitamine D adéquat, d’au moins 4.000 UI de cette vitamine, soit sept fois plus que les recommandations actuelles (600 UI) de l’Institut de médecine américain (30-32).
Vitamine D et maladies auto-immunes
Parmi les effets extra-osseux de la vitamine D, ses effets pléiotropes sur le système immunitaire sont particulièrement bien décrits. Elle repose en grande partie sur les effets immunomodulateurs connus de la vitamine D sur les cellules immunitaires, qui expriment le VDR. La vitamine D a des effets immunomodulateurs in vitro et in vivo qui ont ouvert la voie à de nouvelles approches thérapeutiques et préventives des maladies auto-immunes et du rejet des allogreffes. On suspecte son implication dans plusieurs pathologies auto-immunes, notamment celles dont la prévalence suit un gradient nord-sud dans les études épidémiologiques, comme le diabète, la sclérose en plaques, le lupus érythémateux disséminé ou le purpura rhumatoïde. De nombreuses données expérimentales, épidémiologiques et cliniques tendent à démontrer le rôle de la vitamine D dans la survenue et/ou l’aggravation de différentes maladies auto-immunes dans des modèles animaux (33-40).
Vitamine D et pathologies inflammatoires chroniques de l’intestin
Un lien physiopathologique entre carence en vitamine D et génétique de la maladie de Crohn a été récemment proposé. Un essai randomisé en double insu, contrôlé, mené sur 108 patients porteurs d’une maladie de Crohn en rémission, et comparant la supplémentation en cholécalciférol à raison de 1.200 UI par jour au placebo, pendant un an. Cette étude a montré que la supplémentation permettait une augmentation modérée, mais significative du taux de 25(OH)D de 27 à 38 ng/ml et qu’il existait dans le groupe supplémenté une tendance à une diminution du nombre de rechutes. En menant divers essais in vitro, les chercheurs ont découvert que la vitamine D stimulait l’activité de certains gènes (NOD2 et β-défensines 2) dont l’absence ou l’altération était associée à la maladie de Crohn. Les chercheurs pensent même que cette découverte pourrait mener à un traitement pharmacologique efficace et peu coûteux de la maladie de Crohn ou d’autres maladies inflammatoires intestinales (41).
Vitamine D et système cardiovasculaire
Le VDR est exprimé par les cellules endothéliales des vaisseaux et des cardiomyocytes. De plus la vitamine D inhibe la prolifération excessive des muscles lisses des vaisseaux sanguins, s’oppose à la calcification de ces vaisseaux, abaisse la production des cytokines pro-inflammatoires, augmente celle des cytokines anti-inflammatoires et contribue à réguler la tension artérielle. Plusieurs travaux suggèrent que l’hypovitaminose D serait un facteur de risque cardio-vasculaire. Ainsi Une méta-analyse de 19 études prospectives rapporte une association forte entre faible concentration de 25-hydroxy-vitamine D, et risque d’évènements cardiovasculaires (RR :1,52) ; de mortalité cardiovasculaire (RR 1,42) ; et de maladie coronarienne (RR : 1,38). Le risque apparaît quand la concentration sérique de 25(OH)D est inférieur à (24 ng/ml) et augmente quand elle décroît de (24 à 8 ng/ml) (42-44).
La 1,25(OH)2D serait un régulateur négatif du système rénine-angiotensine. Chez les souris, la suppression de l’expression du VDR entraîne une augmentation de l’expression de la rénine qui s’accompagne d’une augmentation des taux circulants d’angiotensine II, responsable d’une hypertension artérielle et d’une hypertrophie cardiaque. Une méta-analyse de 11 essais randomisés avec des dérivés hydroxylés de la vitamine D confirme la réduction de la pression artérielle systolique de 6 à 10 mmHg chez des patients hypertendus. Une autre étude comportant 613 hommes âgés de 40 à 75 ans et 1.198 femmes âgées de 30 à 55 ans, suivis pendant 4 à 8 ans paraît en 2007. Chez les sujets présentant une 25(OH)D < 15 ng/ml, par rapport à ceux présentant une 25(OH)D > 30 ng/ml, le risque relatif de présenter une HTA à 4 ans était multiplié par 3,18 (45-47).
Vitamine D et pathologies neurologiques
Les connaissances sur l’existence d’une action de la vitamine D au niveau cérébral ont progressé. De récentes études en laboratoire ont identifiées la présence du récepteur VDR de la vitamine D au niveau des neurones et des cellules gliales du tissu cérébral, ainsi que celle de la 1-alpha-hydroxylase. Depuis 2010, une accélération importante des recherches a permis de mieux préciser l’intérêt de cette molécule dans les pathologies neurologiques, soulignant le rôle neuroprotecteur de cette vitamine.
La distribution importante du récepteur à la vitamine D (VDR) dans l’hypothalamus, influence la synthèse de facteurs tels que la sérotonine, l’acétylcholine ; et le déficit en vitamine D engendre des troubles cognitives (tels que l’autisme), et des maladies psychiatriques (schizophrénie, psychose, dépression chronique), selon plusieurs études observationnelles.
L’hypovitaminose D, à différents âges sensibles de la vie, pourrait donc représenter un réel facteur aggravant plutôt qu’une cause seconde dans la progression de celles-ci. Cela ouvre des perspectives thérapeutiques intéressantes dans la prise en charge (48.49).
Une étude réalisée sur des patients atteints d’épilepsie pharmacorésistante montre qu’une correction de leur hypovitaminose D réduit de 40 % le nombre de crises. La déficience en vitamine D pourrait donc avoir un rôle dans la physiopathologie de l’épilepsie et sa correction pourrait améliorer l’efficacité des traitements antiépileptiques classiques. Par ailleurs, certains de ces traitements, inducteurs du cytochrome P450, augmenteraient la dégradation de la vitamine D3 (50.51).
Vitamine D et cancers
De nombreuses enquêtes épidémiologiques ont affirmées que des concentrations élevées de 25OHD sont associées à une réduction de la fréquence de tout type de cancer à savoir, entre autres : le cancer colorectal, le cancer de prostate, du poumon, des ovaires, du sein, de l’estomac, du rein, du pancréas, de la vessie et de l’utérus, ainsi que le lymphome non hodgkinien et le myélome multiple. Mais aussi à une réduction de la mortalité liée au cancer. Ceci grâce aux pouvoirs de la vitamine D à induire l’apoptose de certaines cellules cancéreuses en bloquant la production de la protéine Bcl-2 (l’expression de cette protéine inhibe l’apoptose), et à inhiber la néoangiogénèse et le risque de dissémination métastatique. Les récepteurs de la vitamine D ont été retrouvés au niveau de nombreux tissus tumoraux (sein, côlon, prostate). Quand ces cellules tumorales sont incubées avec de la 1,25 di-hydroxy-vitamine D3, on observe une diminution de la prolifération cellulaire.
Grant a corrélé, dans une même étude en France et aux États-Unis, l’incidence et la mortalité par cancers en fonction de la latitude. Tous cancers confondus, il retrouve une association statistiquement significative tant pour l’incidence que pour la mortalité en France et aux États-Unis.
Malheureusement il n’existe pour l’instant que peu d’études interventionnelles concernant la vitamine D dans les cancers. Une des rares études, est une étude contrôlée randomisée (effectuée en intention de traiter), de la survie sans cancer chez 1.179 femmes ménopausées pendant 4 ans recevant soit un placébo, soit 1.450 g par jour de calcium, soit 1.100 UI de vitamine D par jour associée à 1.450 g de calcium. Elle montre une réduction de 60% des cancers invasifs, tous cancers confondus entre le groupe placébo et le groupe recevant calcium et vitamine D (52-56).
Le calcitriol et ses analogues auraient des effets néphroprotecteurs et antiprotéinuriques d’après des études observationnelles. Les études expérimentales sont en faveur d’une inhibition du système rénine-angiotensine et de la voie d’activation du NF-KB (qui participe à la fibrose rénale) par la vitamine D.
Dans des modèles animaux de maladies rénales chroniques, les analogues de la vitamine D atténuent la fibrose tubulo-interstitielle et glomérulaire et réduisent la protéinurie. Chez l’homme, la 25(OH)D serait inversement associée à la prévalence de la microalbuminurie. Récemment, une étude, randomisée contre placebo, incluant des patients avec une insuffisance rénale chronique, a montré qu’un traitement par le calcitriol diminuait l’albuminurie et les marqueurs de l’inflammation, ceci indépendamment de ses effets sur l’hémodynamique et la parathormone (57).
Vitamine D et mortalité
Une méta-analyse franco-italienne parue en 2007, rapportait les résultats de 18 essais randomisés regroupant un total de 57.311 sujets, comparé des groupes “intervention” avec une supplémentation en vitamine D de 300 à 2000UI par jour, à des groupes “contrôle”. La prise d’une supplémentation en vitamine D (en moyenne de 528 UI/j) est associée à une diminution de la mortalité toutes causes confondues avec un risque relatif significatif entre les 2 groupes de 0,93 (intervalle de confiance à 95% entre 0,87 et 0,99).
En 2008, l’association entre risque de mortalité globale et carence en vitamine D a été évalué dans la cohorte NHANES III. L’échantillon comptait 13.331 sujets représentatifs de la population américaine. Dans le quartile de 25(OH)D le plus faible (moins de 17,8 ng/ml), le risque de mortalité globale était augmenté de 70 % par rapport au quartile supérieur (58.59).
Conclusion
Le dépistage et le traitement de l’insuffisance en vitamine D constituent un enjeu de santé publique. Beaucoup de travaux ont été menés ces dernières années sur la vitamine D, qui ont permis de mieux comprendre ses nouvelles fonctions extra squelettiques.
Le diagnostic de la carence en vitamine D devrait être évoqué plus facilement par le corps médical, en particulier par les médecins généralistes qui sont en première ligne auprès des patients, ceci d’autant plus que la confirmation du diagnostic est aisée et que la supplémentation est simple, peu coûteuse et bien tolérée.
Une exposition raisonnable au soleil dans le cadre d’activité en plein air devrait contribuer à réduire la prévalence des déficits en vitamine D. L’opportunité d’autres actions de santé publique (enrichissement d’aliments et supplémentation médicamenteuse), est aussi probablement à discuter.
Les recommandations datant des années 90 sont anciennes, et totalement orientées vers la prévention du rachitisme qui a quasiment disparu dans notre pays. Reste omniprésent le souci d’une optimisation du statut en 25 OHD. Il est nécessaire de réfléchir sur de nouvelles recommandations tenant compte de nouvelles connaissances récentes sur la vitamine D et son rôle dans de nombreuses pathologies, dépassant le cadre du métabolisme phosphocalcique.
Liens d’intérêts : Les auteurs déclarent ne pas avoir de liens d’intérêts.
Références
- Hyppönen E. Preventing vitamin D deficiency in pregnancy: importance for the mother and child. Ann Nutr Metab. 2011;59(1):28-31.
- Finer S, Khan KS. Inadequate vitamin D status in pregnancy: evidence for supplementation. Acta Obstet Gynecol Scand. 2012 Feb;91(2):159-63.
- Bischoff-Ferrari HA. Vitamin D: role in pregnancy and early childhood. Ann Nutr Metab. 2011;59(1):17-21.
- Milman N, Hvas AM. Vitamin D status during normal pregnancy and postpartum. A longitudinal study in 141 Danish women. J Perinat Med. 2011 Nov.
- Rutz HP. Hypovitaminosis D, insulin resistance and hypertension in pregnancy. Eur J Clin Nutr 2005;59(6):805-806.
- Aghajafari F, Nagulesapillai T. Association between maternal serum 25-hydroxyvitamin D level and pregnancy and neonatal outcomes: systematic review and meta-analysis of observational studies. BMJ2013;346:f1169.
- De-Regil LM, Palacios C. Vitamin D supplementation for women during pregnancy. Cochrane Database Syst.Rev2012;(2):CD008873
- Thorne-Lyman A, Fawzi WW. Vitamin D during pregnancy and maternal, neonatal and infant health outcomes: a systematic review and meta-analysis. Paediatr Perinat Epidemiol 2012;26(suppl 1):75-90.
- Yuk JM, Shin DM. Vitamin D3 induces autophagy in human monocytes/macrophages via cathelicidin. Cell Host Microbe 2009; 6:231-43.
- Hewison M. An update on vitamin D and human immunity. Clin Endocrinol 2012 ; 76:315-25.
- Wang TT, Nestel FP. Cutting edge: 1,25-dihydroxyvitamin D3 is a direct inducer of antimicrobial peptide gene expression. J Immunol. 2004; 173:2909
- Yamshcikov AV, Desai NS. Vitamin D for treatment and prevention of infectious diseases: A systematic review of randomized controlled trials. Pract. 2009; 15:438-449.
- Van Etten E, Mathieu C. Immunoregulation by 1,25-dihydroxyvitamin D3: basic concepts. Steroid Biochem. Mol. Biol. 2005, 97: 93-101.
- Adams JS, Hewison M. Unexected actions of vitamin D: new perspectives on the regulation of innate and adaptative immunity. Clin Pract Endocrinol Metab. 2008;4(2):80-90
- Ginde, Adit. Association between serum 25-hydroxyvitamin D level and upper respiratory tract infection. the Third National Health and Nutrition Examination Survey 2009
- Jolliffe DA, Griffiths CJ. Vitamin D in the prevention of acute respiratory infection: systematic review of clinical studies. J Steroid Biochem Mol Biol 2013; 136:321-9.
- Mitsuyoshi, Urashima. Randomized trial of vitamin D supplementation to prevent seasonal influenza A in schoolchildren. The American Journal of Clinical Nutrition 2010
- Vitamin D status and acute lower respiratory infection in early childhood in Sylhet, Bangladesh. Acta Paediatrica 99 (3) 2010: 389-393.
- Li-Ng M, Aloia JF. A randomized controlled trial of vitamin D3 supplementation for the prevention of symptomatic upper respiratory tract infections. Epidemiol Infect 2009;19:1–9.
- Martineau AR, Honecker FU. Vitamin D in the treatment of pulmonary tuberculosis. J Steroid Biochem Mol Biol 2007; 103:793-8.
- Nnoaham, Kelechi E, Low serum vitamin D levels and tuberculosis: a systematic review and meta-analysis International Journal of Epidemiology 37 (1) 2008.113-119.
- Martineau AR, Timms PM. High-dose vitamin D(3) during intensive-phase anti-microbial treatment of pulmonary tuberculosis: a double-blind randomised controlled trial. Lancet 2011; 377:242-50.
- Dutau G, Lavaud F. Vitamine D, immunité, asthme et symptômes d’atopie. Revue française d’allergologie 2012 ; 52 : S10-S18.
- Clifford, Rachel. Vitamin D – a new treatment for airway remodelling in asthma? ». British Journal of Pharmacology 158 (6) 2009.1426-1428.
- Sandhu, Manbir S. The role of vitamin D in asthma ». Annals of Allergy, Asthma & Immunology: Official Publication of the American College of Allergy, Asthma, & Immunology 105 (3) 2010191-199; quiz 200-202
- Pfeffer PE, Hawrylowicz CM. Vitamin D and lung disease. 2012 Nov;67(11):1018-20
- Camargo, Rifas. Maternal Intake of vitamin D during pregnancy and risk of recurrent wheeze in children at 3 y of age. Am J Clin Nutr 2007; 85:788!95
- Bener A, Ehlayel MS. Vitamin D deficiency as a strong predictor of asthma in children. Int Arch Allergy Immunol. 2012;157:168
- Brehm JM, Schuemann B. Serum vitamin D levels and severe asthma exacerbations in the Childhood Asthma Management Program study. J Allergy Clin Immunol. 2010; 126:52–8
- Konradsen S, Ag H. Serum 1,25dihydroxy vitamin D is inversely associated with body mass index. J Nutr 2008;47(2):87!91.
- Parikh SJ, Edelman M. The relashionship between obesity and serum 1,25dihydroxy vitamin D concentrations in healthy adults. J Clin Endocrinol Metab 2004; 89(3):1196!9.
- Smotkin-Tangorra M, Purushothaman R. Prevalence of vitamin D insufficiency in obese children and adolescents. J Pediatr Endocrinol Metab. 2007;20(7):817-823
- Arnson, Yoav. Vitamin D and autoimmunity: new aetiological and therapeutic considerations. Annals of the Rheumatic Diseases 66 (9): 1137 -1142.2007
- Mora, J Rodrigo. Vitamin effects on the immune system: vitamins A and D take centre stage. Nature Reviews. Immunology 8 (9) 2008: 685-698.
- Antico A, Tampoia M. Can supplementation with vitamin D reduce the risk or modify the course of autoimmune diseases? A systematic review of the literature. Autoimmun Rev 2012; 12:127-36.
- Scragg R, Sowers M. Serum 25-Hydroxyvitamin D, Diabetes, and Ethnicity in the Third National Health and Nutrition Examination Survey. Diabetes Care. 2004, 27: 2813-2818.
- Solomon A, Whitham R. Multiple Sclerosis and Vitamin D: A Review and Recommendations. Curr Neurol Neurosci Rep 2010, 10:389–396
- Heidari B, Hajian-Tilaki. The status of serum vitamin D in patients with rheumatoid arthritis and undifferenciated inflammatory arthritis compared with control. Rheumatol Int 2011 Jan 19.
- Monticielo OA, Teixera T. Vitamin D and polymorphism of VDR gene in patients with systemic lupus erythematosus. Clin Rheumatol 2012; 31:1411-21.
- Silva JD, Fernandes KM. Vitamin D receptor (VDR) gene polymorphisms and susceptibility to systemic lupus erythematosus clinical manifestations. Lupus 2013; 22:1110-7.
- Jorgensen SP, Agnholt et al. Clinical trial: vitamin D3 treatment in Crohn’s disease – a randomized double-blind placebo-controlled study. Aliment Pharmacol Ther 2010.
- John H, James H, David B. Vitamin D Deficiency. An Important, Common, and Easily Treatable Cardiovascular Risk Factor. Journal of the American College of Cardiology 2008; 52-24.
- Cormier C, Courbebaisse M. Effect of vitamin D deficiency on cardiovascular risk. J Mal Vasc. Jul;2014.35(4):235-41
- Pilz S, Tomaschitz A. Vitamin D, cardiovascular disease and mortality. Clin Endocrinol 2010
- Richart T, Li Y. Renal versus extrarenal activation of vitamin D in relation to atherosclerosis, arterial stiffening, and hypertension. J. Hypertens. 2007 Sep;20(9):1007–15.
- Witham MD, Nadir MA. Effect of vitamin D on blood pressure: a systematic review and meta-analysis. J Hypertens 2009; 27:1948-54.
- Burgaz A, Orsini N,. Blood 25-hydroxyvitamin D concentration and hypertension: a meta-analysis. J Hypertens 2011; 29:636-45.
- Eyles DW, Smith S. Distribution of the vitamin D receptor and 1α! hydroxylase in human brain. J Chem Neuroanat 2005; 29: 2130.
- Kiraly SJ, Kiraly MA. Vitamin D as a neuroactive substance: review. The Scientific World Journal. 2006, 6 : 125-139. 95.
- Hollo A, Clemens Z. Correction of vitamin D deficiency improves seizure control in epilepsy: a pilot study. Epilepsy Behav 2012; 24(1):131-3.
- Hollo A, Clemens Z. Epilepsy and vitamin D. Int J Neurosci 2014; 124(6):387-93.
- Garland C, Gorham E. Vitamin D for Cancer Prevention: Global Perspective. Ann Epidemiol 2009; 19:468–483.
- Chung, Ivy. Role of vitamin D receptor in the antiproliferative effects of calcitriol in tumor-derived endothelial cells and tumor angiogenesis in vivo ». Cancer Research 69 (3) (février 1): 967-975.2009
- Ingraham, Betty. Molecular basis of the potential of vitamin D to prevent cancer. Current Medical Research and Opinion 24 (1): 139-149.2009
- Freedman DM, Looker AC. Prospective study of serum vitamin D and cancer mortality in the united states. J Natl Cancer Inst. 2007;99(21):1594-1602
- Grant WB, Garland CF. An estimate of cancer mortality rate reductions in Europe and the US with 1,000 IU of oral vitamin D per day. Recent Results Cancer Res. 2007; 174:225-234.
- Kandula P, Dobre M. Vitamin D supplementation in chronic kidney disease: a systematic review and meta-analysis of observational studies and randomized controlled trials. Clin J Am Soc Nephrol 2011;6:50-62.
- Autier P, Gandini S. Vitamin D supplementation and total mortality: a meta-analysis of randomized controlled trials. Archives of internal medicine. 2007, 167 : 1730‑
- Bjelakovic, Gluud. Vitamin D supplementation for prevention of mortality. Cochrane Database Syst. Rev2011;(7):CD007470